

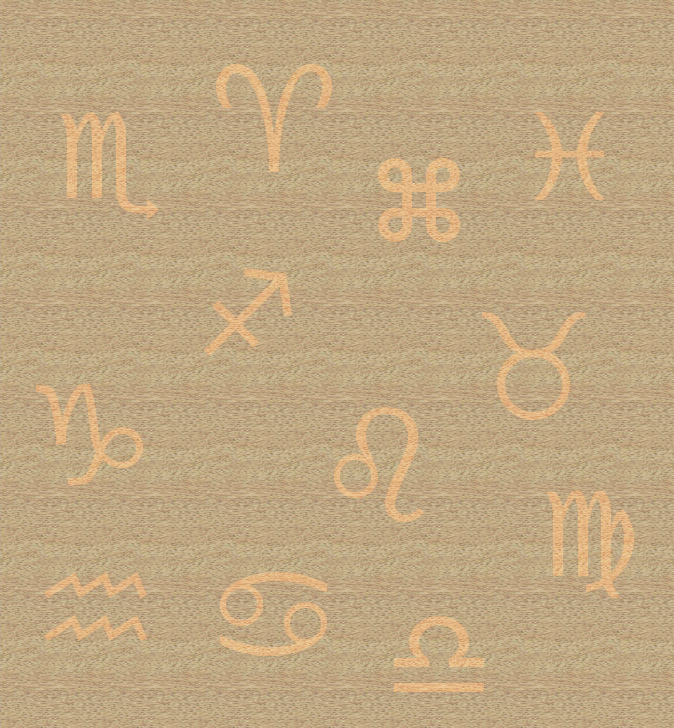
|
Corbeil VII, 35 2024-2025 La grande Pesche
viendra plaindre, plorer D'avoir esleu :
trompés seront en l'âge : Guiere avec eux ne voudra demourer,
Deceu sera par ceux de son langage. Pologne "pesche"
du grec pessikos : qui a la passion du jeu Le Pelletier interprète ce quatrain comme l’aventure polonaise du roi Henri III, à la suite de Chavigny, qui lit cependant "poche" à la place de "pesche". (Jean Aimé de Chavigny, De l'advenement a la couronne de France, de tres-illustre et tres-genereux prince Henry de Bourbon, Roy de Navarre, Petri Roussin, 1594 - books.google.fr). Mais on restera sur la pêche (pesche au XIIème siècle du pluriel neutre "persica" passé au féminin, de "persicum" , de Perse : Dictionnaire étymologique Larousse, 1969). De ce fait étymologique on pourrait avoir un lien avec l’Iran (cf. quatrain VI, 65) Pêche de Corbeil La Framboisière, médecin de Henri
IV et de Louis XIII, Ă©crivait en 1614 que la meilleure pĂŞche Ă©tait celle de
Corbeil. Corbeil avait cette réputation depuis longtemps, puisque Rabelais,
dans son Pantagruel, L. 4, Ch. 59, met les pĂŞches de Corbeil parmi les choses
que sacrifient les gastrolâtres à leur Dieu ventrepotent,
et que Papire Masson dans sa description des fleuves,
en parlant de Corbeil, rapporte comme un dicton populaire : fruict
de Corbeil, belle depesche Le marchand de pĂŞches joue sur les homonymies du fruit : Pesche de Corbeil, la pesche
! / Qui en prend une, l'on pesche ! / Encore pesche il mieux Celuy qui en pesche deux, citation tirée de la première édition du texte : Les Cri[sic]de Paris /tous nouveaux, /et sont en nombres cent et
sept, /tous y sont vieux et nouveaux, / par dictez et motz
nouveaux, /second l'ordre de l'alphabet, Paris, 1545 (BnF,
RĂ©s., YE-1607), de Truquet Les pesches de Corbeil du Livre IV du Pantagruel Les Ă©pisodes de Quaresmeprenant
ou de messere Gaster au
Quart Livre illustrent la forte présence de cet élément dans la deuxième phase
de la création rabelaisienne, même si l'analyse de leur intentionnalité pose
des problèmes considérables. Pour l'instant il suffira de mentionner la liste
de plus de 200 aliments et boissons que les gastrolâtres sacrifient à leur
«Dieu Ventripotent», messere Gaster
(QL LIX- LX), pour l'apaiser puisqu'«en sa rage il mange tous bestes et gens» (LVII, 673). La description de cet
estomac-tyran, soutenue par une Ă©rudition classique qui ancre le monstrueux
troublant dans la structure dialogique du texte, illustre davantage le rĂ´le de
plus en plus inquiétant des monstres grotesques du Quart Livre [...]. En dépit
de ce portrait menaçant, il ne faut pas oublier les nuances essentielles
qu'apporte le jugement de Pantagruel, qui «détesta les Engastrimythes
et les Gastrolâtres» (LVIII), courtisans du «Dieu Ventripotent», sur lequel la
critique semble se concentrer de façon bien plus univoque que sur le « premier maistre es ars du monde». Ceci renforce le statut
ambivalent de Gaster Où est l'idée, où est la chair, dans les descriptions de Messere Gaster ou celles de Quaresmeprenant ? Regardez Quaresmeprenant
: il a, nous dit Rabelais, l'apparence de l'esprit le plus pur, «foisonnant en
pardons, indulgences & stations, homme de bien, bon catholique & de
grande dévotion. Il pleure les trois parts du jour. Jamais ne se trouve aux
noces. . . ». Mais ce qu'il est en réalité, c'est un monstre de matérialité,
dont tous les organes & toutes les facultés de l'âme sont des choses : des
pages & des pages d'anatomie contre nature, une liste dont la sécheresse
finit par lasser, — la tête comme un alambic, l'entendement comme un bréviaire,
la raison comme un tabouret... Voyez Messere Gaster : en apparence, c'est «une effigie monstrueuse,
ayant les Ĺ“ils plus grands que le ventre, & la
tĂŞte plus grosse que tout le reste du corps, avec amples, larges &
horrifiques mâchoires bien endentelées ... ». Il appelle Gaster «le noble maistre des ars » (LXI, 1. 2),
mais méfions-nous, il l'appelle aussi: « messere Gaster» (LVII, titre et 1. 30), or, il n'emploie
l'italianisme messere que pour les Italiens, ce qui
est normal (cf. livre IV, Prot., 1. 374, Ă©d.
Lefranc), mais toujours ironiquement (livre II, XXIV, n. 22, livre, IV, LXVII,
1. 39), pour Lucifer, (livre III, XXII, 1. 23) 5, pour CoqĂĽage
(livre III, XXXIII, 1. 39) et, tout particulièrement, pour Priapus
(livre IV, Prol., 1. 176 et n. 141, Ă©d. Lefranc) Ce besoin premier, voire tyrannique, de manger est Ă l'image du "messere
Gaster" de Rabelais, qui "ne parle que par
signes. Mais à ces signes tout le monde obeist plus soubdain que aux edictz des Praeteurs et mandemens des Roys"." Messere Gaster, qui produit des signes si impérieux, exerce un
véritable Magister Artium. [...]. Par cette élection
de Gaster, Rabelais tournait en dérision la théorie
néoplatonicienne de Marsile Ficin qui faisait de l'amour la force motrice de toute
création L'« argument » lui vient ici de Perse, Chol., 10 : « Magister artis ingenique largitor, venter »,
appelé le Satyricque. Notons que la pêche est malum persica. Retrouve-t-on la
Perse incidemment ? Les "pesches de
Corbeil" ne font pas partie du menu des jours maigres Ainsi ne font les Genevois [les habitants de Genes] quand, au matin, avoir dedans, leurs escritoires et cabinetz discouru,
propensé et resolu de qui
et dequelz, celuy jour, ilz pourront tirer denares et qui,
par leur astuce, sera beliné, corbiné, trompé et
affiné; ilz sortent en place, et, s'entresaluant, disent: Sanita et guadain, messer. Ilz ne se
contentent de santé, d'abondant ilz souhaitent gaing, voire les escuz de Gadaigne (Prologue au Quart Livre). "corbiné"
[cf. Corbeil] de cor binum : coeur
double Le platonisme Dans le courant de l'année 1210, un concile provincial
assemblé dans la ville de Paris, sous la présidence de Pierre de Corbeil, archevêque
de Sens, défend de lire désormais en public les livres d'Aristote sur la
philosophie naturelle, et treize clercs, curés, simples prêtres, diacres,
sous-diacres, accusés d'avoir puisé dans ces livres le venin d'une abominable
hérésie, sont dégradés dans un champ désert, sous les murs de la ville, pour
être ensuite envoyés dans la prison de l'évêque, c'est-à -dire dans une prison
perpétuelle, ou bien livrés au bras séculier, c'est-à -dire au bûcher. [...]
Vers le milieu du XIIe siècle, après la condamnation d'Abélard, on n'ose plus
lire les écrits d'Aristote traduits, interprétés par Boèce; on ne veut plus se
faire initier à la science des choses que par le Timée de Platon, commenté par Chalcidius. En 1366 , deux cardinaux, deux légats d'Urbain V
décrètent qu'avant de postuler le plus humble des grades en celte université
fameuse, modèle de toutes les autres, on prouvera qu'on a pour le moins entendu
lire et commenter les diverses parties de la Logique; une autre décision des
mêmes légats, de plus grave conséquence, porte qu'on ne sera pas admis aux
examens de la licence sans avoir étudié la Physique et la Métaphysique x. Dès
lors on n'enseigne plus rien que d'après Aristote, ou, pour mieux dire, il est
le pédagogue universel. Quand le moyen âge finit, quand commence l'ère moderne,
partout ailleurs qu'en France on divinise Platon. Or, quelle triste fin eut
ici, dans le même temps, l'entreprise de l'ingénieux et docte Ramus ! Un édit
du roi François Ier (car, avec l'assentiment de l'Église, les rois rendaient
alors des arrêts dogmatiques), un édit sollicité non-seulement par des philosophes,
mais encore par des théologiens et des légistes, condamne, supprime les écrits
de Ramus comme injurieux envers la mémoire d'Aristote, et défend au séditieux
sectateur de Platon de jamais reparaître dans une chaire pnblique.
On demandait un châtiment plus sévère; on voulait, au rapport d'Omer Talon,
relever le bûcher de l'année 1210 pour venger l'honneur de la philosophie et,
disait-on, « la liberté de l'esprit humain. » Si le roi refusa de condescendre
Ă cette fureur de vengeance, Ramus expira bientĂ´t sous le poignard d'un
assassin Dans le Quart Livre, les Papimanes
battent les enfants, et Platon, deux chapitre avant
qu'apparaisse Gaster, enseigne aux enfants. Deduautaige, Antiphanes disoyt la doctrine de Platon es parolles
estre semblable, lesquelles, en quelque contree bu temps du fort hyuer,
lors que sont proferees, gelent
et glassent a la froideur de l’aer,
et ne sont ouyes. Sembleblement
ce que Pluton enseigne es ieunes enfans,
a peine estre d’iceulx entendu, lors qu’estoyent vieulx deuenuz. Ores serait au
philosopher et rechercher si forte fortune iey seroyt l’endroict onquel telles parolles dogeleut. Nous serions bien esbahyz
si e’estoyent les teste et lyre d’Orpheus.
Car, apres que les femmes Threisses
eurent Orpheus miz en pieces. elles iectarent
sa teste et sa lyre dedans le fleuue Hebrus. Icelles par ce fleuue
descendirent en la mer Ponticque, iusques
en l’isle de Lesbos, tousiours
ensemble sus mer naigeanlts. Et de la teste
continuellement sortoit ung
chant lugubre, comme lamentant la mort d'Orpheus: la
lyre, a l’impulsion des vens montent les chordes, accordoit harmonieusement anecques
le chant. Reguardons si les voyrons
cy autour (Livre IV, chap. 55) En faisant du ventre le premier maître ès arts de ce
monde, Rabelais s'oppose ouvertement Ă Marsile Ficin qui, dans son Commentaire
du Banquet de Platon, déclarait que l'Amour était le maître et guide de tous
les arts. L'antithèse est trop flagrante pour ne pas être délibérée. Rabelais
se situe ainsi en réaction contre le néo-platonisme, qui méprise le corps.
Cependant, messire Gaster, l'Estomac mais aussi la
Matière, recèle sa propre ambiguïté. Principe bienfaisant, il invente toutes
choses. Il est à l'origine de tous les arts, de tous les métiers, de toutes les
machines, car la satisfaction de ce besoin alimentaire qu'est la faim constitue
l'infrastructure dont dépend tout le reste et sur laquelle tout s'édifie: la
société, les créations intellectuelles, les aspirations spirituelles. Mais,
principe malfaisant et destructeur, il est Ă©galement le ventre qu'adorent et
que déifient les Gastrolâtres. Deux chapitres décrivent le rituel propitiatoire
auquel ceux-ci se livrent. Ils fournissent l'occasion d'une extraordinaire
profusion gastronomique. Les jours gras, les Gastrolâtres sacrifient à leur
dieu toutes sortes de pain, de viande, de soupe, de charcuterie, de volaille et
de gibier, de légumes et de desserts dont pas moins de soixante-dix-huit sortes
de confitures. Lesjours maigres, ils lui offrent des
hors-d'œuvre, des salades et quatre-vingt-douze espèces de poissons que
Rabelais énumère. Il n'oublie rien. Or, malgré cette abondance sacrificielle, Gaster ne se prend pas pour un dieu. Rabelais condamne
ainsi les excès des Gastrolâtres mais le
ventre demeure pour lui une réalité digne d'être honorée. Comme on le voit, la
composition du Quart Livre répond à une structure antithétique. Dans cette
optique, l'île de Quaresmeprenant (l'expression
signifie en moyen français «jeûner», «faire carême») se révèle l'une des îles les
plus extraordinaires pour son incomparable satire de l'ascétisme catholique.
Une satire du jeûne et de l'abstinence, du fanatisme catholique. Quaresmeprenant, qui loge en l'île de Tapinois, incarne le
refus même de la vie Pierre de Corbeil Pierre de Corbeil, né à Corbeil vers 1150 et mort le 3 juin 1222 (ou 1221), est un prélat français du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, et l'un des plus célèbres professeurs de théologie de son temps. En 1098, Pierre est chanoine à Paris où il se joint à l'évêque Odon de Sully pour tenter de supprimer la fête des fous. Il est imposé évêque de Sens vers 1199, par le pape Innocent III son ancien élève, contre la volonté du chapitre. Pierre de Corbeil a, dit-on, composé le texte et le chant de l'office de la "Fête de l'âne", contenu dans un diptyque qui se conserve à la bibliothèque publique de Sens, et dans lequel se trouve la fameuse prose si souvent citée : Orientis partïbus, adventavit asinus, etc. Il est également mentionné comme auteur d'une satire contre le mariage (De conjuge non ducenda, ou De optimo matrimonio) (fr.wikipedia.org - Pierre de Corbeil). L'âne et le pêcher Dans la Fuite en Egypte représentée sur les portes de
bronze de Bénévent, la porte de la ville vient d'être franchie : c'est un mur
droit, percé d'une grande baie cintrée, couronné par une rangée de merlons et
se reliant aux maisons dont on voit les façades. En tête marche S. Joseph, en
tunique et manteau, pieds nus, qui tient l'âne par la bride et qui, pour
soulager la mère, a pris l'enfant qu'il a assis sur son épaule. Le petit Jésus
est déjà grand : il est habillé d'une tunique et, pour indiquer sa mission
doctrinale dans le monde, il a un rouleau à la main. L'âne chemine
gaillardement, la tĂŞte haute, comme s'il Ă©tait fier de porter Marie, qui a la
tête voilée et tend les deux bras vers son divin Fils. Enfin, en arrière, suit Dixmas, qui deviendra un jour le bon larron. C'est un
adolescent ; d'une main il stimule l'âne avec une verge, de l'autre il tient, Ă
un bâton posé sur son épaule, un baril dont l'eau devait, pendant la route, étancher
la soif des fugitifs. Un palmier à branches recourbées dresse sa haute tige
entre S. Joseph et l'âne. Cet arbre, dont parle Sozomène
(Hist. eccles., lib.V, cap. 21), paraît avoir
existé réellement près d'Hermopolis : on le vénérait et on attribuait plus d'un
prodige à l'emploi de ses feuilles et de son écorce. Au XIIe siècle, Honorius
d'Autun en faisait un pêcher (Specul. eccles., serm. de Innocentib.) : « Fertur etiam quod, cum Hermopolim civitatem intrasset, arbor persicus alta, daemonibus consecrata, coram
Salvatore se usque ad terram
inclinasset ; quae post multos ibidem annos duravit et multis multa beneficia sanitatum contulit. » Sozomène parle d'un persea que certains ont pris pour persica,
comme le fit Pline au sujet du persea de Théophraste.
Pline, Dioscoride et Galien, qui ont décrit le
véritable pêcher sous les noms de mala persica, Persica, (Pl. 15, 11 ; Diosc. 1,131), parlent ailleurs du Persea
d'Egypte, que Pline nomme aussi Persica (Pl. 13, 9; Diosc. 1, 146; Gal. de medicam. comp. 2) Persea est un genre végétal
appartenant à la famille des lauracées représenté par plus de 150 espèces
d'arbres à feuillage persistant. L'espèce la plus connue est l'avocatier (P.
americana), largement cultivé dans les régions tropicales et subtropicales pour
son fruit, l'avocat Le nom de Persea ou persica aura conduit Ă croire qu'il s'agissait d'un pĂŞcher,
puis de n'importe quel autre arbre fruitier fréquent sous notre ciel. Honorius
d'Autun, ou d'Augsbourg (si l'on veut Ă©piloguer), y prĂŞte un peu ; mais on ne
l'avait pas attendu; puisqu'un Ă©vangile apocryphe (Histor.
de nativitate Mariœ et de infantia Salvatoris, cap. xx), l'un
des pires, a prétendu que c'était un palmier à dattes. La trèssainte
Vierge jugeant que les fruits de cet arbre seraient fort utiles après deux ou
trois jours de voyage, aurait eu grande envie de s'en rafraîchir. Joseph trouvait
que c'était une envie déraisonnable, vu la hauteur démesurée du tronc qui ne
permettait pas d'atteindre la grappe (régime). Mais l'Enfant Jésus aurait
ordonné au palmier de se fléchir, et l'arbre se serait mis immédiatement à la
disposition de la Mère de Dieu : courbant sa cime vers la terre jusqu'Ă
permission de se relever. Au moyen âge latin on peint un cerisier en pareil
cas, comme portant des fruits plus appétissants pour nous autres Occidentaux,
que ne le seraient les dattes. Honor. Augustodun., De innocentibus (Cologne, 1531, fol. 28 V, sq.): Jubet angelus Joseph
cum Maria et puero ait AEgyptum
pergere, / Dicens Herodem enm quandoqne
velle perdere. / Qui quum /Egyptum iugrediuntur,
/ Ad introitum Cbristi idola corruisse referuntur. / Fertur etiam [quod] quum Hermopolim civitatem iutrasset, / Arbor Persicus alta / Daemonibus consecrata /, Coram Salvatore se usque
ad terram inclinasset; / Quae post multos ibidem an nos
durait (duravit?), / Et... multis
multa beneficia sanitatum contulit. La fête de l'âne et Pierre de Corbeil L'omniprésence de l'âne au cours de la période festive
des douze jours de Noël avait eu pour conséquence d'associer cette période de l'année
avec l'apparition de l'âne sur la scène des théâtres religieux. Les Prophetæ se jouaient pendant les douze jours de Noël et,
selon la plupart des manuscrits, ils mettaient en scène un âne au milieu de
personnages saints. Les Chester plays représentent
l'histoire de l'âne de Balaam appelé "Burnell". Mais les plus célèbres étaient les Fêtes de
l'âne, durant lesquelles on chantait l'Orientis
partibus, dit aussi "Chanson de l'âne." Cette chanson énigmatique,
attestée dans MS. Madrid 289 (fol. 146-147), MS Egerton
2615 et MS. Sens 46A remonte à la fin du XIe siècle avec des versions connues
durant les premières années du XIIIe. Voir Wulf Arlt, Ein Festoffizium
des Mittelalters aus
Beauvais in seiner liturgischen
und musikalischen Bedeutung, 2 vols. (Cologne: Arno Volk
Verlag, 1970). Pour la fĂŞte de Sens, l'Ă©dition de
référence reste celle de l'Abbé Villetard, Office de
Pierre de Corbeil (Paris: Alphonse Picard, 1907). La célébration avait lieu au cours de la nuit du 31
décembre. La nature exacte de cette fête est toujours sujette à controverse et
elle offre la particularité d'être à la fois une cérémonie liturgique d'une
beauté surprenante, accompagnée de la musique la plus savante, en même temps
qu'elle trahit des affinités subtiles avec les thèmes de la dérision et de la
Fête des fous. Des manuscrits attestent la présence de l'âne dans la dramaturgie
liturgique de l'époque médiévale, mais il n'en découle pas pour autant qu'on
puisse établir une relation directe entre les pièces de Noël et le personnage
de Bottom. Pour nous, la tradition qui fait
apparaître l'âne dans les drames liés aux fêtes chrétiennes inscrit Bottom dans un contexte calendaire lié au solstice d''été,
comme les Prophèteslient leur mise en scène aux douze
jours de Noël faisant suite au solstice d'hiver. D'autres apparitions de l'âne
lors de dates de transition du calendrier ne sont pas non plus fortuites. Dans
le bestiaire médiéval, l'association entre l'onagre et l'un des quatre points
cardinaux de l'année est riche de significations et suggère de très anciennes
associations entre cet animal, le comput calendaire et l'astrologie. Le
braiment de l'âne se rattache à une période de transition cosmologique et
saisonnière et il apparaît plus précisément à une date solaire importante qui
marque le passage d'une saison Ă une autre. Contrairement Ă ce qu'on a pu
écrire sur ce point, l'âne avait un rapport étroit avec de nombreuses coutumes
et fêtes saisonnières parmi lesquelles la Saint-Thomas, Noël, la fête des
Saints-Innocents, la fĂŞte de la Circoncision, les Rameaux et, dans la tradition
populaire, le Carnaval, le Mardi Gras l'Ă©quinoxe de printemps, le premier mai
et la Saint-Martin. Cette liste suggère à elle seule que l'âne a bien joué un
rĂ´le important dans les fĂŞtes communautaires, oĂą il n'Ă©tait pas simplement
associé aux divers travaux des champs mais figurait également au sein du
calendrier qui les ordonnait. L'omniprésence de l'âne dans les diverses fêtes
calendaires de l'Antiquité et du Moyen Âge met en évidence un rapport de cet
animal avec d'importantes périodes de transition La fête de l'Ane fut surtout populaire au XIVe siècle.
L'ânesse de Balaam qui avait prophétisé, le doux
animal qui avait réchauffé de son haleine le petit Jésus grelottant dans
l'étable de Bethléem, l'humble monture qui le porta avec sa mère en Egypte,
celle qui l'amena triomphant dans Jérusalem, étaient identifiés en un seul
personnage qui bénéficiait à lui seul des glorieux emplois de plusieurs de ses
ancêtres. Dans l'octave de Noël, on célébrait, à Notre—Dame de Paris et
ailleurs, un office en son honneur. Chaque antienne était terminée par
l'imitation du braiement de l'âne. « A la
fin de la messe, dit le rituel,- le prêtre tourné vers le peuple, au lieu de
chanter: h'e missa est, braira trois fois ;
l'assemblée, en place de répondre : Deo gratias, répétera : Hinham,
Hinham, Hinham. » Une
prose rimée, dont le texte et la musique sont parvenus jusqu'à nous, exaltait
la destinée de cette pauvre bête de somme. Son accablement, sa résignation sous
le joug ne rappelaient que trop le faix des corvées
et le poids des abus qui courbaient les Ă©paules d'un peuple taillable Ă merci.
Aussi lorsque venait l'instant où, à l'âne intronisé dans la chaire de
l'Ă©vĂŞque, on ofirait dans un boisseau d'or une belle
ration d'avoine mondée, était-ce en grande liesse et jubilation que le bon
populaire entonnait l'hymne : "Orientis
partibus, adventavit asinus"
A la naissance de l'Orient, messire âne était présent. Chaque strophe latine se
terminait par ce refrain en langue vulgaire : « Eh ! sire âne, mais chantez ! / Belle
bouche rechignez : / Vous aurez du foin assez, / Et de l'avoine a planté
(en quantité, pleuty) ». Dans les premiers jours
du carnaval, venait encore la fĂŞte des Fous (Fatuorum).
On l'appelait aussi le Depusuit, d'après ces mots du
Magnificat : "Deposuii patentes de sede et exaltavit humiles. Il a fait descendre les puissants de leur trĂ´ne et
il a élevé les petits." Ce jour-là , on allait prendre dans l'armoire de la
basoche la tiare de carton et la simarre dérisoire du pape des fous. Les
dignitaires du clergé se dépouillaient de leurs insignes, et les derniers
subordonnés, revêtus pour un jour des titres et des ornements des princes de
l'Église, montaient sur le trône. Du haut de ce piédestal et de cette gloire
éphémères ils recevaient les saluts, les génuflexions et l'encens qu'on adresse
tous les jours à des grandeurs non moins illusoires, aussi passagères, aussi
improvisées que la majesté du pape des fous. Peut-être ce renversement de toute
hiérarchie, ce sens dessus dessous de l'ordre établi avait-il une signification
plus haute et plus philosophique encore, et voulait-il exprimer que, pour
prendre une idée juste des dignités de ce monde, nous devrions les considérer
au rebours de ce qu'elles apparaissent: les derniers seront les premiers. C'est
ainsi qu'en optique les objets extĂ©rieurs ne se redressent Ă nos regards qu'Ă
la condition de venir peindre dans la rétine de l'œil leur image renversée Honorius d'Autun, qui écrivait au début du XIIe siècle,
avait fait de l'âne le symbole de la Synagogue ignorante, et obstinée à ne pas
admettre la Vérité Messere Gaster
est l'inventeur de l'hybridation animal (sorte de "discordia concors" cf. plus loin) : Il, par inuention grande, mesla deux
espèces d'animans, asnes et
iumens, pour production d'une tierce, laquelle nous appelionsmuletz, bestes plus
puissantes, moins délicates, plus durables au labeur que les aultres (Livre IV, chapitre 61) Paroles gelées Isolé de son contexte, sollicité par les amateurs de clés
historiques, l'épisode des paroles gelées (chap. 55-56) a servi bien des
causes. Rapide et cependant saturé de références et d'allégories, il semble
disponible à des interprétations sans fin. Sans le priver de sa polyvalence, je
voudrais montrer que, lu Ă sa place, entre la fable des Papimanes
et celle de Gaster, il offre un sens nouveau,
parfaitement net, peut-être privilégié. L'événement est simple : Pantagruel et
ses compagnons, sur leur bateau, entendent des bruits dont l'Ă©metteur n'est pas
visible. Devant le phénomène, deux modes de perception et deux attitudes
interprétatives vont s'opposer ; du même coup s'articulent deux conceptions du
langage radicalement distinctes, mais bien dans le prolongement, l'une et
l'autre, de l'aberration littéraliste et de sa critique. L'énigme est d'abord appréhendée par Pantagruel. C'est
lui qui, toujours à l'affût, entend le premier les voix et qui, pour commencer,
expose son point de vue. Le phénomène physique, qui exercera sur les camarades
une puissante attraction; lui est indifférent : il sert de support à une
réflexion sur les origines du langage, où l'observation n'a aucune part. D'instinct,
Pantagruel lui prête une valeur figurée et formule un commentaire abstrait,
d'une haute portée métaphysique. Il émet quatre hypothèses : les sons
mystérieux seraient issus du Lieu central, le « manoir de Vérité » (chap. 55),
où résident les Idées et les signes originels ; ils perpétueraient les paroles
d'Homère, « voltigeantes, volantes, moventes et par conséquent animées » ; ou celles de Platon
qui, d'abord incomprises, atteignent peu à peu leur maturité ; ou enfin le
chant posthume d'Orphée et de sa lyre, qui éternisent le pouvoir de la poésie
au-delĂ de la mort. [...] Prendre au mot, c'est figer la parole, l'abstraire de son
contexte réel, donc perpétuer l'abus des Papimanes et
autres réducteurs. A quoi s'ajoute la référence à la farce de Pathelin, merveilleusement appropriée dans la bouche de
Frère Jean, puisque « vendre à son mot » (au prix fixe) associe les deux
notions de rigidité sémantique et de valeur matérielle, quantifiable. Les amis
achèvent ainsi l'épisode comme ils l'avaient commencé : fétichistes et
littéralistes jusqu'au bout, ils s'emparent des mots comme d'objets solides et
contraignants. A l'opposé, le narrateur témoigne sa sympathie à la cause de
Pantagruel en jouant, lui, sur les mots, dont il exploite le pouvoir
d'adaptation et de recréation. Sous sa plume, c'est le dégel du vocabulaire, la
libération des sens multiples, ironiquement révélés dans la polysémie du mot mot qui, l'espace de quelques lignes, revêt quatre
acceptions différentes : « prendre au mot », « vendre à son mot », le calembour
« prendre au mot/ membre » et « avoir le mot de la dive Bouteille ». Un langage
mobile se déploie ici dans toute sa vigueur et, aux paroles gelées des
camarades, oppose un désaveu évident. Le même jour, la flotte aborde à l'île de messere Gaster, l'estomac, dieu
tout-puissant et inventeur des techniques (chap. 57-62). Le personnage est
ambigu, tantôt célébré, tantôt réprouvé, et l'épisode divise
depuis longtemps tenants et adversaires du matérialisme, qui trouvent chacun,
dans le texte, d'excellents arguments pour défendre leur cause. C'est qu'ils
négligent l'essentiel : leur perspective est unilatérale et Gaster
est équivoque. Selon une structure rigoureusement parallèle à l'architecture
superposée des Paroles gelées, l'objet du discours présente alternativement
deux visages opposés, selon l'optique où il est placé. Gaster
ne cautionne aucune thèse particulière, mais illustre à son tour l'ambivalence
des signes et la nécessité d'une vision dialectique. La seule différence, c'est
que l'étagement du sens n'est pas assumé ici par les personnages, mais dépend
directement du narrateur. La satire vise peut-ĂŞtre la gloutonnerie des moines, mais
porte bien au-delĂ . Car le texte Ă©tablit nettement que la monomanie des
Gastrolâtres découle à son tour d'une fixation littéraliste : praesentement je le vous diz les larmes à l'œil) ennemis de la croix du Christ, desquelz Mort sera la consommation, desquels Ventre est le
Dieu » (chap. 58). Dans le fragment cité, saint Paul dénonce la secte des « judaïsants », assujettis aux observances alimentaires de
l'ancienne Loi, aveugles Ă la signification spirituelle que le Christ donne au
rituel hébreu. La comparaison est fondamentale : ça n'est pas la goinfrerie, ni
le matérialisme, qui sont en cause, mais le niveau de perception et la
sensibilité aux figures. L'articulation binaire de l'épisode et le thème de
l'ambivalence des signes revêtent pour Rabelais une telle importance qu'après
les avoir formulés en un schéma platonicien, il les souligne encore par une
référence à la typologie chrétienne. Le modèle platonicien sous-jacent dans l'épisode renforce
cette thèse. Nous savons déjà que placer Gaster dans
la mouvance de Penia et Poros,
c'est l'impliquer dans une dialectique et esquisser une identité résultant de
la pondération de valeurs opposées. Mais il y a plus : Gaster
est désigné avec insistance comme « maître des. arts
». Or le maître des arts, selon le Banquet, c'est Amour, en tant qu'il réalise
l'unité du dissemblable. Dans le dialogue, Eryximaque
emprunte la distinction des deux Eros (comme il y aura, ici, deux Gaster) et prouve que l'Amour supérieur est celui qui
maintient l'harmonie dans les corps ; à ce titre, il préside non seulement à la
médecine, mais à la plupart des sciences : agriculture, musique, astronomie,
magie. Dans son Commentaire, Ă travers lequel les humanistes ont lu le Banquet,
Marsile Ficin reprend cette théorie et démontre longuement comment « Amour est
l'auteur et le conservateur de toutes choses » ou encore le « maître et guide
des arts 13 » : par désir de se reproduire et de répandre sa perfection, il
donne la vie aux ĂŞtres, puis maintient leur harmonie en les liant par un amour
réciproque. Les indices convergent donc pour désigner en Gaster
une réplique de l'Amour platonicien. La parodie est évidente, mais n'altère pas
la justesse et la pertinence de l'analogie. Le « bon » Gaster
en ressort plus complexe, plus multiple, principe dynamique d'une création
continue. Ce signe dégelé, affranchi des acceptions restrictives, dont Rabelais
déploie la polyvalence tout au long de la séquence étudiée, le voilà donc
appréhendé, par l'intermédiaire des philosophes, comme un équilibre instable.
Garant de l'harmonie des contraires, Amour exerce Ă la Renaissance une forte
attraction : il fonctionne comme l'un des emblèmes privilégiés de la discordia concors, idéal que
l'humaniste s'attribue volontiers — il cherche à réaliser dans sa conduite le
mariage de qualités antagonistes — et auquel il recourt pour définir l'Un
suprême — fusion de toutes les forces adverses. Edgar Wind a étudié la vogue de
ce motif et de ses innombrables figurations plastiques 1S. Parmi elles, il
cite, à côté d'Amour, les engins de guerre, souvent adoptés comme symboles de
la coïncidence des opposés. Or cette image précise, Rabelais la développe longuement au chapitre 62 : « il inventoit lors art et moyen [...] que les boulletz [...] restassent coy et court en l'air ». Il choisit en outre de faire culminer les vertus de Gaster maître es arts dans son doigté de grand artificier. C'est faire entendre, avec toute la précision souhaitable, que l'estomac, pour qui ne fige pas les signes, réalise en soi la fusion des contraires, accueille des qualités jugées incompatibles et, comme tel, n'exclut aucune identité. Autant le Gaster des Gastrolâtres est aberrant parce qu'univoque, autant celui-ci apparaît, et avec quelle insistance, protéiforme et polyvalent. Gaster et Amour se ressemblent
(nous l'avions perçu dès le début) ; or il y a deux Amours comme il y a deux
musiques ; donc il y a deux Gaster. Au cas oĂą le
lecteur n'aurait pas encore compris, il est invité, m extremis, à reconnaître
dans le texte deux couches de signification et à démêler deux avatars du même
personnage. L'apologue final confirme que le récit, autant que son héros,
lorsqu'ils sont appréhendés comme des réalités simples, sont stériles ou
nocifs, tandis que, chargés de leur polysémie, ils irradient comme des foyers
toujours actifs. D'un bout à l'autre de la séquence, il est question de littérature
autant que de morale et des implications de l'une sur l'autre. Le problème que traite
Rabelais est celui du comportement du récepteur face aux messages extérieurs ou
aux signes : donc un problème d'interprétation. C'est de déchiffrement, ou de lecture,
qu'il s'agit ; en quoi le texte est bien réflexif. A travers l'opposition de
Pantagruel et des littĂ©ralistes de toute espèce, il rĂ©pète la consigne dĂ©jĂ
énoncée dans le Prologue de Gargantua : ne vous braquez pas sur les
significations univoques ; rejetez les grilles qui, mĂŞme polyvalentes, menacent
la fécondité du texte ; cherchez, approfondissez, il y a toujours un au-delà du
sens, qui dépend de votre initiative. Qu'il l'expose ou qu'il l'applique, le
programme de Rabelais comme Ă©crivain demeure au fond remarquablement stable :
garder à la parole, même écrite, son dynamisme et sa créativité, conserver aux
signes leur pouvoir d'expansion. Les matérialistes lui imporrtent
peu ; ceux qui le menacent, et qu'il attaque de front, ce sont les réducteurs
de sens, les exégètes intolérants. Il suffit donc de savoir lire pour invalider
d'emblée et rejeter définitivement toutes les interprétations monovalentes -
même si elles sont légion. Quant au commentaire esquissé ici, il ne saurait
s'achever sans se contester lui-même. A son tour il revient sur soi pour dénoncer
son insuffisance et s'écarter devant la poussée qui suivra le dégel 1562 Dès le début des conflits, les campagnards de la région
parisienne durent subir les passages et les exactions des compagnies de
soldats, appartenant aux deux partis, qu'il fallait nourrir et loger. Au
printemps 1562, après avoir rompu avec la Cour, le Prince de Condé, à la tête
de deux mille cavaliers, prit la direction du Sud, par Palaiseau et Arpajon, et
concentra son armée autour d'Orléans.. Dans la capitale comme dans toutes les
villes fortifiées des environs, on se hâtait de remettre les murailles en état
et d'organiser la défense. Dès le 8 mai, un mois après le manifeste de Monsieur
le Prince, Etampes recevait une garnison de cinq compagnies de cavaliers et
d'une « bande » d'hommes de pied. Afin de ravitailler l'armée royale en
formation, Charles IX ordonnait, le 13, d'inventorier les disponibilités en
vivres et de constituer des magasins. Le bailli, Nicolas Petau,
recevait à cet effet une commission. Prête à la fin du mois, l'armée quitta la
capitale le 31, campa quatre jours à Longjumeau, puis à Châtres, à Etrechy.
Elle s'installa ensuite au Sud d'Etampes, Ă Guillerval,
avant de poursuivre vers le Loire. La ville, en quelques semaines, dut livrer
60 muids de blé en grains, plus de 80 000 pains de munition, 147 poinçons de vin
et verser 2 780 livres tournois. L'ère des réquisitions et des contributions
commençait. A l'automne, renforcé par l'armée d'Andelot,
Condé se décida à marcher sur Paris. Il prit Pluviers (Pithiviers) le 11
novembre. Pour protéger les passages de la Seine, le Roi retira d'Etampes la
garnison qui fit mouvement sur Corbeil, sous le commandement du maréchal de
Saint-André. Attirée par les dépôts de vivres, l'armée protestante
occupa Etampes le 13 novembre. Les ecclésiastiques et les riches bourgeois avaient
fui, les pauvres gens subirent le pillage. Aux alentours, La Ferté-Alais et
l'abbaye de Villiers-Cerny, dont les religieuses
s'Ă©taient rĂ©fugiĂ©es Ă Melun, eurent le mĂŞme sort. HĂ©sitant sur la route Ă
suivre, Condé se dirigea vers Corbeil. La ville fut sauvée grâce à un échevin «
qui se trouva Ă la porte, abbatit promptement le
tapecul, qui fit visage de bois aux ennemis ». Tandis qu'on sommait la ville,
le 17 novembre, l'avant-garde s'installa Ă Essonnes,
le gros de l'armée à Saint-Fargeau, l'arrière-garde à Ballancourt.
Le petit groupe des réformés de Corbeil, animé par le prévôt, Claude Berger, et
un procureur, Jacques Le Roy, tenta en vain de livrer la ville aux assaillants
qui levèrent le siège le 22 novembre. Tout le territoire environnant resta désolé
: « Il ne demeura aucun arbre fruitier
debout, ny maison avec sa couverture » (Jean de
la Barre, Antiquités de Corbeil, 1647). Avec 8 000 hommes, 5 000 chevaux et
quelques canons, l'armée protestante marcha sur Paris. Campant à Juvisy et « ès villaiges de Chastillon, Atis, Mons, Ablon, Villneufve-le-Roy, Orly, Le Thiers (sic), Vittry
et autres villaiges venans
Ă Paris, lezquelz ils ont tous pillez et saccagez,
principalement les esglises », le Prince arriva sous
les murs de la capitale. Mais ses lenteurs avaient laissé le temps aux
Parisiens de se fortifier et l'assaut du faubourg Saint-Victor échoua. « Il
fallut contenter du logement assavoir des gens de pied Ă Montrouge... et Ă
Vaugirard, le prince et l'admiral ensemble Ă Arcueil,
les forces de Guienne à Sceaux, et le reste accommodé
par tous les villages de ceste étendue ». Menacé par l'approche de l'armée
royale de Normandie, Condé leva le camp le 8 décembre. Il était à Palaiseau le
9, à Chevreuse le 10, à Limours le 11, à Saint-Arnoult, « où furent tués
quelques hommes qui voulaient refuser les portes », le 13. Six jours plus tard,
près de Dreux, les princes catholiques battaient les troupes protestantes. Pour
les habitants de la région parisienne, la première guerre de Religion était
terminée. La garnison protestante décampa d'Etampes, la garnison royaliste de
Corbeil fut retirée. La vie reprit son cours. Partout des ruines disaient
l'acharnement de la lutte. Corbeil avait un corps de ville, formé de trois échevins,
élus pour trois ans et renouvelés par tiers chaque année. (Le Paire, Histoire
de Corbeil, p. 78) Pour lors il y avoit quantité de maisons autour de l'Eglise Saint-Nicolas
hors la ville ; les Protestans s'approchèrent de ce costĂ© lĂ , et firent facilement retirer les soldats de Pavan qui estoient sortis Ă
l'escarmouche mais l'un des Eschevins qui se trouva Ă
la porte, abbatit promptement le tapecul, qui fit
visage de bois aux ennemis, et les Arquebusiers qui estoient
sur les murailles de la Ville les contraignirent de se retirer au gros de
l'armée qui se logea aux villages circonvoisins (Jean de La Barre) De là peut-être déplorer ("plaindre, plorer") l'attitude de l'échevin "esleu", cause de la colère des protestants qui n'ayant pu entrer dans la ville saccagent les environs. Point de différence entre les partis : Après le départ
des huguenots de Condé en 1562, aux environs de Corbeil, « il ne demeura aucun arbre fruitier debout, ny
maison avec sa couverture », mais les soldats d'Alexandre Farnèse, appelés
par la Ligue à l'automne 1590, « enlevèrent
tous les bestiaux, vins et grains de la Brie, du Gastinois
et de la Beausse, ils fouroient
tout dedans leurs grands chariots et le portoient
vendre à Paris bien chèrement, et le plat pays demeura vuide
et nettoyé au ballet » (Jean de La Barre) Corbeil. Oignons de Corbueil.
Oignons rouges de Corbeil. (Dit de l'Apostoile.)
XIIIe siècle. On trouve quelquefois des peches,
mais ce n'est qu'un mauvais jeu de mots; voici une des circonstances qui a
donné lieu à cet adage. Il s'agit du duc de Parme, que les auteurs de la Satire
Ménippée ont si joliment plaisanté sous le nom de
Jean de Lagny roi de Brie, duc prétendu de Corbeil et vicomte de Neufchâtel. Ce
prince, qui s'était rendu maître de Corbeil avec beaucoup de peine, fut obligé
de quitter cette ville en une nuit, et comme on le dit fort bien, chap. 10 du
Supplément au Catholicon d'Espagne : «
Enfin, Jean prist Lagny et Lagny Jean, l'un vaut
l'autre... et de ceste gloire s'engendra en luy
l'envie de manger des pesches de Corbeil ; mais il luy cousta bon. Et se voyoit en un mesme tableau la
prise de la dicte ville comme il fist despesche et furent ses gens despechez. »
Quant aux pĂŞches de Corbeil, on dit qu'une ancienne famille de cette ville, la
famille du Donjon, plaçait au-dessus de l'écusson de ses armes une tige droite
surmontée d'une boule. Les Corbeillais s'emparèrent de cet emblème héraldique,
et y reconnurent une pêche; mais on a prétendu que ce n'était qu'une pomme et
même un oignon ; à l'appui de cette dernière explication l'on citait une pièce
du XIIIe siècle dans laquelle certaines villes de France sont désignées par ce
qu'elles avaient de singulier et dans laquelle on trouve oigneus
de Corbeil. Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître, dans le second adage, un
sens ironique qui prouve que déjà au XVIe siècle les pêches de Corbeil n'étaient
plus estimées. Corbeil. Prendre Paris par Corbeil. Brantôme, dans son
Éloge du maréchal de Saint-André, dit que ce dernier n'ayant pu empêcher la
jonction de l'amiral d'Andelot et du prince de Condé,
se jeta dans Corbeil, sachant que l'intention des Huguenots Ă©tait de s'emparer
de cette ville et de prendre Paris par lĂ (comme on
dit en commun proverbe). Capitaines françois, t. II,
p.387 des OEuvres complètes. Pasquier, dans une de
ses lettres (de 1562), rapporte le même fait et il ajoute : « Pour ceste cause court maintenant un
commun proverbe : Prendre Paris par Corbeil, quand après avoir peu venir à chef
d'une petite entreprise on se promet de parvenir à une grande. » La
situation de Corbeil sur la Seine et l'importance de cette situation, d'oĂą l'on
peut facilement empêcher les approvisionnements de Paris, ont donné lieu à ce
proverbe. On disait aussi à propos de quelqu'un qui se trompait lourdememt : Prendre Paris pour Corbeil. « Je retourne chez mon hoste,
lequel en riant, dist que je m'estois
lourdement mesconté, prenant Paris pour Corbeil. »
(Contes d'EUTRAPEL , fol. 95 v°.) XVIe siècle. Le Prince de Condé abusé et l'âne Pendant la trêve qui suit la paix de Longjumeau, le
Prince de Condé, Louis Ier de Bourbon, se retire à Noyers. Il en fuit le 23
août, menacé par les troupes royales, et rejoint La Rochelle avec Coligny le 19
septembre. Ils y retrouvent Jeanne d'Albret et ses Gascons, accompagnée du
sieur de Piles, de ses gentilshommes périgourdins, des cavaliers du sénéchal de
Poitou Fonteraille, puis plus tard par le baron
d’Acier. L’affrontement avec l’armée royale a lieu le 13 mars 1569 à Jarnac.
Blessé durant le combat, Condé tente de se rendre lorsqu'il est assassiné d'un
coup de pistolet par Joseph-François de Montesquiou,
capitaine des gardes du duc d'Anjou appelés les manteaux rouges. Promené sur une ânesse, son cadavre est
l'objet des quolibets de l'armée catholique avant d'être exposé pendant deux
jours sur une table au château de Jarnac Arnaud Sorbin, nĂ© vers 1532 Ă
Montech et mort le 1er mai 1606 à Nevers, un prélat français du XVIe siècle et
du début du XVIIe siècle, écrit dans son Histoire contenant un abrégé de la
vie, mœurs et vertus de Charles IX, Paris, 1574 : La paix longuement traictée à Longeumeau, et
finalement conclue et arrestée, signée, publiée et
enregistrée, fut de telle durée que celle dont parle le prophète, disant : « Il
n'y a point de paix aux meschans. » Car au mois d'aoust certaine mousche piqua ces
bons fidèles et les achemina à La Rochelle et par tout le Poictou;
et brief taschèrent de rechef à surprendre villes, chasteaux
et forteresses, comme Angoulesme, Coignac,
Lusignan, Nyort, Parthenay et plusieurs autres, avec
bonne volonté de pis faire, sans l'empeschement de la
perte qu'ils feirent près de Coignac,le
neufiesme de février, l'an 1569, où M. le prince de
Condé fut tué, plus trompé par la malice et cautèle de ceux qui l'avoient
acheminé à cela que par autre moyen Déjà , chez Ronsard, parmi les autres allocutaires de la Remonstrance figure le prince de Condé (v. 611-758), qui
fait l'objet d'une véritable remontrance dans la remontrance. Chef du parti
protestant, celui-ci est déjà apostrophé dans le Discours (v. 293-306). Dans la
Response, Ă©crite une fois la paix revenue, Ronsard se
défendra d'avoir voulu l'offenser (v. 1059- 1090). De fait, même si Ronsard le
traite sans concessions, comme un ennemi dont la mort est souhaitée (v.
827-835), il reconnaît sa vertu et sa haute naissance (« Prince genereux, race du sang de France
», v. 61 1). Ronsard adopte face à Condé une tactique qui permettait de le
ménager en espérant, tôt ou tard, le ramener dans le giron du parti catholique.
Présenté comme noble et magnanime, il est censé ignorer les exactions commises par
ses troupes : Ce pendant ils vous font un
Roy de tragedie, Exerceant dessoubs vous leur malice hardye,
Et se couvrant de vous, Seigneur, et de vos bras, Ils font cent mille maux, et
ne le sçavez pas [...] (Remonstrance,
v. 635-638). Il s'agissait de rejeter l'essentiel de la faute sur les troupes
de Condé, pour ne pas hypothéquer son ralliement éventuel. Ronsard le
représente entraîné par une « tourbe
mutine » (v. 743), mais évite soigneusement de le compter lui-même au
nombre des séditieux. Notons toutefois que cette tactique avait peu de chance
d'abuser Condé, car il la dénonçait déjà dans une remontrance parue l'année
précédente Dès qu'éclatent les guerres de Religion, au printemps
1562, Ronsard met sa plume au service de la cause catholique et royale. "D'une
plume de fer sur un papier d'acier", il compose quatre longues pièces
d'alexandrins qui déplorent les misères de la France, battent le rappel des
bonnes volontés et stigmatisent les protestants : Discours des misères de ce
temps (1562), suivi de Continuation des discours des misères de ce temps et
Remontrance au peuple de France (1563) puis une RĂ©ponse aux injures et calomnies
de je ne sais quels prédicants et ministres de Genève, qui l'avaient attaqué
pour sa défense du catholicisme. cela sera suivi des
Nouvelles poésies dans lesquelles Ronsard règle ses comptes avec ses
détracteurs protestants Le traitement infâmant du Prince mort exhibé sur un âne a
lieu en 1569, 3 ans après la mort de Nostradamus. Il n'est pas mentionné dans
le quatrain mais correspond au contexte. Ironie de l'histoire prophétique, ou
quatrain Ă©crit par un autre. Il existerait cependant une Ă©dition Ă 7 centuries en 1557 :
Les Propheties de M. Michel Nostradamus Dont il en y à [sic] trois cents qui n'ont encores jamais esté imprimées Lyon, Antoine du Rosne, 1557, in-16, 122 pp. (& 160 pp.) "trompez seront en l'aage" Nous auions dit, que le Roy pouuoit estre trompé en son aage, &
dans ses grandes occupations : cét homme malin
dit : On met en auant l'aage
du Roy, comme s'il estoit en enfance. On est trompé
en tout aage : nous auions
dit que Salomon l'a esté, auec
toute la sagesse que Dieu luy auoit
donnée « tromper en l'aage » voudrait dire tromper un enfant. Ce sont des
enfants qui seraient trompés. Les "trompez... en l'aage"
seraient les rois mineurs, fils d'Henri II et de Catherine de MĂ©dicis, comme
François II et Charles IX. Déjà lors de la conjuration d'Amboise, en 1560, les
protestants avaient voulu retirer le roi à l'influence des Guise catholiques. Longtemps, les tendances les plus radicales, très
minoritaires, ont été sèchement interdites dans les rangs des Français réfugiés
à Genève. Le duc de Soubise, quoiqu'il tienne Lyon contre le gré de Catherine
et Charles IX, n'hésite pas, en 1563, à faire brûler un texte protestant jugé
trop subversif, La Deffence civile et militaire des innocens et de l'Église de Christ. Longtemps, les chefs
révoltés s'abritent derrière une fiction : ils croient ou feignent de croire
que le prince est mal conseillé, trahi par ses proches serviteurs qui lui
cachent ou déguisent la vérité. Tout l'argumentaire du prince de Condé, dans
les années 1560, repose sur le thème du roi captif, que ses vrais fidèles
entrés en révolte entendent libérer de ses geôliers, rendre à lui-même et à la
bonne administration de son royaume, Ĺ“uvrant ainsi en faveur de l'ordre et non
du désordre Les misérables et malheureux entrepreneurs, non contents
des advertissemens que Dieu leur avoit
donnez, tant Ă la bataille de Dreux qu'au recouvrement des citez susdites, qu'Ă
celui du Havre-de-Grace, ausquels lieux toutes les
choses leur avoient dit Ă rebours et Ă contrepoil, encores
attentèrent-ils de venir assiéger pour la deuxième fois leur Roy en son jeune aage, dans sa ville de Paris, mais en vain (Arnaud Sorbin, Vie de Charles IX) |