

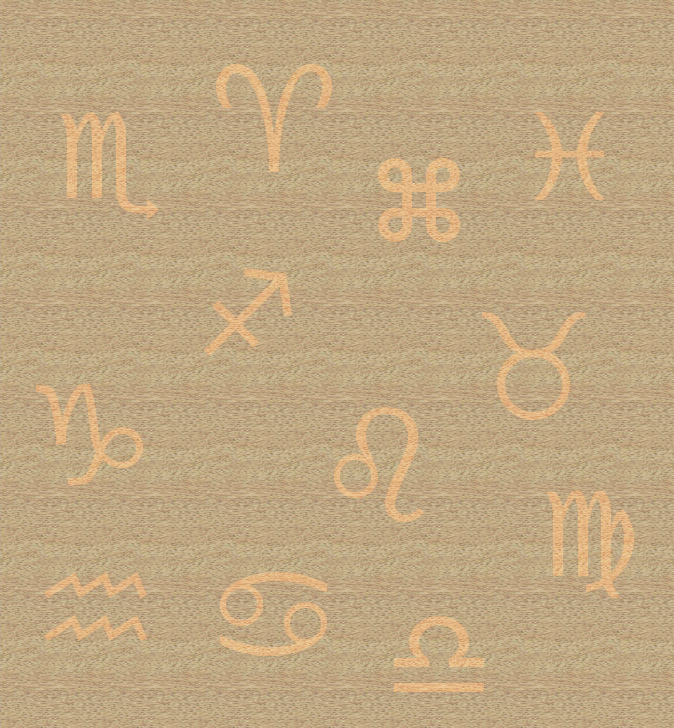
|
Bayonne IV, 41 1808-1809 Gymnique sexe captive par hostaige Viendra de nuit custodes decevoyr
: Le chef du camp deceu
par son langaige Lairra à la gente, fera piteux à voyr. GYMN(O)- est un élément tiré du grec gumnos
«nu, sans vêtements» ou «sans arme», mot ancien qui est représenté dans les
langues indoeuropéennes par des variantes élargies, soit du fait de dissimilations,
soit d'un tabou linguistique (vieux slave nagu, latin
nudus, etc.). Gymn(o)- est
représenté dans des mots empruntés du grec par le latin et dans des formations
françaises. Gymnique adj. est emprunté (1542) au latin gymnicus
«de lutte», puis au grec gumnikôs. Il est substantivé
au XVIIIe s. (la gymnique, 1723) On retiendra la nudité et la grécité. Catherine de
Médicis : "la jeune fille comme toute nue" (Jean Héritier) Alors que dans Florence commençait l'agitation qui devait
avoir une fin si fatale pour les MĂ©dicis d'abord et pour la RĂ©publique ensuite,
le Cardinal Silvio Passerini jugea prudent d'Ă©loigner
de tout danger la jeune enfant du Duc d'Urbin. Il la
fit conduire Ă la villa de Poggio, Ă Gaiano. Les
chefs du parti qui Ă©tait Ă la veille de tenir le pouvoir virent d'un mauvais
œil cet acte du Cardinal, et depuis lors ce parti décida de ne pas perdre trop
de vue la nièce du Pontife. Aussi Bernardo di Jacopo Binuccini,
citoyen de grand renom, fut-il envoyé an Poggio avec des gens armes pour y
prendre Catherine et la ramener à Florence. Aussitôt arrivée, elle ne fut point
reconduite à la maison Médicis, mais elle fut confiée aux religieuses
Dominicaines de Sainte-Lucie, dans la via San Gallo On ramène la fillette-otage à Florence sous la
surveillance d'hommes armés. Ensuite, le
couvent, celui des dominicaines de Sainte-Lucie, et plus tard celui des
bénédictines des Murate, la résidence forcée, presque
une captivité. Non que les nonnes se montrent dures avec l'enfant, mais la
violence des factions déchaînées vient battre les murs du monastère et les
Ă©chos ne peuvent laisser insouciante la fille de Laurent II. Lorsque le pape
Clément VII, qui veut à n'importe quel prix récupérer Florence pour le
patrimoine du clan, s'entend avec Charles Quint afin de maîtriser la révolte, il
confie au prince d'Orange le soin d'assiéger la ville et de châtier les
rebelles. Le drame court autour de Catherine, comme autour des Florentins
encerclés. La famine, les épidémies, les règlements de comptes et les troubles
civils anéantissent la cité et les chefs mutinés en viennent à envisager des
solutions extrêmes pour briser la fillette, dernière des Médicis. L'un propose de la mettre dans une publique,
ce qui empêcherait le pape de marier princièrement une petite fille entachée de
prostitution ; un autre, de l'attacher nue aux murs de la ville, exposée ainsi
aux boulets des assaillants; dernier enfin suggère de la faire violer par les
soldats. D'aucuns, moins «enragés» ou plus prévoyants, craignant un coup de
main destiné à faire évader Catherine du couvent des Murate,
souhaitent pour elle une résidence au cœur de la ville "custodes decevoir" Decevoir : tromper, séduire (Dictionnaire étymologique de la langue françoise, 1829 - books.google.fr). Se pensant
condamnée à mort, l'enfant espère attendrir le peuple, et c'est en habits de
moniale et tondue qu'elle gagne le cloître de Sainte-Lucie. Elle a alors
dix ans, et vient de faire sa première expérience du pouvoir populaire Salvestro Aldobrandini, rejeton
de noble famille, jurisconsulte habile et homme de grand sens, chancelier et
secrétaire intime de la Seigneurie, fut chargé, avec trois commissaires, de
retirer Catherine de MĂ©dicis de chez les Murale et de la ramener Ă
Sainte-Lucie. Les religieuses de ce couvent, ainsi que les frères de Saint-Marc
leurs voisins, s'étaient montrés favorables au parti populaire; l'esprit de
Savonarole vivait encore parmi elles. Accompagné de gardes bourgeoises, Messer Salvestro se rendit au cloitre et demanda à voir l'Abbesse
des Murate. Une confusion et une angoisse
indescriptibles s'emparèrent des nonnes. Il pouvait arriver du mal à l'enfant,
la mort peut-être l'attendait. Salvestro eut grand'peine à accomplir sa mission, et ce ne fut qu'après
un long temps que les nonnes apparurent Ă la grille du parloir avec Catherine.
La petite était habillée en nonne, et, à l'égal des autres, elle s'était fait
tailler les cheveux. L'envoyé lui fit part de l'ordre du gouvernement d'une
voix douce et usa des paroles les plus obligeantes. «Allez et dites à mes
maîtres et pères que je deviendrai nonne et passerai ma vie entière auprès de
ces mères respectables,» lui répondit Catherine. Messer Salvestro
ajouta ce qui lui parut propre Ă agir sur l'esprit de l'enfant et sur sou entourage. Il ne s'agissait (pie de la mettre en lieu
plus sur, car ce cloitre Ă©tait Ă quelques pas
seulement des murs de la ville et risquait d'être trop exposé en cas d'attaque.
Sainte-Lucie, une fondation de sa famille, lui promettait un accueil et un
traitement aussi bienveillants qu'aux Murale; d'ailleurs, n'y avait-elle pas
déjà vécu ? elle devait le savoir par expérience. Mais
rien n'y fit. Aux protestations de Catherine les nonnes joignirent les leurs :
elles entourèrent Messer Salvestro, le suppliant de
leur laisser l'enfant au lieu de l'exposer à une mo;t certaine dans le désordre d'une ville soulevée. Agenouillées, elles demandèrent au ciel le
salut de leur protégée. Aldobrandini, Voyant que les meilleures paroles qu'il
avait pu dire n'avaient aucun résultat, repartit et rendit compte de sa mission
Ă©chouĂ©e Ă la Seigneurie. On fit tenir Ă l'Abbesse l'ordre de se soumettre Ă
la volonté de la Seigneurie. Peu de jours après, le 20 juillet, Messer Silvestro reparut le soir au couvent des Murale. Catherine
pleura amèrement, puis elle se tranquillisa et se montra disposée à mieux
écouter l'envoyé de la Seigneurie. Les exhortations entraînantes de Silvestro et les paroles encourageantes de Messer Antoine
de Nerli qui l'accompagnait firent une impression
salutaire sur l'esprit de la jeune fille. Suivie de ses gens, elle gagna sans
éclat, à dos de mule, le cloître de la Via San-Gallo. Elle y fut reçue cordialement et bien traitée,
et y resta jusqu'au jour où, épuisée plutôt que vaincue, la courageuse Florence
dut mettre bas les armes et se rendre "chef du camp" : Philibert de Chalon, prince d'Orange Ainsi que nous l'avons déjà raconté, Catherine était
demeurée dans le couvent de Sainte-Lucie jusqu'au moment de la levée du siège.
Elle était âgée de onze ans à peine, et cependant certains projets avaient été
déjà conçus pour s'assurer sa main. Ainsi, le capitaine de l'armée ennemie,
dont la fureur s'était déchaînée contre l'infortunée Florence, songeait
sérieusement à une union avec l'héritière des Médicis. Philibert de Chà lons était le cinquième et dernier rejeton mâle de sa
famille qui avait succédé à la maison provençale de Baux dans la possession de
la principauté d'Orange, maison qui s'était éteinte avec Claude sa sœur,
l'Ă©pouse du comte Henri de Nassau, cousin de Guillaume le Taciturne, Ă qui il
était réservé de fonder la liberté de la Hollande. Mécontent de la réception
qu'il avait reçue à la Cour de François Ier lors du baptême du Dauphin, il
était entré au service de Charles-Quint. Le Roi, qui avait envahi Orange, avait
fait prisonnier Philibert, qui ne sortit de la tour de Bourges qu'après le
traité de Madrid, et qui ne recouvra que plus tard sa principauté, dont les
rapports avec la France n'étaient pas bien définis. Ce qu'il possédait dans la Franche-Comté
lui était resté, et il chercha à faire valoir en Italie sa devise : Je
maintiendrai Châlons. Devenu commandant de l'armée impériale après la mort du Bourbon, puis
vice-roi de Naples après celle de Moncada, il briguait une haute faveur et
sollicitait de grosses récompenses. Catherine de Médicis devait lui apporter en
dot la domination sur Florence et peut-ĂŞtre encore d'autres possessions. On
prĂ©tend que lorsqu'en 1529, Orange, en allant au siège de Naples, apparut Ă
Rome, que ses troupes avaient pillée deux ans auparavant, Clément VII lui promit la main de Catherine, quatre-vingt mille écus
d'or comptants, une solde mensuelle payée d'avance, et un impôt de guerre de
cent cinquante mille écus d'or après la prise. On comprend, en connaissant
de tels traités, que les troupes espagnoles, apercevant, des hauteurs d'Apparita, sur la voie Arétine, la belle Florence, se soient
écriées, dans des transports de joie et d'envie : «Prépare tes brocarts, Dame
Florence, nous venons les mesurer avec nos piques.» La promesse de Clément VII
Ă©tait-elle sĂ©rieuse ? Aurait-il consenti, lui qui voulait voir des MĂ©dicis Ă
Florence, à céder ce riche héritage à un étranger ? C'est plus que douteux, car
lors du mariage de Catherine, il la fit renoncer à toute prétention
héréditaire. Les Florentins voyant que le Pape, pour tout préliminaire
d'accommodement, exigeait la liberté de sa nièce, s'aperçurent bientôt qu'elle
servirait facilement de moyen pour parvenir au but qu'ils se proposaient. Il
est donc aisé de concevoir pourquoi ils veillaient aussi soigneusement sur leur
prisonnière. Le sort destinait Catherine à une plus haute fortune que celle
d'appartenir à un seigneur français révolté et condottiere impérial, Le 3 août
1530, près de Gavinana, petit pays à demi caché sous
les épais et magnifiques châtaigniers des montagnes de Pistoia, eut lieu une
rencontre entre la troupe conduite par François Ferruccio
au secours de Florence et les impériaux venus au-devant de l'ennemi, conduits
par Philibert d'Orange. Les deux généraux furent tués. On prétendit, et le
bruit s'en est maintenu, que le prince ne tomba point sous le coup d'une balle
ennemie, mais que sa mort fut le fruit d'une trahison. Ainsi périt le premier
prétendant politique à la main de Catherine de Médicis. Le combat de Gavinana décida du sort de la ville. La capitulation fut
conclue le 12 août Comment commander une armée de mercenaires sans argent ?
Comment prendre Florence avec des troupes qui se mutinent ? Philibert vit en
1529 et 1530 une véritable tragédie : il se sent abandonné par l'empereur
et il ne veut pas être «un capitaine à la fantaisie du pape». [...] Ses lettres
à Charles Quint témoignent d'un désespoir croissant (18 septembre 1529 : "Je
suis l'homme le plus désespéré du monde") "Lairra à la gente fera piteux à voir" Florence, après dix mois de siège et réduite à toute
extrémité par la famine, par des épidémies, par des pertes de toute espèce et
par une misère indicible, ouvrit ses portes. Plus de huit mille citoyens et
quatorze mille soldats avaient péri. Les plus riches aussi s'étaient appauvris,
car, de gré ou de force, ils avaient dû consacrer à une défense opiniâtre les
biens qui leur restaient, endommagés et écrasés déjà par l'excessive cherté de
toutes choses, dans cette ville affamée Lorsque la ville exsangue se soumet, Alexandre, le frère
naturel de Catherine, en reçoit le gouvernement avec l'assentiment de Clément
VII et de Charles Quint. La jeune fille gagne Rome oĂą le pape s'attache Ă lui
concocter de fructueux mariages qui favoriseraient sa politique européenne.
L'alliance française, venant à point nommé pour faire contrepoids à la pesante
amitié du Habsbourg, assurerait au souverain pontife un pied dans chacun des
camps européens. François Ier, de son côté, n'est pas mécontent de posséder en Italie
des appuis, et ceux offerts par la papauté sont prestigieux. La petite Médicis
est renvoyée à Florence pour un an, dans l'attente des
noces qui seront célébrées en France. Duchesse, puis reine. En 1533, Henri
d'OrlĂ©ans a le mĂŞme âge que Catherine : quatorze ans. Il n'est pas destinĂ© Ă
régner, n'étant que le second des fils de François Ier. Ainsi comprend-on mieux
que le père ait organisé pour ce cadet une alliance qui, tout en étant de
grande valeur politique, n'a rien de brillant aux yeux du Gotha de l'Ă©poque.
Les cérémonies nuptiales, qui se déroulent à Marseille, sont somptueuses;
Clément VII, qui a tenu à couvrir de bijoux et de diamants sa petite-nièce,
donne lui-même la bénédiction. L'alliance avec la papauté ne procure finalement pas à la
France les effets escomptés du fait de la mort de Clément VII, survenue l'année
suivante. Le pape Paul III rompt le traité d'alliance et refuse de payer la dot
à François Ier, qui se lamente en ces termes : «J'ai eu la fille toute nue». Au
début de son mariage, Catherine n'occupe que peu de place à la Cour, bien qu'elle
y soit appréciée pour sa gentillesse et son intelligence. Elle n'a pas quinze
ans, ne parle pas bien le français et son jeune mari est plus intéressé par son
amie et confidente Diane de Poitiers Nudité Catherine de Médicis, nièce du pape Clément VII, avait
introduit la vénalité de presque toutes les charges de la cour, telle qu'elle
Ă©tait Ă celle du pape. La ressource utile pour un tems, & dangereuse pour
toujours, de vendre les revenus de l'état à des partisans qui avançaient
l'argent, Ă©tait encor une invention qu'elle avait
apportée d'Italie. La superstition de l'astrologie judiciaire, des enchantemens, & des sortilèges, était aussi un des
fruits de sa patrie transplanté en France. Car quoique le génie des Florentins
eût fait revivre dès longtems les beaux-arts, il s'en
salait beaucoup que la vraye philosophie fût connue.
Cette reine avait amené avec elle un astrologue nommé Luc Gauric,
homme qui n'eût été de nos jours qu'un misérable charlatan méprisé de la
populace, mais qui alors était un homme très important. Les curieux conservent encor des anneaux constellés, des Talismans de ces tems-là .
On a cette fameuse médaille où Catherine
est représentée toute nue entre les constellations d'Aries
& Taurus, le nom d'Ebullé Asmodée sur sa
tête, ayant un dard dans une main, un cœur dans l'autre, & dans l'exergue
le nom à 'Oxiel Clément VII, autre Médicis et ami affectionné, lui
commanda les tombeaux des Médicis et la Bibliothèque de Saint Laurent, qui le
retinrent encore Ă Florence pendant treize ou quatorze ans. Pendant ce laps de temps on ne sait si
Buonarroti a peint quelque chose en dehors de la LĂ©da au cygne Ă laquelle il
travaillait pendant le siège de Florence (1529-30). Ce tableau fut conçu pour
être agréable au Duc de Ferrare qui avait été particulièrement aimable avec
lui, lorsqu'il alla dans cette ville pour y étudier ses célèbres systèmes de
fortification destinés à améliorer la défense de Florence. Par suite de
diverses circonstances, le fait entre autre, que le Duc de Ferrare était passé
aux ennemis de Florence, Michel-Ange donna ce tableau et de nombreux cartons de
la Sixtine à son protégé Antonio Mini pour qu'il pût le vendre en France et
doter ainsi une de ses filles. La LĂ©da
fut achetée par François Ier qui l'avait à Fontainebleau lorsque Rosso,
Cellini, Le Primatice, Nicola dell'Abate y
travaillaient. Elle fut pour leur style le plus remarquable des modèles.
Malheureusement, on la détruisit par déférence pour la pudibonderie d'Anne
d'Autriche et l'éducation jésuitique de ses enfants, dont les précepteurs, peut-être
pour les défendre des excitations sensuelles, s'en prirent à toutes les nudités
féminines qui se trouvaient au Palais royal. La Léda peinte à la détrempe, «avec le souffle de l'esprit» comme dit
Vasari, était accompagnée de deux de ses enfants nés de l'embrassement
de Jupiter sous forme de cygne. La nouveauté de la conception est d'avoir
ennobli la nudité féminine, d'avoir donné à l'attitude compliquée un rythme
de grandeur et d'élégance qui résultent du développement savant des lignes, de
la distribution harmonieuse des plans de lumière "Lairra à la gente, fera piteux à voir" L’action punitive de l’Eternel s’exerce donc en trois
phases, analysées par E. Forsyth dans La Justice de Dieu : «le châtiment
infligé à son peuple pécheur pour le ramener à l’obéissance» (ou action
salvifique), «la vengeance qui sera exercée par Dieu sur les ennemis qui, dans
le châtiment des élus, ont servi d’instruments à sa colère, et le jugement
qu’il rendra quand commencera son Règne». Le critique montre que ces trois
étapes, illustrées par la métaphore récurrente des «verges» punitives,
constituent l’architecture interne des Tragiques. On trouve aussi l’image des
verges de colère sous la plume de Garnier qui l’utilise, comme Aubigné, en
réplique aux angoisses métaphysiques que formulent nombre de ses personnages -
angoisses en Ă©cho avec celles que peut Ă©prouver le public contemporain des guerres
civiles, si ce n’est avec celles de l’auteur lui-même. J.-R. Fanlo dans son édition
des Tragiques (op. cit., vol. I, note de Misères, v. 804, p. 109) et E. Forsyth
(ibid., p. 191) signalent que l’image de la «verge» de courroux, tirée notamment
d’Isaïe (10, 17) et d’Ezéchiel (36,6) est employée, dès 1574, dans le
Réveille-matin des François : «Le Seigneur apres
avoir fouetté ses enfans, jette les verges au feu».
E. Forsyth cite également (ibid., pp. 199-200) un sermon de P. Virey, daté de 1559 : «D’autant qu’il aime plus ses enfans, il prend la verge pour les corriger les premiers,
mais c’est ceste verge des enfans, de laquelle nous
avons desjà parlé. Il prend apres
la verge de fer pour ruyner et destruire
ses ennemis». Ainsi, a réservé Nabuchodonosor, Sédécie
reconnaît devant un prophète, qu’il a «trop justement (ses) peines merité» en suscitant l’«ire» du Seigneur. Mais «pourquoy», ajoute-t-il, Me fait-il torturer par un pire que
moy ? Le Prophète lui révèle alors que le tyran
féroce et impie n’est que l’instrument de la punition de Dieu Comment ne pas
songer, par exemple, à l’anathème lancé par Aubigné sur Catherine de Médicis,
aux vers 802-804 de Misères : Toi, verge de
courroux, impure Catherine, Nos cicatrices sont
ton plaisir et ton jeu : Mais tu iras enfin
comme la verge au feu. Garnier par ailleurs indique très clairement, dans la
dédicace des Juifves, que la rétribution divine,
moteur de l’action, constitue aussi l’élément principal du contenu didactique
de la pièce : le châtiment exemplaire d’un peuple qui s’est détourné de
son Dieu est «un sujet delectable, et de bonne et saincte edification». [...] Il
n’est pas question, chez l’auteur catholique, de séparer les élus des
réprouvés, voués à un Enfer éternel : l’humanité pécheresse tout entière
bénéficie d’un pardon universel, incompatible avec la doctrine réformée de la
prédestination. Les deux premières étapes de la justice divine, illustrées par
l’image des «verges de courroux» , sont décrites dans
une autre pièce de Garnier : Bradamante. L’action de
cette tragi-comédie publiée un épisode du Roland furieux : elle se situe donc
dans le contexte des guerres contre les Maures, que le personnage de
Charlemagne évoque au cours de la première scène. L’empereur interprète les
invasions sarrasines comme la conséquence du courroux divin. [...] Mais pas
plus que le Dieu des Juifves, le Dieu des Francs ne
souhaite la destruction de son peuple ; il veut seulement le corriger : C’estoit fait de la France et de toute l’Europe […] Si Dieu n’eust dessur nous ses yeux de grace ouvers, Et pitoyable pere en nostre mal extreme N’eust à nostre secours levé sa
main supreme. Comme une mere tendre à son enfant petit, Apres l’avoir tancé
pour quelque sien delit, Le voyant larmoyer
de pitié se transporte, Le baise, le
mignarde, et son dueil reconforte
: Ainsi son peuple
ayant nostre Dieu chastié De ses nombreux mesfaits, il en a prins pitié : A regardé ses
pleurs au milieu de son ire, Et piteux n’a voulu le voir ainsi destruire "Et rien tant ne console en vn piteux esmoy, / Que voir vn autre en mesme, ou pire estat que soy" dit
Cicéron dans une autre pièce de Garnier, Cornélie, inspiré
par le Suave mari magno de Lucrèce En italien, puis qu'il est parlé de Florence, "la
gente" désigne un groupe de personnes, des gens. Mais le flateux bonheur, qui conduit son desseins changera de
visage & le lairra soudain, Deliurant
nostre ville, oĂą depuis tant d'annees
Les Dieux ont leurs faueurs prodiguement
donnees "Flateux" : flatteur, trompeur. "Lairra" : laissera, du verbe "laier" (ou considéré comme contraction de "laissera"). Le verbe laisser s'est substitué au verbe laïer, et d'un infinitif laire, analogique de faire, s'est formé le futur lairrai L'intention de Garnier d'être joué est indiscutable. En
1585, il ajouta un paragraphe Ă l'argument de Bradamante :
«Celuy qui voudroit faire representer cette Bradamante...» Certainement il souhaitait que ses
pièces fussent jouées à la Cour ; mais Catherine de Médicis craignait que la
représentation des tragédies ne portât malheur à sa famille, et Henri III
préférait les comédies italiennes : c'est sous les Bourbons qu'on représentera
à la Cour non ses tragédies, mais sa tragi-comédie. Garnier avait soin de faire
nommer les personnages, à leur entrée en scène, soit par un interlocuteur, soit
par eux-mêmes : «toy... exécrable Mégère», «misérable
Porcie», «ton nourriçon
Antoine», etc. Au troisième acte de Bradamante, on
voit paraître un chevalier dont l'identité est ignorée des autres personnages ;
mais, pour que le public la connaisse, il dit son nom dans un aparté : «Hélas,
pauvre Roger...» Dans la même pièce, les adieux de Roger à son cheval de
bataille sont remplacés par les adieux à ses armes, accessoire moins
encombrant. Ces précautions eussent été superflues, si Garnier n'avait pas
songé à la représentation. Il recherche les spectacles pathétiques :
l'hallucination de Phèdre, le baiser au mourant ou au mort, l'apparition de Polymestor et de Sédécie
aveuglés, les gestes de douleur ou de supplication, l'évanouissement d'Hécube,
l'exhibition d'une urne funéraire ou d'un cercueil, celle des cadavres
d'Hippolyte, de Polydore et d'Hémon. Je connais peu de tragédies qui
contiennent des effets scéniques aussi émouvants que ceux des actes IV et V des
Juifves. Par contre, Garnier s'applique Ă supprimer les
gestes ou les spectacles qui eussent été contraires aux bienséances (Hippolyte
empoignant Phèdre par les cheveux, Thésée rassemblant les morceaux du corps de
son fils, Cassandre chantant et dansant) La Pharsale L’influence de Lucain sur Les Tragiques n’est plus Ă
démontrer. Garnier s’inspire aussi, souvent, de La Pharsale. Elle lui fournit
certaines images ou les épisodes de récits où prolifèrent les hypotyposes,
telles que l’évocation, fréquente chez lui, des flots troublés par le sang des
combats. Ainsi, après la bataille d’Actium : La mer rougist de sang, et les prochains rivages Gemirent, encombrez de pieces
de naufrages Et de corps ondoyans, qui furent devorez Des oiseaux, des
poissons, des bestes des forests.
Ces vers reprennent un passage de La Pharsale décrivant
les corps charriés par le Tibre après les proscriptions, qui a également servi
de modèle à Aubigné pour évoquer le «teinct nouveau» des
fleuves chargés de cadavres après la Saint-Barthélemy. Comme Aubigné, Garnier
transpose ses modèles littéraires sur l’histoire récente, qui lui inspire de
nombreux tableaux de massacres La Pharsale contribue au renouvellement de certains
genres, la tragédie, chez Robert Garnier, le poème épique, chez Du Bartas et
Agrippa D'Aubigné. Parmi les historiens et les moralistes, seul Montaigne
accorde Ă Lucain une place de choix, surtout Ă l'Ă©poque oĂą il compose des
essais d'inspiration stoĂŻcienne. Il lui doit quelques comparaisons qui viennent
corroborer sa propre expérience, ainsi que diverses mentions de Caton ou de
César. Pour ce dernier, l'admiration de Montaigne s'atténue à partir de 1580,
et il condamne alors «les enhortemens enragez de
cette autre ame desreiglée»
(III, 1). Du point de vue du style, il place Lucain loin derrière Virgile, et
il le considère comme «abattu par l'extravagance de sa force» (I, 37). Dans
l'une de ses tragédies romaines, Cornélie (1574),
R. Garnier puise le sujet dans La Pharsale, et, tout en modifiant le caractère
de certains personnages, il utilise le texte de Lucain pour rehausser le
pathétique d'une scène ou pour mettre en relief la personnalité d'un héros. Il
atteint une véritable maîtrise dans sa méthode de «contamination». Le récit de
la bataille de Thapsus (acte V) prĂ©sente une couleur Ă©pique qui doit beaucoup Ă
la harangue de CĂ©sar avant le combat de Pharsale (VII, 269-274). Pour les
scènes de siège ou de massacre, il rivalise avec Lucain en réalisme macabre,
sans montrer encore ce souci des bienséances qui, dans les dernières tragédies,
témoigne d'une évolution de son art Education Il suffit presque de parcourir une Vie, quelle qu'elle
soit, pour se persuader que l'Ă©ducation - mieux, la paĂŻdeia,
au double sens propre au grec d'«éducation» et de «culture» - est une
préoccupation dominante de Plutarque. Les indications sur la formation et les
influences scolaires - au sens large - font partie du canevas ordinaire des
premiers chapitres de chaque biographie. RĂ©ciproquement, une place importante
est accordée à la capacité pédagogique des des
entraîneurs de peuples et des «leaders d'opinion» que sont la plupart des héros
des Vies. Enfin, le rang que chacun d'eux vient occuper dans la hiérarchie des
valeurs humaines qui se dĂ©gage de l'ensemble de l'Ĺ“uvre est Ă©troitement liĂ© Ă
la qualité de leur païdeia: plus qu'un souverain
tout-puissant, qu'un grand homme de guerre ou qu'un privilégié de la beauté ou
de la richesse, le véritable héros de Plutarque est un homme cultivé et un
éducateur. La place de l'éducation dans le «canevas biographique» est aussi
imposante que récurrente. Entre tant d'exemples, celui du Spartiate Agésilas
est d'autant plus frappant qu'il est inattendu, s'agissant d'une forme
d'éducation éloignée de la tradition classique... et donc, en principe, des
faveurs de Plutarque: «Agésilas [...] reçut l'éducation ordinaire à Lacédémone,
qui imposait un mode de vie rude et pĂ©nible et formait les jeunes Ă
l'obéissance [...]. Aussi de tous les rois fut-il de loin celui qui vécut dans
la meilleure harmonie avec ses sujets car, Ă une nature de chef et de roi, il
joignait, en raison de son éducation, la simplicité d'un homme du peuple et
l'humanité» (Agésilas I, 2 et 5). Dans beaucoup d'autres cas, grecs et romains,
la référence se fait implicitement au modèle de païdeia
qui s'est dégagé peu à peu à Athènes au Ve et au IVe siècle, s'est constitué en
corpus et répandu dans l'Orient méditerranéen à l'époque hellénistique, s'est
enfin diffusé à Rome et dans l'Occident en voie de romanisation à la fin de la
République. Il s'agit d'un authentique système scolaire divisé en trois degrés:
chez le «pédotribe» (magister ludi),
l'enfant de sept Ă dix ans apprend Ă lire, Ă Ă©crire, Ă compter; chez le
«grammatiste» (terme conservé dans le latin grammaticus),
il s'initie, entre onze et seize ans, Ă l'Ă©tude des grands textes de la tradition
(les «lettres», en latin litterae) commentés, sans
aucune distinction de disciplines, de tous les points de vue possibles : historique,
littéraire, religieux, naturaliste, voire arithmétique. Enfin, à partir de
dix-sept ans, une élite intellectuelle et surtout sociale parachève ses études
auprès du rhetor (ici le latin a calqué le grec),
c'est-à -dire du professeur d'art oratoire. Éducation où dominent l'écrit, la
vénération des textes canoniques (en premier lieu, et de loin, Homère), un
climat d'émulation perpétuelle entre les élèves, mais aussi entre des maîtres
qui sont des salariés (voir l'épisode si diffusé de Thémistocle, X, 5), donc,
dans les mentalités anciennes, inévitablement des «dépendants» (voir Question
romaine 59). Toute cette éducation aristocratique d'esprit «personnaliste»
(Marrou) est orientée vers la formation de l'«homme accompli», auquel la
rhétorique a fait acquérir non seulement une capacité de persuasion personnelle
et politique, mais aussi une forme distinctive de «beauté morale». De cet
arrière-plan se dégagent quatre traits spécifiques, parce qu'ils ont retenu
l'attention de Plutarque ou exercé une influence notable sur son œuvre. Le goût
et la pratique systématique de la comparaison font partie des exercices obligés
de la vie scolaire, à tous les niveaux. En ce sens, les Vies parallèles, dans
leur ensemble, ne constituent pas autre chose qu'un immense «exercice d'école»,
plus particulièrement les Comparaisons, avec leur manière de mettre
systématiquement en compétition (agon) les deux héros
qu'elles confrontent. En deuxième lieu, la tradition grecque de la nudité
athlétique (de gymnos, «nu», vient gymnasion, «gymnase», l'édifice «scolaire» des cités
grecques, où le sport a gardé plus de place dans l'éducation qu'à Rome), cette
tradition qui vaut identification (les Grecs sont ceux «qui font du sport
entièrement nus»), fait scandale à Rome, et Plutarque livre à plusieurs
reprises un témoignage perplexe sur cette situation (Caton l'Ancien XX, 8; voir
aussi les Questions romaines 40, 101, etc.). Troisième aspect: le rôle du père
comme éducateur est nettement plus affirmé à Rome qu'en Grèce, et retient
maintes fois l'attention du biographe: la Vie de Caton l'Ancien en est
l'illustration exemplaire, dans le riche passage consacré à la formation qu'il
donne à son fils (XX, 5-11) ; le traité De l'éducation des enfants, écrit par
Plutarque ou par un proche, développe l'idée que père et fils «doivent être
l'un pour l'autre un miroir» (XX ; Questions romaines 28 et 33). Observons
encore la place du «pédagogue» (grec aïdagogos, voir
Alexandre, V, 7-8; latin paedagogus), cet
accompagnateur répétiteur de l'enfant, en général un esclave - une place qui
devient décisive lorsque le père vient à manquer (voir Caton le Jeune, I-III).
En dernier lieu, Plutarque ne pouvait qu'ĂŞtre sensible Ă l'ouverture de l'Ă©lite
romaine, dès le IIe siècle avant J.-C. (et chez Caton l'Ancien lui-même !
comparer II, 6 et XII, 5), Ă la pratique du grec, en mĂŞme temps qu'Ă la part
prise dans l'instruction supérieure de
ces jeunes gens, à côté de la rhétorique héritière d'Isocrate, par la
philosophie, donc, directement ou indirectement, par la pensée de Platon : on
allait s'instruire en la matière auprès des maĂ®tres grecs, de prĂ©fĂ©rence Ă
Athènes - et l'expulsion de Rome des philosophes obtenue par Caton l'Ancien
(voir sa Vie, XXII- XXIII) est difficile Ă accepter. [...] Pour Plutarque, la
philosophie couronne l'Ă©difice Ă©ducatif (voir De l'Ă©ducation des enfants, 10). Une
large place est faite dans les Vies, notamment celles des conquérants, à cet
aspect de leur formation. Ainsi du Macédonien Alexandre, élevé à la grecque:
«Naturellement, de nombreuses personnes étaient chargées de s'occuper de lui ;
on les appelait parents nourriciers, pédagogues et maîtres» (Alexandre, V, 7;
voir également VII- VIII : Aristote choisi par Philippe comme précepteur de son
fils). Ainsi encore de Lucullus: il «était entraîné à parler fort bien les deux
langues [...]. Dès son adolescence, Lucullus se flattait de posséder cette
culture harmonieuse, que l'on dit libérale, tournée vers la beauté. Sur ses
vieux jours, il offrit Ă son esprit, au sortir de tant de combats, une sorte de
détente et de délassement dans la philosophie [...], réprimant et contenant
fort à propos son ambition, exaspérée par son différend avec Pompée» (Lucullus,
I, 4-6). Pompée encore : Plutarque - c'est une rareté - né nous dit presque
rien de son Ă©ducation ; fait non moins exceptionnel, il s'attarde, en LV, 2 sur
celle de sa dernière femme Cornélia Métella: «Elle avait reçu une belle éducation, étudié la
littérature, la musique et la géométrie, et elle était accoutumée à écouter
avec profit les discours des philosophes.» Mais voici le vaincu de Pharsale au
dernier jour de sa vie, dans la barque qui l'emporte vers une fin sinistre: «Pompée prit, sur un petit rouleau [un volumen sur papyrus], un discours qu'il avait écrit en grec
et qu'il se proposait d'adresser Ă PtolĂ©mĂ©eÂ
et se mit à le lire. Lorsqu'ils furent près du rivage, Cornélie, en proie à une vive inquiétude, regardait avec ses
amis de dessus la trirème ce qui allait arriver; elle commençait à se rassurer,
en voyant plusieurs des gens du roi qui venaient au débarquement, comme pour
faire honneur à Pompée et le recevoir. A ce moment, Pompée prenait la main de
Philippe pour se lever plus facilement; Septimius lui
porte un premier coup d'épée par derrière, au travers du corps; puis Salvius, après lui, puis Achillas
tirèrent leurs épées. Pompée, prenant sa toge des deux mains, s'en couvre le
visage, et se livre Ă leurs coups, sans rien dire ni rien faire d'indigne de
lui, et jetant un simple soupir. Il était âgé de cinquante-neuf ans, et fut tué
le lendemain de son jour natal. A la vue de ce meurtre, ceux qui Ă©taient dans
les navires poussèrent des cris affreux, qui retentirent jusqu'au rivage; ils
se hâtèrent de lever les ancres, et prirent la fuite, favorisés par un bon vent
qui les poussait en poupe : aussi les Égyptiens, qui se disposaient à les
poursuivre, renoncèrent-ils à leur dessein. Les assassins coupèrent la tête de Pompée, et jetèrent hors de la
barque le corps tout nu, qu'ils laissèrent exposé aux regards de ceux qui
voulurent se repaître de ce spectacle.» (Pompée, LXXIX, 2) Catherine avait alors treize ans quand Antonio Soriano,
alors qu'elle était encore à Rome, nous la dépeint comme il suit : «La
Duchesse est dans sa treizième année; elle est très-vive, montre un caractère
affable et des manières distinguées. Elle a reçu son éducation auprès des nonnes
de Florence de l'ordre des Murate , femmes d'une réputation excellente et d'une sainte vie.
Elle est petite Je stature et maigre; ses traits ne sont pas fins, et elle a
les yeux saillants, comme la plupart des Médicis.» Dans la dépêche de l'Envoyé de Florence à la Cour, 27 décembre 1544, nous lisons ce détail remarquable : «La Delfina attende a studiare, ed è tanto litterata, e massimc in greco, che fa stupire ogni uomo.» Négociations de la France avec la Toscane, t. III, p. 140. N'était-ce pas le sang de Laurent le Magnifique qui animait le cœur de Catherine lorsqu'on la voyait faire venir à Paris les manuscrits précieux qui avaient jadis été les trésors de sa maison, lorsqu'elle se faisait une gloire de contribuer au succès et triomphe de l'intelligence, en protégeant l'illustre de l'Hôpital et en honorant l'admirable Montaigne? Mais elle n'avait point apporté cette seule part d'héritage de la nature des Médicis; si nous avons eu à ressentir la douce influence de son goût pour les arts, nous avons eu aussi à subir le mauvais exemple de la dissimulation et de l'esprit d'intrigue en quelque sorte érigés en science d'Etat, ces deux signes distinctifs et pour ainsi dire traditionnels aussi chez les Médicis (Alfred von Reumont, Armand Baschet, La jeunesse de Catherine de Médicis, 1866 - archive.org). Catherine de Médicis savait aussi le grec assez pour étonner
son monde et ses enfants furent instruits par Danès
et par Amyot Education et nudité Rome qui se veut englobée dans l’hellénisme ne peut s’abstraire de toute paideia, de cette éducation à la grecque dont elle refuse la composante pédérastique et l’érotisation des corps mais qu’elle doit cependant accueillir. Cet accueil s’est réalisé sous deux modes, chacun correspondant à une partie de la paideia, en évitant soigneusement ce qui est le point de rupture absolu, la pédérastie pédagogique. Dans Rome, « cité des pères », la transmission du modèle civique et la reproduction sociale ne se font que dans le cadre de la famille, de la génération des pères à la génération des fils. D’autres hommes adultes, étrangers à la famille, ne sauraient interférer dans l’éducation des jeunes gens avant qu’ils ne prennent la toge virile. L’acculturation romaine de la paideia a donc brisé en deux ce système d’éducation : d’un côté les riches Romains cultivés, comme Cicéron, se font construire des gymnases, dans leurs villae du Latium, où ils ne se livreront qu’aux débats philosophiques ornant leurs loisirs amicaux, de l’autre côté les mêmes édifient des établissements de bain, dotés d’une palestre, à leur usage personnel avant que les empereurs offrent des édifices semblables, mais aux dimensions gigantesques, au peuple de Rome. Ces bains le plus souvent appelés « thermae » n’ont aucune vocation à être un espace de transmission des valeurs romaines ; au contraire, ces espaces de plaisir où les Romains se dénudent, sont toujours des lieux dangereux pour leur moralité. Le déplacement terminologique, le gymnase devient des bains, « balneum/balneae » ou des thermes « thermae », va de pair avec une évolution formelle des édifices. Les premiers bains romains se situent au 3e siècle à Stabies. Leur structure inverse celle des gymnases grecs. L’essentiel de l’édifice est consacré aux bains, la palestre désigne une cour à ciel ouvert attenante. Le gymnase grec ne pouvait être adopté tel quel par les Romains pour servir de cadre à la formation miliaire des jeunes gens car il est en contradiction avec le but proposé. Les exercices athlétiques ne peuvent être qu’une « militia leuis », comme dit Cicéron à cause de la nudité athlétique. L’irruption du désir dans un temps voué à l’effort, au labor, paralyse des corps qui doivent afficher leur pudor et entraîne le risque de stuprum, compromettant à jamais leur masculinité et donc leur avenir de citoyen. La nudité est toujours pour les Romains une provocation au désir ; c’est une évidence culturelle. Être nu, c’est être privé de la protection du vêtement, la toge ou la cuirasse, qui signale le statut social de celui qui le porte. Un corps nu est socialement illisible, il ne peut qu’afficher son malaise, voire sa honte. Alors pourquoi les Romains ont-ils construit des gymnases et des bains ? Le comportement de Scipion en Sicile est sur ce point exemplaire. Préparant son armée en vue de la conquête de Carthage, il fréquente le gymnase en sandales et en tunique. Mais il ne le fait qu’après avoir « amplement et longuement fatigué ses bras, lorsqu’il avait contraint tout le reste de son corps à prouver sa fermeté par des exercices militaires ». Ensuite il va se délasser au gymnase grec. Revêtu d’une tunique, il n’y vient pas pour des exercices athlétiques mais pour des divertissements intellectuels qui appartiennent à l’otium. Pour lui le gymnase, bien loin d’être le lieu de l’identité civique, est au contraire celui où Scipion, son devoir de citoyen accompli, peut jouer à faire le Grec. Valère Maxime qui raconte l’anecdote, libère le gymnase grec de sa fonction pédagogique et de ses dérives érotiques, en le réduisant à une activité de loisir. Il légitime ainsi la fréquentation du gymnase par un général romain, capable de s’y divertir sans s’y corrompre. Le changement de fonction du gymnase justifie la transformation architecturale que lui imposent les Romains. « La réduction en peau de chagrin de la palestre à une simple cour attenante aux bains, lisible dans les différents états romains des thermes de Stabies, procède probablement de cette attitude. La schématisation, en Italie, des agencements de plein air complexes qui caractérisaient les gymnases hellénistiques et leur constriction dans l’espace traduisent un projet identitaire, celui de ne pas importer telle quelle une structure aux connotations disqualifiantes » (La formulation est de Pierre Cordier). L’usage des bains, grâce aux dotations somptuaires des
nobles romains puis des empereurs, devient un privilège des habitants de Rome
et par là une marque identitaire de la citoyenneté. Il appartient aux plaisirs
de l’urbanitas, de la vie en Ville.
Privilège civique et quasi politique. Renversement paradoxal. Néanmoins ces
plaisirs continuent à relever de l’altérité incluse : la nudité est
toujours périlleuse et grecque, elle impose aux baigneurs une attitude réservée
uerecundia. Ces bains sont des
espaces voluptueux oĂą toutes les techniques architecturales sont mises au
service du plaisir, en particulier celles qui permettent la sudation, d’où leur
nom de thermae Otages royaux Académie française. 1694 et 1718: ostage;
dep. 1740: otage (sans accent circonflexe pour
marquer la disparition de s intérieur). Vers 1100 «personne livrée ou reçue
comme garantie de l'exécution d'une promesse, d'un traité» (Roland, éd. J.
Bédier, 40) Une fois libéré, le roi de France, otage de l'empereur
après la bataille de Pavie (1525) revenu en France en 1526, reprend la lutte
contre l'empereur. Sa mère, Louise de Savoie, était parvenue à constituer une
ligue contre l'empereur, la Ligue de Cognac, qui se concrétise le 22 mai 1526.
Elle réunissait Henri VIII d'Angleterre, le pape Clément VII Médicis, Florence,
Venise et Milan. Les États italiens souhaitent restaurer l'équilibre entre le
roi de France et l'empereur, devenu trop puissant Ă leurs yeux. Le roi de
France profite également de l'offensive menée à l'Est par les troupes
ottomanes. L'échec du roi de France entraîne le pape à négocier avec
l'empereur. Le 29 avril 1529, ils signent le traité de Barcelone. Le pape
investit l'empereur du royaume de Naples et admet l'annexion ultérieure du
duché de Milan au domaine impérial contre le soutien de l'empereur pour aider
les MĂ©dicis Ă reprendre Florence Avant la paix de Cambrai ou Paix des Dames, des
préliminaires avaient eu lieu à Bayonne en 1529 L'occasion de la paix de Cambrai, événement diplomatique
majeur de la première moitié du XVIe siècle, s'offre ici pour observer à l'œuvre
l'un des négociateurs français, Gilbert Bayard. Homme de second plan, mais dont
l'action est très importante, il est souvent cité, mais demeure fort mal connu.
[...] L'action diplomatique de Bayard s'inscrit sous deux formes. Soit il
apparaît au sein d'une équipe (à Cambrai, en Italie avec Chabot, à Bayonne avec Montmorency), soit il mène
seul une mission : c'est le cas lors de ses déplacements dans les
Pays-Bas, en octobre-décembre 1528, en mai et juin 1529, puis, enfin, à partir
d'octobre 1530. Mais il n'intervient que dans la mesure où il y a une négociation
précise à mener La reprise de la guerre entre François Ier et
Charles-Quint, on n'avait pas discontinué de s'occuper du rachat des enfants de
France retenus Ă Madrid. La paix de Cambrai parvint Ă les arracher Ă leur
captivité ; mais il fut arrêté que le roi de France payerait une rançon de deux
millions d'or, qu'il finirait d'épouser la reine Éléonore, et renoncerait définitivement
à ses prétentions sur Naples, Milan, Jérusalem, la Sicile, les Flandres et
l'Artois. [...] Obligé de payer un à -compte de douze cent mille écus avant de
délivrer les enfants de France, la noblesse, le clergé et le tiers état firent
les plus gĂ©nĂ©reux sacrifices pour rĂ©unir cette somme. Et la rançon s'accumula Ă
Bayonne : «Plus de quatre tonnes de métal jaune contre une reine et deux
enfants» (Jean Jacquart). Lorsque cette condition
préliminaire fut remplie, Anne de Montmorency se rendit à Bayonne (26 mars
1529) avec le cardinal de Tournon, les comtes de Clermont et de Tende, dans le
but de revoir à la fois les enfants de France et la reine Éléonore, qui venait
terminer son mariage, retardé par deux traités consécutifs. Les princes furent
reçus à Andaïe avec d'inexprimables cris d'allégresse
; deux haquenées blanches les conduisirent à Saint-Jean-de-Luz, pendant qu'une
litière somptueuse portait la reine Eléonore. La nuit étant survenue, la
population de Saint-Jean-de-Luz se porta Ă leur rencontre Ă la lueur des
torches, et, le lendemain, Charles, Henri et la fiancée du roi faisaient une
entrée triomphale à Bayonne. François Ier, qui attendait le cortège à Bordeaux
avec la reine mère, le roi de Navarre, Isabelle de Rohan et Marguerite,
s'avança jusqu'à l'abbaye de Captious, près de
Roquefort-de-Marsan, et il revit enfin les enfants délivrés (1530). [...] Henri d'Albret et Marguerite avaient pris
part aux Ă©pousailles du roi avec un sentiment de tristesse bien excusable : le
dernier traité leur faisait perdre tout espoir de recouvrer l'intégralité de la
Navarre ; il ne leur restait que la Basse-Navarre ; car rien n'avait été
stipulé en faveur de leurs droits. [...] Malgré la violence de sa conquête, ce
royaume conservait des privilèges et des libertés si importantes, que son
administration, ses lois et jusqu'à son individualité restaient à peu près les
mêmes. La Castille semblait ne s'être préoccupée que de l'abolition d'une
royauté voisine Après la paix des Dames, la République florentine, alliée
de la France, se retrouve désormais seule face aux Habsbourg. Elle soutient
victorieusement un siège de plusieurs mois mais ses armĂ©es sont dĂ©faites Ă
l'été 1530 et la ville se rend le 10 août 1530. Clément VII et l'empereur, qui
ont fait cause commune dans cette dernière étape de la guerre, proclament la
dissolution de la république, rétablissent le grand-duché de Florence et
mettent Alexandre de MĂ©dicis sur le trĂ´ne Machinerie et deux
ex machina Mon guide, après la fin du règne de Tibère, avait passé
de longues années sans quitter Sperlonga; il
m'affirma que ces installations sises en bord de mer formaient le centre d'un
rituel aulique original, réservé aux seuls proches du Prince. Ce serait le
poète Ovide lui-même, avant son exil, qui en aurait imaginé la scénographie. Les
représentations auxquelles Tibère conviait ses hôtes se déroulaient dans le
cadre d'un véritable deus ex machina. On y mimait des strophes de l'Iliade et
de l'Odyssée. Une machinerie permettait de réaliser des mises en scène
impliquant acteurs, déclamations, chœur des puissances marines, jeux de lumière
avec flambeaux, bruits d'orages et de tempêtes, nuages de fumée ou de vapeur en
guise de brouillard, occultant puis révélant les groupes de Polyphème et de
Scylla. Je ne pus m'empêcher de songer à la phrase de Salluste évoquant «le
fracas du tonnerre, provoqué par des machines, lorsque Metellus faisait
descendre du lambris une statue de Victoire qui venait imposer une couronne sur
sa tête.» En réalité, je compris qu'il s'agissait pour Tibère, à Sperlonga, d'un véritable culte rendu au Héros divin qu'était
Ulysse, modèle de l'homme divinisé, surmontant tous les écueils. C'est à lui
que le Prince, lors de ces cérémonies, s'identifiait pour mieux souligner son
propre caractère surhumain. Il affirmait ainsi sa capacité à diriger l'Empire,
Ă vaincre les forces de la Nature. Ces spectacles mythiques symbolisaient
l'apothéose du Héros, en même temps que celle du souverain. En outre, les installations de ce «théâtre»
emblématique se prêtaient à la prédiction de l'avenir. En effet, les
bassins des quatre viviers prĂ©cĂ©dant l'entrĂ©e de la grotte Ă©taient destinĂ©s Ă
l'ichtyomancie; il s'agit d'une méthode de
divination fondée sur la couleur et le
mouvement des poissons observés, sur leur vélocité et la direction de leurs
déplacements. Le souverain y puisait une connaissance du futur, obtenue par des
techniques analogues Ă celles des auguresÂ
examinant le vol des oiseaux, ou des haruspices scrutant le foie des
victimes, selon les règles de la hiéroscopie, ou même
de l'astrologie divinatoire. J'appris d'ailleurs Ă cette occasion que Claude et
Néron possédaient, eux aussi, des «Grottes de Polyphème» et que le divin
Domitien consultait Ă©galement les signes l'avenir dans un antre semblable Ă
celui de Tibère La plus grande partie de la machinerie antique repose
ainsi sur le levier, sur les ressorts, et sur les mouvements circulaires On connaît les prétendues séances de catoptromancie,
auxquelles Catherine de Médicis aurait assisté, orchestrées par l'astrologue
Cosimo Ruggieri qui lui aurait rĂ©vĂ©lĂ© la succession des rois de France jusqu'Ă
Henri IV. Bayonne, oĂą
Catherine de Médicis rencontre le duc d’Albe en 1565, fut le triomphe du
machinisme. Neptune accourut de la haute mer au-devant du vaisseau du Roi
«sur un char tiré par trois chevaux marins, assis dans une grande coquille
faite de toile d'or sur champ turquin». Déjà , en 1550, lors de l'entrée
solennelle d'Henri II et de Catherine Ă Rouen, l'apparition sur les eaux de la
Seine de déesses et de dieux marins avait eu un tel succès que cette, partie
des réjouissances en avait pris le nom de «Triomphe e la Rivière», mais la
Reine-mère y avait ajouté le chant, la poésie, la musique et l'attrait de
nouvelles difficultés vaincues. La baleine mécanique que l'escadrille royale
croisa dans l'Adour lançait des jets d'eau par ses évents. L'opéra avec ses
décors, ses ballets, ses chœurs, son orchestre et le défilé des figurants donne
une image assez fidèle des spectacles de la Cour. Et c'est en effet de là qu'il
tire son origine. Le Ballet comique de la Reine, représenté aux noces de
Joyeuse en 1581, est le premier essai en France d'une action scénique,
entremêlée de chants, de musique, de danses et illustrée par les artifices du
décor. Ah ! la Reine-mère est une merveilleuse
organisatrice. Elle se souvient de Florence ; de son carnaval esthétique avec
ses troupes de jeunes hommes, vĂŞtus de velours et de soie, qui passaient et
repassaient en chantant des odes et des et des satires ; des cortèges solennels
et des réceptions princières, ces grands jours de décoration improvisée, où,
avec du bois, du plâtre et de la couleur, les rues et les places de la ville
étaient transformées, égayées, embellies par le génie inventif et l'imagination
joyeuse de la foule des architectes, des sculpteurs et des peintres. A toutes ces manifestations d'art qu'elle a
vus de ses yeux ou qu'elle a entendu décrire en son enfance, elle a vus de ses
yeux ou qu'elle a entendu décrire en son enfance, elle emprunte ce qui s'adapte
le mieux aux goûts et aux mœurs de la France et elle y ajoute ce que
permettent en Ă©clat, en richesse, en splendeur les ressources d'un des plus
puissants royaumes de la Chrétienté Les Nymphes étaient nues sous «de fines toiles d'argent à la mode italienne» A Lyon, l'entrée royale d'Henri II et de Catherine de
Médicis en 1548, mise en scène par le poète Maurice Scève, se fit sans
machineries (Bertrand Guégan, Oeuvres
poétiques de Maurice Scève, Garnier, 1927, pp. XXXV-XLVII). En France, l'origine de la Féerie est dans les ballets de
cour du XVIe et du XVIIe siècles, inspirés, en leur
action, par la fable et le merveilleux. D'ingénieux Italiens, appelés par
Catherine de MĂ©dicis, furent leurs premiers introducteurs. Ces habiles gens
Ă©taient de grands distributeurs de prodiges. La cour du grand-duc de Florence
avait été l'école des subtils machinistes et décorateurs, Timante
Buonacorsi, Baldassare
Lancia, Nicolo Tribolo :
ils excellaient à offrir des divertissements compliqués et luxueux Typologie Avec comme date pivot 1529, on reporte 1809 et on a alors
1249. C'est le document
de l'enquĂŞte de 1249 qui fournit le plus clair des renseignements sur ce
conflit totalement ignoré de la «grande histoire», qui suivit de peu l'arrivée
sur le trône navarrais, d'abord contestée, de Thibaud Ier comte de Champagne,
plus célèbre dans la littérature française que dans l'histoire politique :
«Thibaud le Chansonnier», le plus grand «trouvère» de son temps, lié à une
prestigieuse lignée de princes poètes qui remontait à ... Guillaume IX duc
d'Aquitaine, le premier des «troubadours» d'oc. Neveu par sa mère de Sanche
le Fort mort sans héritier en 1234, mais qui l'avait déshérité, il avait eu
quelques difficultés à s'installer sur le trône de Pampelune. Il avait aussi
tenté de réformer les divers «fors», textes des droits et libertés que les
premiers rois de Navarre avaient concédés à la plupart des territoires du
royaume. Des historiens considèrent aujourd'hui qu'il dut accepter les points
de vue et les limites à son autorité que lui imposa l'assemblée des «Cortes» à laquelle tout nouveau roi de Navarre devait prêter serment,
ce qui se perçoit assez clairement dans des articles comme celui des preuves de
l'infançonnie ou noblesse. De là naquit le Fuero
General de Navarra (1237) qui resta, avec quelques
amendements partiels et conjointement Ă la coutume locale propre Ă chaque
vallée, la loi navarraise jusqu'à l'annexion castillane de 1512. D'après les termes de l'enquête elle-même, les hostilités
entre les Labourdins et les Bas-Navarrais se sont développées durant ces mêmes
années. Comme le rappelle le professeur Ricardo Cierbide
dans une étude sur les quatre langues utilisées dans ce document, la situation
des terres de l'actuelle Basse-Navarre (le terme ne sera pas inventé avant le
XVIe siècle) à l'égard de l'ancien comté de Gascogne annexé par le duc
d'Aquitaine au milieu du XIe siècle était, sinon incertaine en droit, du moins
disputée, et pas seulement pour Mixe et Ostabarret
qui relevaient depuis toujours de l'évêché de Dax : le comte de Leicester -
c'est le fameux Simon de Montfort - représentant le duc d'Aquitaine devenu roi
Angleterre depuis le mariage d'Aliénor un siècle plus tôt revendiquait aussi
comme possession du duc-roi Iholdy et Armendaritz et d'autres territoires déjà passés sous
suzeraineté navarraise. C'était en effet tenir pour nuls et non avenus les
serments d'allégeance au roi de Navarre des seigneurs principaux, celui du
seigneur de Labrit seigneur « naturel » pour Mixe et Ostabarret
dès la fin du XIIe siècle, celui de Gramont en 1203 etc., comme le roi de
Navarre le rappellera en tête de ses propres réclamations dans la seconde
partie. La cour de Pampelune attirait depuis longtemps des nobles
labourdins : non seulement Garro de Mendionde, frontalier des pays navarrais d'Ossès, de Hélette, d'Ayherre, mais aussi une branche d'Espelette, dont la maison
éponyme du Labourd avait pourtant conservé son
seigneur propre et fut incendiée par les Navarrais, et d'autres comme «Sanz de Cambo». Ainsi des Labourdins tout au moins d'origine
pouvaient être dénoncés pour leurs méfaits commis contre d'autres Labourdins ou
des Bayonnais, et de mĂŞme pour les Bas-Navarrais, d'autant plus que l'enquĂŞte scellait en 1249 la fin d'une
douzaine d'années d'escarmouches. Les hostilités avaient culminé, après le
double siège de Garro par les Bayonnais, le premier
ayant été interrompu par les Navarrais, avec le véritable raid que Thibaud en
personne mena avec ses partisans pour l'essentiel navarrais et bas-navarrais,
loin en Labourd jusqu'à Saint-Jean-de-Luz et Urrugne d'un côté, Mouguerre. Lahonce, Briscous de l'autre, et
l'avancée en Mixe jusqu'à Came et le siège du château de Gramont à Viellenave. Cet événement se situe en 1244. La rédaction des doléances, de part et d'autre,
fournissait l'occasion de régler bien des comptes et des mécomptes personnels,
les longues années d'hostilité ayant mêlé les meurtres et les faits de guerre
véritables à divers chapardages et exactions de petite envergure, avec tous les
degrés intermédiaires. Si l'on en croit les destructions dénoncées, ici au
détriment des Labourdins, en plus des dizaines de tués, des très nombreux
hommes pris pour être ensuite libérés contre rançon selon la mode du temps, l'armée
royale et les partisans de Thibaud, souvent constitués de familles et fratries de
guerriers (le père et les frères Garro évidemment,
mais aussi les frères Arraidu d'Ayherre,
Soraburu de Saint-Esteben, Nagithurri et Leizarraga d'Ossès etc., nobles et laboureurs mêlés), avaient brûlé des centaines
de maisons, nobles « aulas » ou non « domos »,
surtout à Hasparren et Ustaritz où se trouvaient les deux principaux « castra »
ou châteaux-forts (le Gaztelu d'Ustaritz qui a hérité
en basque de son nom latin castellu, celui de Zaldu, autre latinisme, à Hasparren), scié les vergers,
détruit les outillages, emporté le bétail. S'y ajoutaient les dommages
particuliers qu'avaient subi artisans et marchands bayonnais : prĂŞts non
remboursés, vêtements et outils impayés, denrées perdues (jusqu'à un curieux
«esturgeon» !), soldes réclamés par les marins ayant transporté le roi Thibaud,
ce qui ouvre aussi le chapitre des fonctions portuaires et maritimes de la
ville avec ses «nefs»... Comme tous ces dommages sont calculés en monnaie - dont
la diversité signale la place des échanges extérieurs dans l'activité du port
et du commerce bayonnais : morlans régionaux, sanchetes
navarrais, livres bordelaises, toulousaines, tournois français, poitevins,
parisis, marcs anglais... -, il est aisé d'établir une sorte de « mercuriale »
du milieu du XIIIe siècle : le prix, variable selon son importance et sa
notoriĂ©tĂ© - mais Ă©tonnamment modeste au regard d'aujourd'hui comparativement Ă
celui du bétail -, d'une maison avec tous ses outils, d'un moulin, d'un cheval,
d'un roussin ou d'un âne, d'un bœuf, d'une vache, d'une chèvre, d'un mouton,
d'un cochon et des troupeaux parfois nombreux qu'ils constituent, d'un couteau
mĂŞme et de divers vĂŞtements, Ă©toffes, fourrures et cuirs... Mention est faite des
cultures, avec les vignes, les céréales, blé et froment, mil et avoine, et
surtout les « pommeraies » parfois de plusieurs milliers de pieds, les
pressoirs, les cuves omniprésentes, dans ce pays de cidre évoqué un siècle plus
tôt par le pèlerin de Compostelle Aymeri Picaud, de la présence des volailles et des abeilles :
voilà de quoi dresser un tableau de l'économie régionale qui devrait tenter les
historiens. A la suite et en opposition aux réclamations des
Bayonnais et Labourdins sujets du roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine (voir la
première partie), texte latin parsemé de quelques termes romans, mais aussi de
nombreux toponymes (noms de maisons ou de pays et villages) et de rares surnoms
basques, la dernière section de l'enquête de 1249 qui mettait fin aux hostilités
entre les Labourdins et les Navarrais est rédigée dans le navarro-castillan
de la chancellerie de Pampelune mêlé de gascon et même de vieux français Ainsi à Troyes, capitale
de la Champagne, le tableau vivant de Goliath et David dans l'Entrée royale
de 1484, est suivi d'un tableau représentant un Verger, image traditionnelle du
royaume, mais aussi, par restriction, de la cité, peuplé d'arbres, de fleurs,
d'oiseaux et de jolies filles de la ville qui se réjouissaient, telles les
filles de Sion dit le texte, de l'arrivée de David-Charles VIII. Ces jeunes filles
représentaient également les saintes honorées à Troyes, Sainte-Martisie, Sainte-Maure,
Sainte-Houe, Sainte-Savine, Sainte-Syre et Sainte-Hélène, vierge honorée à Troyes le 4
mai, mais qui est ici assimilée à Hélène de Troie (vers 204-208), ce qui
permet de jouer sur l'homonymie entre Troyes en Champagne et Troie en Asie
Mineure, et enfin sur Troyes et Trinité (vers 225-226). Il faut rappeler ici
que la référence à des origines troyennes est, au Moyen-Age comme au XVIe
siècle, un lieu commun : toutes les monarchies européennes se réclamaient d'un
fondateur venu de Troie. Ainsi Francion après la
destruction de Troie ira fonder la ville de Sicambrie,
puis des habitants de Sicambrie fonderont Lutèce qui
prendra plus tard le nom de Paris en l'honneur de Paris de Troie, tandis que le
pays sera appelé France en hommage à Francion. En
jouant sur l'homonymie de Troie et de Troyes la cité se place ainsi à l'origine
du royaume Des otages,
souvent des femmes, ont joué un rôle important dans les guerres, dans les
combats politiques et dans les alliances entre nations. Ces créatures,
selon la formule célèbre de Giraudoux, sont "les otages du destin"
(La guerre de Troie n'aura pas lieu). Hélène
fut enlevée à l'âge de dix ans et mariée à Ménélas puis Pâris l'enleva à Troie
ce qui devait conduire à un siège de dix ans avant qu'Ulysse par un adroit
subterfuge (d'un type souvent pratiqué par les preneurs d'otages) réussit à en
ouvrir les portes. Dans cette histoire, nous voyons déjà la combinaison chez le
preneur d'otages de motifs personnels et de motifs politiques. L'obéissance
immédiate dont beaucoup d'otages font preuve et le fait que certaines
personnes, peut-être en raison de leur situation, de leur beauté ou de leur
fortune, sont particulièrement destinées à être des victimes, facilitent le
phénomène. Dans l'histoire européenne les traités entre les Etats contenaient
généralement une clause relative aux otages et même pendant la deuxième guerre
mondiale des otages ont été pris pour assurer la domination sur les territoires
occupés Épouse du roi de Sparte Tyndare, Léda inspire la passion de Jupiter. Ayant pris l'aspect d'un cygne,
le dieu la séduit. Après cette union,
elle pond un ou deux œufs (selon les versions) d'où sortent les Dioscures, Hélène (de Troie) et Clytemnestre.
Représentations Le thème de Léda se propage surtout au XVIe siècle. Une
composition perdue de LĂ©onard (v. 1505) semble ĂŞtre Ă l'origine d'une floraison
d'inventions aussi bien peintes que gravées. Les dessins préparatoires de
l'artiste montrent une figure à demi agenouillée qui se relève progressivement (par
exemple, Chatsworth, collection du duc de
Devonshire). Dans une variante peinte par un élève (Neuwied, Prince de Wied) la jeune
femme, en équilibre instable - un seul genou est à terre - est divisée entre la passion amoureuse et sa
nouvelle condition de mère : d'une main, elle caresse le cygne, de l'autre,
elle s'assure de la présence des enfants à peine sortis de l'œuf. Hérité de
Léonard, le type de Léda debout apparaît dans de multiples copies ou
variantes Celle de 1505, conservée aux
Offices, serait une des premières versions d'atelier. Le corps féminin, dont la
forme serpentine fait écho au cou de l'animal, est intégré dans un décor
naturel, entouré d'une multitude de plantes et de roseaux. Le cygne enlace de
son aile droite la jeune femme accompagnée de ses enfants. Peut-être faut-il y
voir une évocation de la puissance procréatrice de la femme. Ce type de Léda
debout avec le cygne à ses côtés inspire surtout les peintres léonardesques. On
le retrouve aussi chez Andrea del Sarto (début du
XVIe siècle, Bruxelles, musées royaux des Beaux-Arts) et chez des sculpteurs
comme Bandinelli (1488-1560, Bargello), Danti (v.
1572-1573, Londres, V & A), ou Ammannati (v. 1560
Londres, V & A). NĂ©anmoins, les artistes montrent souvent l'Ă©treinte avec
Léda assise ou couchée. On assiste parfois alors à une véritable anthropomorphisation
du rapport amoureux. C'est le cas de Michel-Ange, dont le tableau et le carton
originaux (1529-1530) nous sont connus par des versions gravées ou peintes Bayonne, 1808 «La guerre d'Espagne, disait plus tard
Napoléon à Sainte-Hélène, a attaqué la
moralité de mon règne; c'est la source de tous mes malheurs». L'Espagne
était gouvernée en 1808 par le vieux roi Charles IV, prince incapable qui
subissait l'influence toute-puissante du favori de la reine, Manuel Godoï, prince de la Paix. Un parti de mécontents s'était
formé à la cour de Madrid; il avait à sa tête le prince royal Ferdinand, aussi
médiocre que son père, mais populaire comme chef de l'opposition. Tous deux provoquèrent
par leur imprudence l'intervention de Napoléon, qui avait intérêt à entretenir
ces discordes. L'entente parut d'abord régner entre Charles IV et l'empereur au
sujet de la spoliation du roi de du roi de Portugal et du partage de ses États.
En effet, une armée de 25000 conscrits, conduite par Junot, parvint en
traversant le territoire espagnol jusqu'en
Portugal, franchit à marches forcées les montagnes abruptes de la Sierra Estrella, et occupa Lisbonne sans résistance; le prince
régent, qui gouvernait au nom de sa mère Maria atteinte de folie, la famille
royale et toute la noblesse avaient Ă peine en le temps de s'embarquer pour le
Brésil (novembre 1807). En même temps, sous prétexte de médiation, des troupes
françaises, commandées par Murat, occupèrent tout le pays entre les Pyrénées et
l'Ebre et s'avancèrent même jusqu'à Madrid. Saisi de crainte, Charles IV voulut
s'enfuir dans ses colonies d'Amérique.
Mais une insurrection dirigĂ©e contre GodoĂŻ Ă©clata Ă
Aranjuez (mars 1808). Charles IV dut disgracier son favori et abdiquer en
faveur de Ferdinand VII. Encouragé secrètement par Murat, il protesta contre
cette abdication qui lui avait été arrachée par la force. Napoléon attira alors
les deux souverains Ă l'entrevue de Bayonne et les contraignit de renoncer l'un
et l'autre au trône après une scène violente Napoléon mande à Talleyrand, qu'il tenait à afficher dans
son emploi de confident : «Cette tragédie est au cinquième acte; le dénouement
va paraître». Ce dénouement, suivant les règles classiques, sera fait par le
destin, c'est-Ă -dire par l'implacable logique des passions et l'aveuglement des
personnages qui se pousseront eux-mêmes à la catastrophe où ils s'abîmeront
tous ensemble. Il était fatal, mais la fatalité en fut ignominieuse. Les
Bourbons s'avilirent; Napoléon s'abaissa. Il préparait «un immense, un éclatant
coup d'État», Ă la Corneille; plus peut-ĂŞtre, une lieutenance de Dieu mĂŞme, Ă
la Bossuet : «Je voulus agir comme la Providence qui remédie aux maux des
mortels par des moyens à son gré.» Ce ne
fut qu'une misérable représentation de province : un théâtre de
sous-préfecture, une troupe d'opéra-bouffe, piteuse sous les oripeaux. Napoléon
demeura le dieu de la machine, sans doute; mais de l'Olympe eschylien,
d'oĂą il se flattait de lancer la foudre,Â
il tomba dans les dessous de Beaumarchais. Et il se fit lui-mĂŞme, pour
l'ironie de l'histoire, le chroniqueur et le critique implacable de sa pièce et de sa troupe. «Je
me suis rendu chez le roi Charles, Ă©crit-il ; j'y ai fait venir les deux
princes. Le roi et la reine leur ont parlé avec la plus grande indignation.
Quant Ă moi, je leur ai dit : Si d'ici Ă minuit, vous n'avez pas reconnu votre
père pour votre roi légitime et ne le mandez à Madrid, vous a serez traités
comme rebelles». Le jour même, Charles IV, par une convention en forme, céda
tous ses droits à Napoléon ; Napoléon garantit l'intégrité du royaume et
le maintien exclusif de la religion catholique. Ferdinand Ă©crivit Ă Madrid :
«La junte suivra les ordres et commandements de mon bien-aimé père...» En
qualitĂ© de prince des Asturies, il adhĂ©ra Ă la cession faite par son père Ă
Napoléon La Léda du Corrège peinte vers 1530, comme celle de
Michel-Ange, a vécu toutes sortes de pérégrinations. Elle sera décapitée par le
fils du Régent Philippe d'Orléans révulsé par sa posture lascive, subit une
prise de guerre en Prusse par Dominique-Vivant Denon avec la Grande Armée en
1806 et rendue Ă ce dernier pays Ă la Restauration Buonaparte florentins Trois principales familles originaires respectivement de
San Miniato, Sarzane et
Trévise ont porté le nom de Buonaparte mais il n'est pas possible de prouver un
lien généalogique entre elles. Gustave Chaix d'Est-Ange (Dictionnaire des
familles anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, tome 5) précise que par
un acte du 28 juin 1759 les Bonaparte de Corse se firent reconnaître officiellement
parents par les Bonaparte de Florence, issus de ceux de San Miniato :
«Cette reconnaissance, étant antérieure à la grande fortune des Bonaparte de
Corse, était assurément bien désintéressée de la part de ceux de Toscane.
Toutefois on ne doit y attacher qu'une importance relative ; on sait, en effet,
combien les actes de ce genre, dictés uniquement d'ordinaire par la
complaisance ou par la courtoisie, ont peu de valeur en matière généalogique
quand ils ne sont pas appuyés sur des preuves sérieuses» Napoléon nu Les guerres de la Révolution et de l'Empire vinrent
entraver l'essor que les bains de mer commençaient à prendre. Napoléon avait
pourtant trouvé le temps de prendre quelques bains de mer a
Biarritz, en 1808, alors qu'il était en route vers l'Espagne: «pendant tout le
temps qu'il restait dans l'eau, un détachement de cavalerie de la garde
éclairait la mer en s'y avançant aussi loin qu'il était possible de le faire
sans trop de périls» (Souvenirs d'un officier polonais ; scènes de la vie
militaire en Espagne et en Russie (1808-1812), par le général de Brandt ; Paris, Charpentier, 1877, p.
11). Dès 1812, on a construit à Dieppe, sur le bord même du rivage, un petit
établissement «où l'on peut prendre des bains de de température» La propreté de Napoléon est connue et la baignoire fait
partie des objets mythiques de l'Empereur au mĂŞme titre que le chapeau ou la
redingote. [...] Napoléon s'y plonge tout nu - il n'a pas la pudeur du temps -
et y reste de longs moments |