

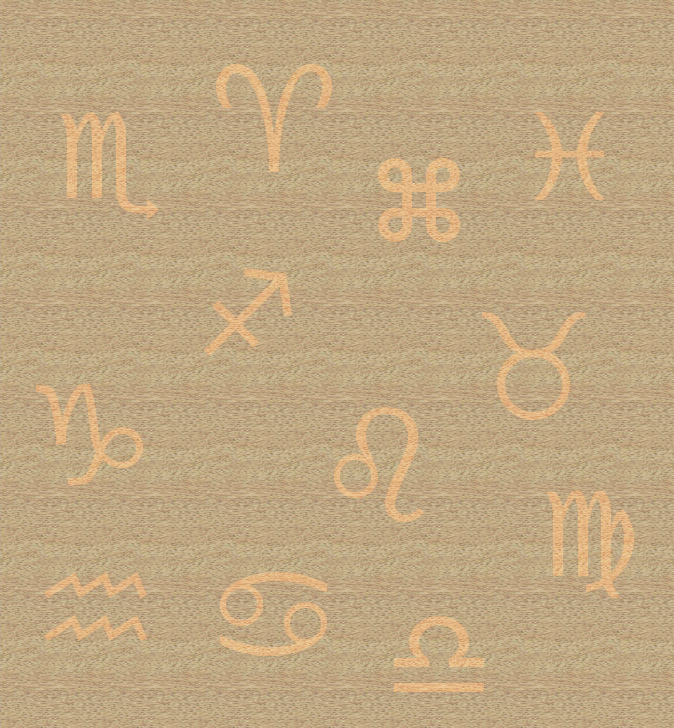
|
Ordo neglectus et duc d'Osuna I, 73 1611 France à cinq pars par neglect
assailie, Tunys, Argiels esmeus par Persiens, Leon, Seville, Barcelonne faillie, N'aura la classe par les Venitiens. L'université et la
division en 5 Au moyen √Ęge, le mot universit√©, universitas,
désignait toute espèce de communauté, mais il finit par être spécialement
r√©serv√© √† la communaut√© des ma√ģtres et des √©coliers de Paris. Cette communaut√©
qu'une tradition fabuleuse voulait faire remonter jusqu'au règne de Charlemagne
fut constituée en 1200 par une ordonnance de Philippe Auguste, concédant aux
écoliers de Paris divers priviléges, entre autres
celui de ne pouvoir être arrêtés par les officiers du roi, à moins de flagrant
délit ou de crime énorme, et de ne pouvoir être jugés que par les tribunaux eccésiastiques. En 1215, des statuts lui furent donnés par
le l√©gat du pape, Robert de Cour√ßon, cardinal de Saint-√Čtienne. Ses privil√©ges, confirm√©s √† diverses reprises, furent augment√©s
en janvier 1341 par Philippe de Valois, qui accorda aux écoliers et aux membres
de l'Universit√© l'exemption de la taille, des p√©ages et autres imp√īts, le privil√©ge de ne pouvoir √™tre traduits devant d'autres juges
que ceux de Paris en affaires personnelles, etc. L'Université était divisée en quatre Facultés : arts
(sciences et lettres); théologie ; droit canon et civil ; médecine. La Faculté
des arts était composée de quatre nations.
La nation de France, divisée en cinq provinces ou tribus : dictes de Paris,
de Sens, de Rheims, de Tours et de Bourges. La
province de Paris comprend les diocèses de Paris, Meaux et Chartres ; celle de
Sens, ceux de Sens, Orléans , Nevers, Vienne, Lyon, Troye,
Auxerre, Bourgogne, Besançon et Savoye; celle de Rheims,
ceux de Rheims, Thou, Metz , Senlis , Ch√Ęlons, Verdun et Soissons ; celle de Tours, ceux de
Tours, Mans, Angers, de Saint-Brieu, de Saint-Mallon ou Saint-Malo, Dol, Nantes, Leon, Rennes, Vannes, Triquet et Cornouaille ; et celle de
Bourges, ceux de Bourges, Toulouse, Poitiers, Auch, Arles, Embrun, Espagne,
Arménie, Médie, Syrie, Samarie, Lombardie, Venise, la Pouille,
Bordeaux, Narbonne, Avignon, Aix, et les nations de Romanie, Egypte, Perse,
Palestine, Italie, Gênes, Naples, Sicile et autres, non comprises toutes les
autres provinces. La nation de Picardie, était divisée aussi en cinq
tribus. Il y avait encore : la nation de Normandie; la nation d'Allemagne,
divisée en deux tribus : celle des continents, subdivisée en deux provinces et
celle des insulaires, comprenant les Iles britanniques. Le chef de l'Université
était le recteur, qui était élu par les quatre Facultés tous les trois mois ;
et pour son installation il se faisait une procession avec grande pompe.
L'organisation de l'Université de Paris, la première en date, fut adoptée (sauf
pour l'enseignement du droit canon et du droit civil o√Ļ l'on prit pour mod√®le Bologne), par toutes celles qui
s'élevèrent ensuite, soit en France, soit dans le reste de l'Europe.
L'universit√© de Paris joua un r√īle consid√©rable au moyen √Ęge dans les affaires
politiques et religieuses; elle d√©fendit avec opini√Ętret√© ses privil√©ges, et plus d'une fois, pour obtenir justice, elle
suspendit ses leçons; la dernière interruption eut lieu sous Louis XII. Au
XIIIe siècle, elle engagea contre les ordres mendiants et les dominicains qui
avaient institué trois chaires de théologie, une lutte fort vive, à la suite de
laquelle elle fut forcée de céder et de les admettre dans son sein. La part
très-grande qu'elle prit dans les querelles des Bourguignons et des Armagnacs
et la servilité qu'elle montra lors de la domination anglaise à Paris, firent
sentir la nécessité d'une réforme qui eut lieu en 1452 et qui fut opérée par le
cardinal d'Estouteville, assisté de plusieurs membres du Parlement. L'influence
politique de l'Université ne reparut que dans les guerres religieuses du XVIe
siècle, surtout durant la Ligue dont elle embrassa la cause avec ardeur. Ce fut
là sa dernière immixtion dans les affaires de l'Etat. Elle eut, vers le même temps, un long procès à soutenir
contre les jésuites qui demandèrent en vain à lui être agrégés, mais obtinrent
d'ouvrir des établissements d'éducation en concurrence avec les universitaires.
Elle fut supprimée en 1790 (Ludovic
Lalanne, Dictionnaire historique de la France, Volumes 1 à 2, 1877 -
books.google.fr, Charles
Richomme, Histoire de l'Université de Paris, 1840 - books.google.fr). Procès entre l’Université
de Paris et les Jésuites Un jeune homme de dix-neuf ans, élevé dans l'un de leurs
collèges, d'un caractère sombre et fougueux, livré à tontes les déhanches de la
jeunesse, Jean Chatel enfin, fatigu√© de √Įa vie,
d√©sirant en sortir par une action d'√©clat qui lui val√Ľt une r√©compense
immortelle, se souvint des sermons de ses maitres, et résolut d'assassiner
Henri IV. On sait comment le bon Henri, en se baissant pour embrasser un
officier qui arrivait de la campagne, au lieu du coup mortel, ne reçut qu'une
blessure légère. L'assassin saisi, interrogé, fut reconnu pour un écolier des
Jésuites. Toute la France poussa un cri d'effroi. On mit des gardes au collège
de Clermont, on fouilla les chambres, les papiers; on trouva, chez le Jésuite
Guignard, des écrits injurieux au roi de France et à tous les princes. On y
louait l'action de Jacques Clément, assassin de Henri
III, et l'approbation qu'y avait donnée le Jésuite
Bourgoing. Henri III était appelé un Sardanaple, un
Néron, Henri IV un renard de Béarn, la reine d'Angleterre une louve, le roi de
Su√®de, un griffon, l'√©lecteur de Saxe, un porc. Il √©tait dit que ¬ęle B√©arnais
serait trop heureux d'être mis dans un monastère, pour y faire pénitence, que si
on pouvait lui faire la guerre, il fallait le faire, que si l'on ne le pouvait
pas, il fallait l'assassiner.¬Ľ Le crime de Jean Chastel, et la d√©couverte des
papiers de Guignard, décidèrent du sort de la société en France, et mirent fin
à un procès en instance depuis trente ans. Les Jésuites fuient chassés, par
arrêt du parlement en date du 29 décembre 1604, confirmé par un autre du 21
ao√Ľt 1597. Gu√©ret, professeur de philosophie, fut mis √† la question; Guignard,
par arrêt du 9 janvier 1595, condamné à être pendu en place de Grève, et il fut
ordonn√© que son corps serait br√Ľl√© et r√©duit en cendres. Une pyramide fut
élevée à la place de la maison qu'occupait l'assassin, et des inscriptions
furent destin√©es √† perp√©tuer la m√©moire du crime et du ch√Ętiment. Ce monument
subsista jusqu'en 1605 ou 1606, que les Jésuites, rétablis en France, eurent le
crédit de le faire abattre. [...] Le meilleur des hommes et des rois, Henri IV, tomba, le
10 mai 1610, sous le couteau de l'inf√Ęme Ravaillac. Des soup√ßons qui n'ont
jamais été vérifiés, s'élevèrent alors contre les Jésuites; on ne les crut pas
généralement étrangers au crime qui plongeait la France dans le deuil et dans
les larmes. Les visites que le P. Cotton rendit à l'assassin, les recommandations
qu'il lui fit de bien se garder d'accuser des innocents; le silence d'un P.
d'Aubigny, autrefois confesseur de Ravaillac, et à qui ce monstre avait confié
que, pendant la nuit, il avait des songes, et pendant le jour, des apparitions;
la doctrine régicide du Jésuite Mariana, qui avait été publiée sous le règne de
Henri IV; bien des circonstances encore qui paraissaient co√Įncider, firent
na√ģtre d'affreuses id√©es; cependant, on ne v√©rifia rien, et un √©v√®nement qui
devait changer totalement la position de la France, ne fit qu'améliorer celle
des Jésuite. Sous le gouvernement faible et chancelant de la reine-mère, ils
obtinrent, le 20 ao√Ľt 160, de nouvelles lettres-patentes beaucoup plus √©tendues
que celles de 1609. Il leur fut accordé de faire leçons publiques,
non-seulement de théologie, à quoi Henri IV avait restreint la permission, mais
encore ¬ęen toutes sortes de sciences et exercices de leur profession, audit
collège de Clermont, observant par eux les règles de l'édit de septembre 1605,
et autres d√©clarations et r√®glements faits depuis icelui.¬Ľ Le pr√©texte all√©gu√©
pour accorder cette permission, √©tait l'utilit√© qu'il y a ¬ęque les enfants
√©tudient √† Paris, o√Ļ le langage fran√ßais est plus pur et plus poli qu'ailleurs,
joint qu'en étudiant, ils apprennent insensiblement les formes et les façons de
vivre qu'il faut observer √† la cour et suite du roi.¬Ľ Le 27 du m√™me mois, les
Jésuites firent signifier les lettres-patentes au recteur de l'Université, Etienne
Dupuis, ajoutant ¬ęqu'ils en poursuit vraient l'ent√©rinement et v√©rification en la cour du
Parlement.¬Ľ Le proc√®s se trouva ainsi r√©engag√©, et les J√©suites n'annon√ßaient
pas, cette fois, le dessein de l'abandonner. Ils travaillèrent à gagner
quelques-uns de leurs adversaires, et se firent plusieurs partisans dans les
facultés de droit et de théologie, mais la grande majorité de l'Université se
prononçait toujours hautement contre eux. Après plusieurs délais et remises, la
cause fut appelée, le 17 décembre, devant les trois chambres assemblées, et fut
plaidée avec la plus grande solennité. Montholon, avocat des Jésuites, après
avoir cherché à éviter un jugement que ses clients semblaient solliciter avec
le plus grand empressement, forcé de plaider, parla pendant une demi-heure au
plus, et conclut par demander l'enregistrement pur et simple des
lettres-patentes. [...]   La Martelière, qui portait la
parole pour l'Université, rappela que c'était pour la troisième fois que ce
corps célèbre venait réclamer, contre les Jésuites, l'autorité du Parlement,
pour assurer ¬ęle repos, la condition, la vie de nos rois, de nos princes, de
l'Universit√© et de la post√©rit√©¬Ľ; qu'√† la premi√®re approche de ces P√®res, on n'ouit retentir, dans le sanctuaire de la Justice, que des ¬ę
prophéties de leur intention, qu'ils voulaient confondre tout ordre politique,
d√©praver les lois divines et humaines., etc.; qu'on eut. ¬ęd'abord
de la peine à le persuader, mais que ces prédictions ont été autorisées par les
√©v√©nements.¬Ľ [...] Les crimes de Cl√©ment, Barri√®re, Chastel, Ravaillac, leur
furent imputés par l'avocat, aux adversaires qu'il combattait; la conspiration
des poudres, les troubles excités à Venise et dans plusieurs autres endroits,
furent rappelés. La Martelière finit par exhorter le
Parlement à ne pas se laisser surprendre par les promesses que feront les
J√©suites de remplir les conditions qu'on leur imposera. ¬ę Ils promettront et
jureront toutes ces conditlions, dit-il, puisque rien
ne peut les obliger par leurs propres constitutions.¬Ľ [...] Le lendemoin du plaidoyer de La
Martelière, le recteur de l'Université, selon le
privilège de sa Compagnie, fit un long discours en latin. Cette pièce, qui a
été imprimée, et qui subsiste encore, est de la plus liante éloquence el d'une
pureté digne de Cicéron. Il reclama avec fermeté
l'appui du Parlement, et. dans un beau mouvement
oratoire, il représenta l'Académie expirante, implorant, contre la mort, le
seul secours qui lui reste. Ce recteur, si illustre par son éloquence et son
grand caractère, se nommait Pierre Hardivilliers.
[...] Les plaidoieries des avocats et
le discours du recteur, employèrent trois audiences. Le quatrième jour, les
gens du roi portèrent la parole, par la bouche de Servin,
premier avocat-général. Ce magistrat représenta que, dès le commencement du
procès, il avait engagé les Jésuites à s'en tenir aux termes de leur
rétablissement. Il donna connaissance du refus qu'avaient fait plusieurs
d'entre eux, et notamment le P. Fronton, de signer, sans équivoque ni évasion,
quatre propositions rédigées par la Sorbonne : les trois premières, regardant
la s√Ľret√© de la personne des rois, l'ind√©pendance absolue de leur autorit√© pour
les choses temporelles, l'assujétissement des
eccl√©siastiques, comme des la√Įcs, √† cette autorit√©; la quatri√®me, concernant
les libertés de l'église gallicane. [...] Après cet exorde, Servin entra
dans le fond de la cause, et, abondant dans le sens de l'avocat de
l'Université, il ajouta de nouveaux reproches à ceux dont celui-ci avait déjà
chargé la Compagnie, il attaqua l'institut dans ses constitutions, dans ses
privilèges, dans la conduite de ses membres, dans la doctrine de ses
théologiens et dans les écrits de ses casuistes, déclara adhérer à l'opposition
de l'Universit√©, et finit par requ√©rir qu'il f√Ľt fait d√©fense aux J√©suites ¬ęde
faire leçons publiques, ni fonctions scholastiques, pour l'instruction des
enfants, ni d'autres en cette ville de Paris, jusqu'à ce qu'autrement en soit
ordonn√© par la cour, sous telle peine qu'elle advisera.¬Ľ
Enfin, le 12 décembre 1611, survint un arrêt qui appointa
les parties au conseil, et provisoirement fit ¬ęinhibitions et d√©fenses aux
demandeurs de rien innover, faire et entreprendre au préjudice des lettres de
leur rétablissement et de l'arrêt de vérification d'icelles; s'entremettre, par
eux ou personnes interposées, de l'instruction de la jeunesse en cette ville de
Paris, en quelque façon que ce soit, et d'y faire aucun exercice ou fonction de
scholarité à peine de déchéance du rétablissement qui
leur a √©t√© accord√©, d√©pens r√©serv√©s.¬Ľ Ainsi se termina cette affaire, en
laissant encore en suspens le point litigieux. Cet échec ne fut pas le seul que reçut
la Société, cette année et les suivantes; les Jésuites n'étaient pas en bonne
veine au commencement du dix-septième siècle. Le livre de Mariana De rege et régis institutione, les
ouvrages de Bellarmin, Becan, Suarez et autres,
furent censurés par la Faculté de Sorbonne, condamnés par le Parlement et
livrés aux flammes, avec défense d'introduire en France des écrits contenant
une aussi pernicieuse doctrine. L'université de Louvain renouvela ses censures
contre les thèses des Jésuites Lessius et Hamélius. En Bohème, un décret du conseil souverain, rendu
du consentement de tous les ordres du royaume, chassa les Jésuites, comme
perturbateurs du repos public, comme voulant assujétir
au Siège de Rome, tous les états dans lesquels ils étaient admis, et semant
perpétuellement la discorde et la mésintelligence. La Moravie, à l'exemple de
la Bohème, les bannit la même année, de ses terres et dominations, mais les
Jésuites surent rentrer dans ces deux états et y reprendre leur crédit. L'arrêt de 1611, outre les dispositions que nous avons
rapportées, ordonnait que les Jésuites, établis en France, déclareraient être
unis de doctrine avec la Sorbonne, et signeraient les quatre propositions que
leur avait présentées l'avocat-général Servin. Quand
leur procès eut été perdu pour eux, ils ne se pressèrent pas d'obéir à cette
injonction, mais voyant que l'Université, non contente de leur avoir fait
fermer leurs écoles, poursuivait l'exécution de l'arrêt dans toutes ses
parités, et parlait de demander leur expulsion, ils crurent devoir parer le
coup, en faisant la déclaration qui leur était commandée. En conséquence, les
PP. Balthazard, provincial ; Jacquinot, supérieur de
la maison de St.-Louis; Fronton, Jacques Sirmond et Faconius, assistés de
leur procureur, présentèrent au greffe du Parlement, un acte portant
qu'obéissant à l'arrêt de la cour souveraine, ils déclarent qu'ils sont
conformes à la doctrine de Sorbonne, même en ce qui concerne la conservation de
la personne sacrée, des rois, manutention de leur autorité royale et libertés
de l'église gallicane de tout temps, et ancienneté, gardées et observées en ce
royaume.¬Ľ Cette soumission, √† laquelle les J√©suites n'avaient
accoutumé personne, leur fut beaucoup plus profitable qu'ils ne l'avaient
imaginé peut-être; ils recueillirent de cette humiliation passagère, des fruits
qu'ils étaient loin d'en attendre, et le crédit qu'ils eurent dans les états
tenus en 1614 et 1615, fut pour eux une assez belle récompense (Charles
Laumier, Résumé de l'histoire des Jesuites depuis l'origine jusqu'à la destruction
de leur société, 1826 - books.google.fr). Pierre de la Martellière Pierre de la Martellière que
d'autres nomment de la MARTILLIERE, célébre avocat au
parlement de Paris, & ensuite conseiller d'état, étoit
originaire du pays du Perche, fils de François (ou Pierre) de la Marteliere, lieutenant général au bailliage du Perche à Bellesme. Pierre vint à Tours dans le temps que le
parlement de Paris y siégeoit, & il y suivit le
barreau, o√Ļ il se fit estimer & rechercher. Pendant quarante-cinq ans qu'il
exerca la profession d'avocat, il se fit un si grand
nom, que Antoine Bruneau le place au rang des Arnaulds,
des Loysels & des autres qu'il proposoit pour modéles aux
avocats dc son temps. Il a été avocat du prince de Condé, des comtes de
Soissons, pere & fils & de plusieurs autres
grands feineurs. En 1611, il plaida avec beaucoup
d'éclat la cause de l'université de Paris contre les Jesuites, qui sollicitoient leur rétablissement. Son plaidoyer fut
imprim√© en 1612. in-4¬į. & a √©t√© reimprim√© plusieurs sois depuis. La m√™me ann√©e on publia
sur ce plaidoyer un écrit intitulé : Avis sur le plaidoyer de Pierre de la Marteliere pour les recteur & opposans de l'univerfié de Paris,
contre les Jésuites, par Paul Gimont, sieur d'Esclavoles,
√† Paris, in-4¬į. On a encore de P. de la Marteliere
plusieurs autres plaidoyers qui ont été imprimés. Un jour plaidant une cause
pour M. le Prince de Condé contre le duc de Guise, & ayant reproché au
dernier ce qu'il avoit fait pour la ligue, M. de
Guise s'en irrita, & au sortir de l'audience, il le menaça. Peu de tems après, ayant été nommé pour se trouver à un arbitrage
qui regardoit M. de Guise, & n'ayant pas voulu
s'y trouver, M. de Guise qui en sçut la raison, lui
fit dire qu'il pouvoit venir en toute sureté. La Marteliere alla en effet au lieu marqué; & dès qu'il
entra, M. de Guise vint au-devant de lui, l'embrassa, lui protesta qu'il lui donnoit son amitié, & le pria d'oublier la menace qu'il
lui avoit faite. Lorsque M. de la Marteliere
eut été fait conseiller d'état sur la fin de ses jours, il ne laissa pas de
continuer à suivre le barreau & de consulter. Après sa mort, arrivée depuis
l'an 1631, l'univerfité de Paris lui fit faire par M.
Tarin, professeur d'éloquence, une épitaphe qu'on peut lire dans les opuscules
de Loysel : elle finit par qualifier le défunt,
Princeps patronorum, & patronus
principum. M. de la Marteliere
avoit épousé demoiselle Marie le Grand, fille
d'Alexandre le Grand, conseiller au parlement, dont il eut entr'autres
enfans, deux fils, qui ont été successivement
conseillers au parlement : l'a√ģn√© fut re√ßu en 1629. & mourut en 1631, avant
son pere : le second fut reçu en 1632. Voyez l'éloge
de Pierre de la Marteliere dans les opuscules de Loysel pag. 606. & 607.
Bruneau dans son traité des criées, &c. Le pere
d'Avrigny Jesuite, dans ses
Mémoires chronologiques & dogmatiques, tom. 1. pag.
131. dit que le plaidoyer de la Marteliere feroit honneur au plus vieux professeur de rhétorique, tant
il y a de figures de toutes les sortes, & de traits de l'ancienne histoire
rassemblés. On pense bien qu'à l'égard du fond de ce discours, il n'en juge pas
si favorablement (Nouveau
supplement au grand dictionnaire historique, genealogique, geographique,
&c. de M. Louis Moreri, pour servir a la derniere
edition de 1732. & aux precedentes. Tome 2 : H-Z, 1749 - books.google.fr). Les ouvrages de Caussin, Richeome et Garasse appartiennent pour leur part à la
rh√©torique des j√©suites de Cour, cette rh√©torique ¬ętoute peinte et dor√©e¬Ľ selon
Guez de Balzac, qui cherche avant tout à stimuler
l'imagination de l'auditoire. A l'inverse, Du Vair ou
Jacques de Montholon proposent un modèle épuré des citations en langues
anciennes, une éloquence qui cherche à convaincre sans faire inutilement appel
à l'émotion. Guillaume du Vair, en particulier,
propose à ses lecteurs de s'inspirer du modèle cicéronien de
l'orateur-magistrat. Plus encore, il érige en idéal l'orateur attique incarné
par Périclès et Démosthène, à la fois censeur et pédagogue du peuple, véritable
¬ęmonarque spirituel¬Ľ. Cet id√©al s'inscrit dans un contexte particulier, celui
des guerres de Religion. Il a pu appara√ģtre comme un mod√®le de rh√©torique
¬ęgallicane¬Ľ en opposition avec le mod√®le j√©suite (Michel
Cassan, Offices et officiers "moyens" en France à l'époque moderne:
profession, culture, 2004 - books.google.fr). Fait remarquable, le sénéquisme
philosophique de Du Vair ne l'empêche pas d'être cicéronien en matière de style
dans le trait√© De l'√©loquence fran√ßaise. Parmi les onze √©ditions de ses Ňďuvres
publiées entre 1606 et 1641, la plus complète est celle de 1625. Les études sur
Guillaume Du Vair comme orateur politique restent peu nombreuses. On se
référera essentiellement à R. Radouant, Guillaume Du
Voir, l'homme et l'orateur jusqu'à la fin des troubles de la Ligue, Paris,
1907. L'Age de l'Eloquence de M. Fumaroli (Genève, 1980) contient un long
passage consacré à Du Vair (Richard
Crescenzo, Le traité De l'éloquence francoise de Du Vair
(1594) : une réponse à la position de Montaigne sur l'éloquence, Montaigne et
Henri IV (1595-1955): actes du colloque international, 1996 - books.google.fr). Jacques de Montholon fut l'avocat des Jésuites au
troisième procès face à l'Université de Paris. Il ne partageait donc pas le
style des jésuites de Cour. "assailie" : saillies A première vue, c'est à la même tendance (l'atticisme sénéquien) qu'appartient Montaigne. Lui aussi relève de la
rhétorique savante des citations et cherche à la faire évoluer. Lui aussi ne
veut plus se contenter d'être comme ses collègues du Palais, un médiateur
impersonnel entre l'Antiquité, dépositaire du Logos originel, et un public
savant. Il a, au plus haut degré, conscience de son ingenium
personnel. Mais il joue sur deux langues, alors que Lipse ne peut jouer
qu'entre deux états - classique et tardif - de la langue latine. Si les
citations latines balisent, dans les Essais, une quête de la vérité, c'est
seulement en contrepoint d'une invention en langue vulgaire qui prétend puiser
ses ¬ę conceptions ¬Ľ directement √† travers un ingenium
moderne, aux sources de ¬ęnostre mere
Nature¬Ľ. La v√©rit√© que recherche Montaigne n'est plus celle, m√©taphysique et
juridique, du Juge-Législateur, mais celle de l'homme-Protée, telle que la
protéique Nature le lui révèle à travers son propre moi-Protée. A la découverte
de cette vérité fuyante concourent, comme chez les savants de la République des
Lettres, inspiration et érudition. Mais l'une se veut toute naturelle et
l'autre n'intervient que comme confirmation de la première : à la différence de
ce qui se passait dans les Remonstrances ou chez
Lipse, le témoignage des Anciens chez Montaigne n'a pas valeur de preuve supérieure
√† celle des voyageurs m√ģodernes ou √† celle de
l'auteur, observateur de soi-même et du monde. Aussi le style de Montaigne
n'obéit-il pas, comme celui de Lipse, à une manière uniforme, toute tendue à
faire croire que les ¬ęsaillies¬Ľ de l'ingenium
co√Įncident toujours avec les ¬ę oracles ¬Ľ de l'Antiquit√©. ¬ęLibre¬Ľ, se laissant
conduire par un ingenium démonique, le style de
Montaigne est fidèle au protéisme qu'il veut
manifester : tant√īt comique, tant√īt sublime, tant√īt sententieux,
tant√īt p√©riodique, tant√īt √©loquent, tant√īt dialoguant, il r√©ussit pourtant √†
faire triompher une unité de ton, et à imposer la présence constante d'une
identité personnelle vigoureuse. C'est la leçon la plus précieuse que l'anti-cicéronien
Montaigne lègue à l'atticisme classique (Marc
Fumaroli, L'Age de l'√©loquence : Rh√©torique et ¬ęres literaria¬Ľ de la
Renaissance au seuil de l'époque classique, 2002 - books.google.fr). Seneque plus ondoyant et divers. [...] Seneque est plein de poinctes et
saillies (Livre II, chap. 10) (Michel
de Montaigne, Essais, Tome 1, 1833 - books.google.fr). Rhétorique : quinquepartitus et ordo neglectus Montaigne ironise
sur le soin méticuleux avec lequel Cicéron marque les divisions de son discours,
et il observe : ¬ęPour moy... ces ordonnances
logiciennes et Aristot√©liques ne sont pas a propos¬Ľ
(II, 10, p. 393 a; 1 10). Il loue S√©n√®que et Plutarque¬† d'avoir √©crit ¬ę√† pieces
descousues¬Ľ et de pouvoir √™tre lus de m√™me,
ce qu'il s'empresse d'appliquer √† lui-m√™me : ¬ęJe prononce ma sentence par
articles descousus, ainsi que de chose qui ne se peut
dire √† la fois et en bloc¬Ľ (III, 13, p. 1054 b; 376). Solidit√© et
spontan√©it√©, voil√† son affaire, non la composition charpent√©e ¬ęMoy qui ay plus de soin du poids et utilit√© des discours
que de leur ordre et suite¬Ľ, note-t-il-au d√©but d'une de ses ¬ędigressions¬Ľ (II,
27, p. 678 c; 498). La négligence de la
forme et de la tenue, l'ordo neglectus, répond, il
est vrai, au go√Ľt de l'√©poque, dans les arts plastiques, la po√©sie, la vie
mondaine. On avait appris depuis le XIVe siècle à priser le charme du
laisser-aller. Une lettre de Pétrarque esquisse l'esthétique de l'habitus neglectior, par opposition au magnus
cultus (Familiares, XVIII,
7). Castiglione met au nombre des qualités qui distinguent l'homme du monde
accompli l'aptitude à la sprezzatura (Cortegiano, I, 26). On reste sensible au bel effet des negligenze artifici jusqu'au
Tasse (Jérusalem dél. II, 18). Il y a sans doute là des
réminiscences d'Horace et d'Ovide, dont certaines recommandations vont dans le
même sens. C'est en outre une vieille habitude d'auteur que de se présenter
avec une modestie affect√©e¬Ľ (E. Norden) et protester
de son incapacité a écrire
avec art. Mais on n'irait pas loin si on voulait rattacher l'autoportrait de
Montaigne uniquement à cette mode et à cette manière rhétorique. [...] Ecrivain,
il s'abaisse au moyen de ces formules traditionnelles de modestie dans le même
but qu'il poursuit en s'humiliant, comme homme et philosophe, par la formule de
la miseria hominis. Il
s'est servi de ces formules littéraires pour caractériser sa propre réalité et
le développement illimité dont elle était capable. Il recourt à la forme
ouverte de l'ordo neglectus, qu'il semble déprécier, encore
qu'il en reconnaisse la gr√Ęce (I, 28, p. 181 a; 238), parce qu'elle est
l'expression naturelle de son image du n'est que changement, le caractère
antinomique de la vie, l'homme complexe, inconstant, interdisent un régulier
qui ferme les ouvertures, ramène le multiple à un seul aspect, enjolive
l'imparfait (Hugo
Friedrich, Montaigne, 1984 - books.google.fr). Or "quinquepartitus" est un terme rare employé par Marius
Victorinus dans ses Explanationes in Ciceronis rhetoricam : Le livre VI de Martianus
Capella est expressément consacré à la géométrie, mais en réalité, la
quasi-totalité de son contenu traite de géographie, et ce sont seulement les
dernières pages qui abordent la matière de la géométrie - du reste sans grande
ambition, car les développements sont réduits à l'énoncé des définitions
fondamentales, d'après la tradition euclidienne. Vers la fin du livre, donc, le
§ 716 présente un texte évidemment parallèle à celui de Proclus. On lit en
effet : ¬ęMais toutes les figures (de raisonnement, alors que Martianus parle avant et apr√®s de figures g√©om√©triques) se
développent en cinq  parties, que les
Grecs désignent de la façon suivante : la première "protasis",
la deuxième "diorismos", la troisième
"kataskeuè", la quatrième "apodeixis, la cinquième "sumperasma".
En latin, nous pouvons donner les traductions suivantes : la première,
proposition de la figure, la deuxième, 
détermination de la question, la troisième, disposition des arguments,
la quatri√®me, d√©monstration et preuve de l'id√©e, la cinqui√®me, conclusion¬Ľ. Par rapport √† Proclus, il manque la deuxi√®me √©tape
l'"ekthesis". Martianus évolue en réalité
dans le double domaine de la géométrie et de la dialectique-rhétorique, et l'on
peut m√™me dire que son vocabulaire est plut√īt celui de ces deux derni√®res disciplines.
On s'en convaincra mieux si l'on se reporte à un passage qui traite nettement
de rhétorique chez Marius Victorinus, et dont la numérotation des parties
présente un parallélisme étonnant avec celle de Martianus,
traduisant sans doute une influence sur ce dernier, même s'il y a quelque
variation dans la terminologie: Quinquepartitus itaque est qui constat ex membris
quinque, id est prima propositione,
secunda eius probatione, tertio. adsumptione,
quarta eius probatione, quinta conclusione (Marius
Victorinus, Explanationes in Ciceronis
rhetoricam 1,10, copié ensuite littéralement par
Isidore de S√©ville, √Čtymologies 2,9, 18) (Jean-Yves
Guillaumin, Les six "ordres" de la démonstration géométrique,
Bulletin du Cange: archivum latinitatis medii aevi consociatarum academiarum
auspiciis conditum, Volumes 61 à 63, 2003 - books.google.fr, fr.wikipedia.org -
Marius Victorinus). Avec ses considérarions
géométriques et géographiques, les "cinq parts", qui devraient être
six, annoncent les six c√īt√©s de l'hexagone fran√ßais. S√©ville ou Sicile Brind'Amour corrige S√©ville
(toutes éditions) en Sicile. La monarchie continuait à vivre, en vertu de ses
traditions bureaucratiques, sous un roi aussi indolent que le père avait été
appliqué, et pour qui la dévotion n'était plus une raison d'agir. Avec
l'av√®nement de ce Philippe III, vrai ¬ęfin de race¬Ľ, a commenc√© le r√®gne des
favoris ou validos. Au centre, √† Valladolid, o√Ļ la
cour s'est retirée par économie après les folles dépenses des mariages de
famille d'Albert avec l'infante Isabelle, du roi avec Marguerite d'Autriche, le
vrai ma√ģtre est don Francisco de Sandoval, marquis de
Denia, fait duc de Lerma, tra√ģnant apr√®s soi une
famille d'intrigants, accapareurs de titres et de richesses. [...] De même que
Lerma mène l'Espagne, un véritable triumvirat se partage l'Italie : Pedro Tellez Giron, duc d'Osuna, dit el
grande, vice-roi de Naples, qui ne craignit pas de s'attaquer à la flotte
vénitienne, de soulever contre la république en Dalmatie les Uscoques, et qui tombera sous l'accusation (sans doute
forgée à Venise) de vouloir se faire roi de Naples ; don Pedro de Toledo,
marquis de Villafranca, gouverneur de la Lombardie ;
Alfonso de La Cueva, marquis de Bedmar, ambassadeur à
Venise. [...] Cette Espagne déjà si atteinte entreprend de régler
définitivement la question des Morisques, à Valence et en Aragon. Les vieilles
accusations renaissent : celle de conserver secrètement les rites de l'islam, celle
de s'entendre avec les pirates, à qui une flotte sicilienne commandée par
Jean-André Doria a failli prendre Alger, celle aussi de pactiser avec la France
(Henri
Hauser, La pr√©pond√©rance espagnole 1559‚Äď1660, 2019 - books.google.fr). Pour la chasse aux Morisques voir quatrain I, 77. Pour lutter contre les corsaires barbaresques, l'Espagne
organise des expéditions à Malte en 1611, Tunis en 1612 et au Maroc en 1614. Elle
profite aussi de l'accalmie des guerres en Europe pour construire un réseau
d'ententes. Le double traité de 1612, rendu effectif en 1615, négocié avec la France,
prévoyait le mariage d'Isabelle de France avec l'infant Philippe et d'Anne, la
sŇďur de ce dernier, avec Louis XIII, fr√®re d'Isabelle (Jean-Paul
le Flem, Gilbert Larguier, Jean-Pierre Dedieu, Les monarchies espagnole et
française au temps de leur affrontement: Milieu XVIe siècle - 1714. Synthèse et
documents, 2013 - books.google.fr). En 1612, le marquis de Santa Cruz, avec les galères de
Naples, attaque la Tunisie; Osuna (1611) et le général Octavio d'Aragon (1613),
d√©vastent la c√īte berb√®re et d√©barrassent Malte de la menace turque Du c√īt√©
Atlantique, Luis Fajardo, capitaine général de
l'armée de l'Océan, s'empare de la Mamora au Maroc (Michel
Devèze, L'Espagne de Philippe IV, 1621-1665: siècle d'or et de misère, Tome 2,
1970 - books.google.fr). Mais pendant cette période de paix relative, des
trouble-fête se manifestèrent. Charles-Emmanuel Ier s'empare entre 1613 et 1617
du duché de Montferrat avec l'aide du maréchal de Lesdiguières sur le plan
militaire et de la république de Venise sur le plan financier. Le duc d'Osuna,
Pedro Giron, qui a de restauré la flotte de galères de la vice-royauté de
Naples aide les Albanais Uskoks dans leurs raids de
piraterie contre les bateaux vénitiens (1615-1618). Il est désavoué par Madrid
et rappelé en 1620. Osuna et le gouverneur de Milan, Pedro de Toledo, de même
que Bedmar, ambassadeur à Venise, sont persuadés que la Sérénissime est hostile à l'Espagne. En mai 1618, Bedmar et le poète Francisco de Quevedo, agent d'Osuna,
accusés de conspiration doivent fuir la République (Jean-Paul
le Flem, Gilbert Larguier, Jean-Pierre Dedieu, Les monarchies espagnole et
française au temps de leur affrontement: Milieu XVIe siècle - 1714. Synthèse et
documents, 2013 - books.google.fr). Osuna se trouve près de Séville en Andalousie. C'est le
fief des ducs d'Osuna. Pedro Terez-Giron, duc
d'Osuna, fut vice-roi de Sicile et de Naples. On lui prête l'intention d'avoir
voulu s'en faire son propre royaume avec la complicité de Venise et de la France.
Une hostilité simulée avec Venise aurait été le prétexte pour Osuna de recruter
des mercenaires et des soldats pour arriver à ses fins. Il est aussi mêlé à une
conspiration contre la République vénitienne. Il s'attira l'inimitié des
j√©suites de Naples pour leur avoir refuser de lever un imp√īt √† leur profit. Il
refusa d'établir l'Inquisition dans le royaume de Naples (Pierre
Antoine Bruno Daru, Histoire de la république de Venise, Tomes 5 à 6, 1840 -
books.google.fr). A l'av√®nement de Philippe IV (1621), le duc d'Osuna fut enferm√© au ch√Ęteau d'Almeida, o√Ļ il demeura
jusqu'à sa mort en 1624 (fr.wikipedia.org
- Pedro Tellez-Giron y Velasco). On lui attribue, dans un recueil d'anecdotes du
dix-septi√®me si√®cle, une plaisanterie : ¬ęLe duc d'Osone
promit mille pistoles aux Jésuites, s'ils lui faisoient
voir qu'on p√Ľt donner l'absolution par avance d'un p√©ch√© non encore commis.
Après avoir bien cherché, ils lui apportèrent un de leurs auteurs, et lui
donnèrent l'absolution qu'il demandoit. Il leur donna
une lettre de change à recevoir à quatre lieues. Ils trouvèrent en chemin douze
dr√īles qui les battirent et leur prirent la lettre de
change. lls vinrent se plaindre au duc, qui leur dit
que c'était là le péché qu'il avait envie de commettre et qu'ils l'en avoient
absous (Tallemant des Réaux) (Le
Tour du monde: nouveau journal des voyages publie sous la direction de Edouard
Charton et illustre par nos plus celebres artistes, 1873 - books.google.fr,
Gédéon
Tallemant Des Réaux, Les historiettes, Mémoires pour servir à l'histoire du
XVIIe siècle, Louis-Jean-Nicolas de Monmerqué, Hippolyte de Chateaugiron, Tome
5, 1834 - books.google.fr). Le poète Quévedo, ami et
conseiller du duc, tomba en disgr√Ęce avec lui. Pour avoir d√©pos√© un pamphlet
sur la serviette du roi Philippe IV, il est enfermé de 1639 à 1643 dans un
cachot du couvent San Marcos à Leon (dans la province
de Leon), prison mis√©rable et humide, o√Ļ sa sant√© se
dégrade : il y perd la vue. Quand il est libéré en 1643, Quevedo est un homme
affaibli, qui se retire dans ses terres de Torre de Juan Abad.
Il part ensuite s'installer √† Villanueva de los Infantes, o√Ļ il meurt le 8
septembre 1645 (fr.wikipedia.org
- Francisco de Quevedo y Villegas). Avant sa disgr√Ęce, le duc d'Ossuna fit venir sa femme,
son fils et leur suite à Naples. Ils embarquèrent à Barcelone (Gregorio
Leti, La vie de P. Giron, duc d'Ossuna, vice-roi de Sicile et de Naples, 1707 -
books.google.fr). Triangle espagnol ¬ęParis n'est pas la France¬Ľ, disent les Fran√ßais qui
habitent au delà de la grande banlieue. Tous les pays
cultivent un slogan du même genre et les Espagnols seront spécialement empêchés
de vous d√©signer le si√®ge de l'Espagne. ¬ęMadrid est au milieu, c'est tout¬Ľ, d√©clarent
à peu près avec la même véhémence Catalans, Basques et Andalous. Mais
Barcelone, Bilbao ou Séville ne sont tout de même pas des capitales. La vérité,
c'est que toutes les provinces et tous les dialectes concourent à faire un
pays, de même que tous les instruments de l'orchestre, y compris le triangle,
s'associent pour construire le vrai paysage d'une symphonie. Il faut que le voyageur
sache cela, et qu'il s'en moque. C'est-à-dire qu'il picore d'un pays ce qu'il
peut, dans n'importe quel ordre  (Jean
Fayard, Petit guide du grand tourisme, 1965 - books.google.fr). Quevedo et l'ordo neglectus Par un curieux retournement des choses, contre l'autorité
critique appuy√©e d√©sormais sur les r√®gles et les mod√®les classiques, La Pineli√®re marque son go√Ľt pour S√©n√®que, non le moraliste
cher à Du Vair, mais le styliste cher à Montaigne, à
Juste Lipse, à Quevedo qu'il cite et imite. C'est à Sénèque, contre le principe
de régularité, qu'il demande le principe d'enthousiasme et d'inspiration
poétique. Le Deus intus de la Lettre 41, si proche de
l'idée longinienne du sublime, lui sert à combattre
les autorités classiques invoquées dès lors par la critique docte, Cicéron,
Virgile, Aristote, Scaliger. [...] ¬† Le genre m√™me du Parnasse (¬ęsonge¬Ľ en prose, inspir√© par par la m√©lancolie et d√©couvrant la v√©rit√© sous les masques)
est imité de Quevedo, cité avec admiration p. 3. Les Suenos
y discursos... de celui-ci, publiés à Barcelone en
1628, avaient été traduits en français: Les Visions de Don F. de Quevedo Villegas, traduites... par le sieur de la Geneste, Paris, Billaine, 1632 (6
rééd. entre 1635 et 1649). La Pinelière
a lui-même traduit (1636) La suite des Visions de Quevedo (Marc
Fumaroli, L'√āge de l'√©loquence, 1996 - books.google.fr). Il est incontestable que l'√©cho rencontr√© par V. Malvezzi
dans la p√©ninsule pendant au moins trois d√©cennies est d√Ľ √† la traduction du Romulo par F. de Quevedo, et surtout au prologue dans
lequel il réalise un véritable acte de refondation de l'écriture hypertacitiste ense présentant
comme le découvreur, voire l'inventeur de V. Malvezzi (Bernard
Darbord, Agnès Delage, Le partage du secret: Cultures du dévoilement et de
l‚Äôoccultation en Europe, du Moyen √āge √† l'√©poque moderne, 2013 -
books.google.fr). Le style du Romulo de Malvezzi
relève de l'ordo neglectus (Mercedes
Blanco, Quevedo lector de Malvezzi, La perinola: Revista de investigación
Quevediana, Numéro 8, Universidad de Navarra, 2004 - books.google.fr). La traduction du Romulus inaugure une période nouvelle
dans le développement du talent et du style de Quevedo. C'est surtout en
songeant à cet ouvrage que l'on peut dire, avec don E. Fernandez de Navarrete , "que Quevedo a rapporté d'Italie un style
coupé, incohérent, peu naturel, sans majesté et sans gráce,
peu conforme enfin au caractére de notre langue
harmonieuse, mais visant surtout au brillant et √° la profondeur" (Ernest
Mérimée, Essai sur la vie et les oeuvres de Francisco
de Quevedo: 1580-1645, 1886 - books.google.fr). Un Dialogue paru en 1717, fait le parallèle entre
Sénèque, pour lequel parle Quevedo, et Cicéron, pour lequel parle Muret (Mémoires
pour l'histoire des sciences et des beaux-arts, Volume 70 ; Volume 1718, 1718 -
books.google.fr). Reste entre autres
le problème de "Persiens" Les régences d'Alger et de Tunis dépendaient nominalement
de l'empire ottoman. Shah-Abbas ou Abbas le Grand régnait depuis 1585, après
les revers inflig√©s aux Perses par Murat III. Mont√© sur le tr√īne par un
fratricide et oblig√© √† ces concessions par l'anarchie, Abbas allait bient√īt par
ses exploits faire oublier son crime et réparer son humiliation. Après avoir
ch√Ęti√© les r√©voltes des Uzbecks, il op√©ra en dix
années (1590-1600) les conquêtes successives du Ghilan,
du Mazandéran, de plusieurs places de la Tartarie, avec la soumission de
presque tout l'Afghanistan, et établit à Ispahan le siége
de ses √Čtats restaur√©s et agrandis. Enfin arriva le moment de demander compte
aux Ottomans des troubles que pendant ce temps ils n'avaient cessé de susciter
dans ses provinces occidentales. La révolte des milices d'Asie contre le sultan
lui fournit l'occasion favorable. Leurs chefs vaincus, s'étant réfugiés à la
cour du shah, y trouvèrent un asile et la sécurité. Quand Achmet s'avança pour
se venger de cette hospitalité, Abbas écrasa les Turcs à la bataille décisive
de Bassorah (1605), qui le rendit ma√ģtre de tout le
territoire de l'ancienne domination des Sophis; puis,
marchant de conquête en conquête, il enleva aux ennemis une vaste étendue de
pays à l'occident du Tigre et de l'Euphrate, et la paix, dont il dicta les
conditions à Achmet (1611), lui garantit la possession du Chirvan
et du Kourdistan. La Porte ne craignit pas de violer
les conditions de ce traité en fomentant des troubles dans la Géorgie; mais
elle n'y gagna que des pertes nouvelles, et la Géorgie orientale tout entière
resta sous les lois de la Perse (1648) (P.
C. Nicolle, Mnémonique de l'histoire ou précis d'histoire universelle en
tableaux séculaires, à l'usage de la jeunesse, 1852 - books.google.fr). Dans un  texte
anonyme, probablement de 1557, qui parle de l'Espagne par et à travers la
Turquie, le Viaje de Turquia, un des personnage, Pedro de Urdemalas,
compare Charles Quint au Shah de Perse, "au prétexte que l'empereur veut
aussi défendre une confession originelle contre une interprétation et une
pratique religieuse déviantes et dégradées. [...] Les deux adversaires de la
très catholique Espagne ont volontiers été comparés voire assimilés au XVIe
siècle19. En avril 1529, par exemple, les théologiens de la Sorbonne lient
explicitement la réforme luthérienne à la question turque en pointant les similitudes
qui existent entre ces deux nouveaux dangers que sont le luthéranisme et
l'Empire ottoman" (Laura
Alcoba, Le Viaje de Turquia, Littérature et exotisme, XVIe-XVIIIe siècle, 1997
- books.google.fr, Laura
Alcoba, Pouvoir espagnol et pouvoir turc, Le pouvoir au miroir de la
littérature en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles, 2001 - books.google.fr). Además Quevedo, en el discurso que atribuye al renegado Sinán, trae a colación
otros hechos históricos menos fáciles de fechar, pero no por esto
de menor interés. Entre la evocación de don Juan de Austria
y la del duque de Osuna a
los que separan unos cincuenta a√Īos, alude a los persas, enemigos temidos de los turcos durante toda la primera mitad del siglo XVII, como lo sugiere
con razón el texto de Quevedo. Ahora
bien: la amenaza persa fue mucho m√°s
fuerte bajo Ahmed I (sult√°n de 1603 a 1617) que en los
√ļltimos a√Īos del reinado de Murad IV
(1623-1640) ( ¬ęNo con la enemistad
tan rabiosa el persiano con
turbante verde solicita la desolaci√≥n de nuestro imperio¬Ľ: el presente del verbo
contrasta con el pret√©rito de ¬ęNo pretendi√≥
con tan √ļltimo fin don Juan de Austria‚Ķ¬Ľ
y el de ¬ęNo don Pedro Gir√≥n procur√≥
con tan eficaces medios‚Ķ¬Ľ
(Quevedo, La Hora de todos, p. 165)). La afirmaci√≥n de que sigue actual para los turcos la amenaza de los persas deja suponer que Espa√Īa ha dejado de ser temible, y ello a ra√≠z de la desaparici√≥n del duque de Osuna: en este sentido, bien es verdad que Quevedo utiliza el tema turco para ensalzar a la Espa√Īa tradicional, con la que se confunde, seg√ļn √©l, este personaje (Josette Riandi√®re La Roche, Las s√°tiras de Quevedo, Quevedo y el Gran Se√Īor de los Turcos: ¬Ņexotismo o historia?,¬†- cvc.cervantes.es). |