

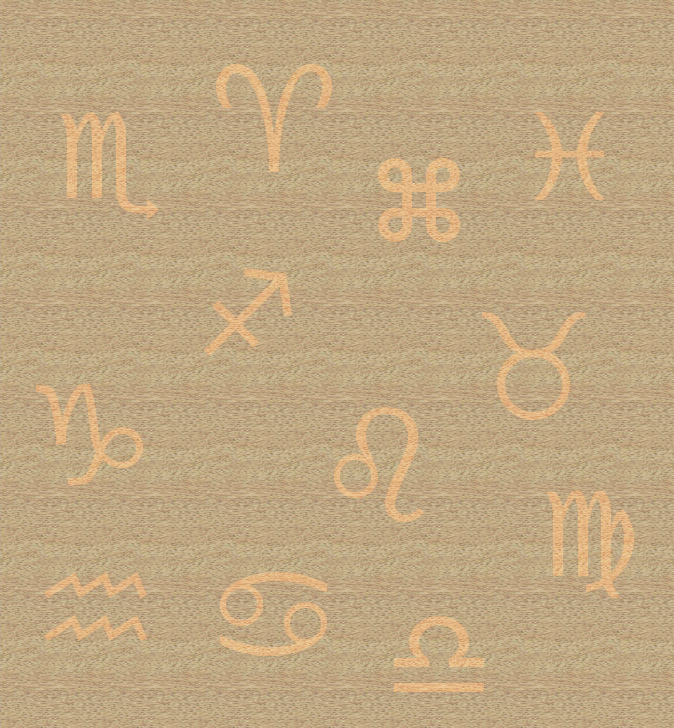
|
Avènement des Romanov I, 76 1613-1614 D'un nom farouche tel proferé
sera, Que les troys seurs auront fato le nom : Puis grand peuple par langue & faict duira : Plus que nul autre aura bruit & renom. Jeux séculaires Les Jeux séculaires sont des fêtes solennelles que les Romains célébraient avec une grande pompe, vers les approches de la moisson, pendant trois jours et trois nuits consécutifs. En voici l'origine, d'après Noël : Dans les premiers temps de Rome, c'est-à -dire sous les rois, un certain Valérus ou Valerius, qui vivait à la campagne, dans une terre du pays des Sabins, proche du village d'Erète, eut deux fils et une tille qui furent frappés de la peste. Il reçut, dit-on, ordre de ses dieux domestiques de descendre le Tibre avec ses enfants, jusqu'à un lieu nommé Terentium, qui était au bout du Champ-de-Mars, et de leur y faire boire de l'eau qu'il ferait chauffer sur l'autel de Pluton et de Proserpine. Les enfants en burent et se trouvèrent parfaitement guéris. Le père, en actions de grâces, offrit au môme endroit des sacrifices, célébra des jeux, et dressa aux dieux des lits de parade, lectisternia, pendant trois nuits; et, pour porter dans son nom même la mémoire d'un événement si singulier, il s'appela dans la suite Manius Valerius Terentinus. Manius, à cause des divinités infernales auxquelles il avait sacrifié; Valerius, du verbe valere, parce que ses enfants avaient été rétablis en santé; et Terentins, du lieu où cela s'était passé. En 210, c'est-à -dire l'année d'après que les rois furent chassés de Rome, une peste violente, accompagnée de grands prodiges, ayant jeté la consternation dans la ville, Valerius Publicola fit sur le même autel des sacrifices à Pluton et à Proserpine, et la contagion cessa. Soixante ans après, on réitéra les mêmes sacrifices par ordre des piètres des Sibylles, en y ajoutant les cérémonies prescrites par les livres sibyllins; et alors il fut réglé que ces fêtes se feraient toujours, dans la suite, à la fin de chaque siècle : ce qui leur fit donner le nom de Jeux séculaires. Ce ne fut que longtemps après, c'est-à -dire durant la seconde guerre punique, qu'on institua les jeux Apollinaires, en l'honneur d'Apollon et de Latone. On les célébrait tous les ans; mais ils n'étaient pas distingués des jeux Séculaires, l'année qu'on représentait ceux-ci. L'appareil de ces jeux était fort considérable. On envoyait des hérauts dans les provinces, pour inviter les habitants à la célébration d'une fête qu'ils n'avaient jamais vue et qu'ils ne reverraient jamais. On distribuait au peuple certaines graines et certaines choses lustrales et expiatoires. On sacrifiait, la nuit, à Pluton et a Proserpine, aux Parques, aux Pythies, à la Terre; et le jour, à Jupiter, à Junon, à Apollon, à Latone, à Diane et aux Génies. On faisait des veilles et des supplications; on plaçait les statues des dieux sur des coussins, où on leur servait les mets les plus exquis. Enfin, pendant les trois jours que durait la fête, on chantait trois cantiques différents, comme l'assure Zozime, et on donnait au peuple divers spectacles. La scène de la fête changeait chaque jour : le premier jour on s'assemblait dans le Champ-de-Mars, le second au Capitole, et le troisième sur le mont Palatin. Ce fut pour ceux-ci qu'Horace composa son Poème Séculaire. Il fut chanté dans le temple d'Apollon Palatin, que l'empereur avait fait bâtir onze ans auparavant. C'est un monument curieux des cérémonies qui s'observaient dans cette fête. Les poëmes séculaires étaient chantés par 54 jeunes gens partagés en deux chœurs, dont l'un était composé de 27 garçons et l'autre de 27 filles (François-Marie Bertrand, Dictionnaire universel, historique et comparatif, de toutes les religions du monde, Volumes 24 à 27 de Encyclopédie théologique, Migne, 1865 - books.google.fr). Il reste très peu de formules de prières publiques des peuples anciens. Nous n'avons que la belle hymne d'Horace pour les jeux séculaires des anciens Romains. Cette prière est du rhythme et de la mesure que les autres Romains ont imités longtemps après dans l'hymne Ut queant laxis resonare fibris. Le Pervigilium Veneris est dans un goût recherché, et n'est pas peut-être digne de la noble simplicité du règne d'Auguste. Il se peut que cette hymne à Vénus ait été chantée dans les fêtes de la déesse ; mais on ne doute pas qu'on n'ait chanté le poëme d'Horace avec la plus grande solennité. : Il faut avouer que le poëme séculaire d'Horace est un des lus beaux morceaux de l'antiquité, et que l'hymne Ut queant axis est un des plus plats ouvrages que nous ayons eus dans · les temps barbares dè la décadence de la langue latine. L'Eglise catholique, dans ces temps-là , cultivait mal l'éloquence et la poésie. On sait bien que Dieu préfère de mauvais vers récités avec un cœur pur, aux plus beaux vers du monde bien chantés par des impies : mais enfin de bons vers n'ont jamais rien gâté, toutes choses étant d'ailleurs égales. Rien n'approcha jamais parmi nous des jeux séculaires qu'on célébrait de cent dix ans en cent dix ans ; notre jubilé n'en est qu'une bien faible copie. On dressait trois autels magnifiques sur les bords du Tibre ; Rome entière était illuminée pendant trois nuits ; quinze prêtres distribuaient l'eau lustrale et des cierges aux Romains et aux Romaines qui devaient chanter les prières. On sacrifiait d'abord à jupiter comme au grand dieu, au maître des dieux, et ensuite à Junon, à Apollon, à Latone, à Diane, à Cérès, à Pluton, à Proserpine, aux Parques, comme à des puissances subalternes. Chacune de ces divinités avait son hymne et ses cérémonies. Il y avait deux chœurs, l'un de vingt-sept garçons, l'autre de vingt-sept filles, pour chacun des dieux. Enfin le dernier jour les garçons et les filles, couronnés de fleurs, chantaient l'ode d'Horace. Il est vrai que dans les maisons on chantait à table ses autres odes pour le petit Ligurinus, pour Lyciscus, et pour d'autres petits fripons, lesquels n'inspiraient pas la plus grande dévotion : mais il y a temps pour tout, pictoribus atque poetis. La Carrache, qui dessina les figures de l'Arétin, peignit aussi des saints ; et dans tous nos colléges nous avons passé à Horace ce que les maîtres de l'empire romain lui passaient sans difficulté (Dictionnaire philosophique, Oeuvres complètes de Voltaire, Tome 1, 1867 - books.google.fr). L'analyse même du Chant séculaire montre que le poète invoque d'abord Phébus et Diane (v. 1), puis le Soleil (v. 9). Les Parques ne sont implorées qu'en tant qu'accomplissant les destins prévus dans les livres sibyllins et en tant que participant au groupe apollinien, puisqu'elles sont, en somme, les sœurs du dieu. Si Lucina est mentionnée au v. 13, c'est qu'Ilithya ou Lucina Genitalis se confond depuis longtemps avec Diane. Dans les vers 29-32, Cérès et Jupiter n'interviennent qu'accessoirement et indirectement, sans être invoqués. Aux vers 33 et suivants, nouvelles invocations à Apollon et à la Lune (Diane). Nous verrons plus loin quels sont les dieux des vers 45-48. Au vers 50, Vénus n'est nommée qu'accessoirement, sans être invoquée : aux vers 56 et suivants, Fides, Pax, Honor, Pudor, Virtus et Copia ne constituent, avec les Camènes, que le cortège de Phébus et Diane. Et, si la strophe finale présume l'acquiescement de Jupiter et de tous les autres dieux aux souhaits du chœur (v. 73), Horace a bien soins de terminer par : doctus et Phoebi chorus et Dianae dicere laudes. Il semble donc qu'aucune confusion n'existe entre le couple divin du Palatin et les autres dieux et que tout le chant est consacré aux louanges de Phébus et de Diane, puisque les autres dieux sont réduits à la portion congrue de deux vers (v. 73-74), où leur consentement est escompté sans même être demandé. Écartons une objection possible. Selon certains, l'invocation aux dieux qui aiment les sept collines (v. 7 et 45-48) aurait un caractère général. Mais le vers 7 ne peut s'expliquer qu'à l'aide des vers 36 à 44 sur la fondation de Rome par les Troyens fugitifs. Or ce sont Apollon et Diane qui ont, par leurs oracles, poussé Énée vers l'Italie, tandis que Junon et d'autres dieux essayaient de l'en écarter. Donc, ce sont Apollon et Diane seuls qui sont invoqués au vers 7 et aux vers 45 et suivants. Autre objection à écarter. On a prétendu que les vers 49 et suivants feraient allusion aux sacrifices de l'avant-veille et de la veille, à savoir celui d'un taureau blanc destiné à Jupiter Capitolin et d'une génisse blanche destinée à Juno Regina. Mais il n'est nullement sûr qu'au vers 49 bobus albis désigne les victimes offertes à Junon et à Jupiter plutôt que celles à Apollon et Diane. Le cérémonial de 204 ap. J.-C. nous apprend qu'il y eut cette fois-là un sacrifice devant l'autel d'Apollon au tétrastyle d'Auguste et un sacrifice à Diane suivi de l'exécution du Chant séculaire d'alors au pronaos d'Apollon. Pour 17 av. J.-C., les Actes font allusion à un sacrifice fait le troisième jour immédiatement avant la double exécution du chant d'Horace. Or on sacrifiait à Apollon des taureaux et il suffit de rappeler le sacrifice d'Anchise et d'Énée (Virgile, Enéide, III, v. 118-120) pour établir au moins la possibilité que le sacrifice du troisième jour, consécutif à l'offrande de gâteaux sacrés et précédant l'exécution du Chant séculaire, ait été le sacrifice d'un taureau blanc à Apollon et d'une génisse blanche à Diane. Mais, grâce à l'oracle sibyllin conservé par Zozime, cette possibilité se change en certitude, car il y est dit que Phébus Apollon y recevra des sacrifices égaux, et il faut entendre égaux à ceux de Jupiter et Héra, précédemment indiqués. Il s'agit donc d'un taureau blanc pour Apollon (et d'une génisse blanche pour Diane). Même la strophe du vers 49, etc., est apollinienne ! On ne voit d'ailleurs pas pourquoi le Chant séculaire invoquerait d'autres dieux qu'Apollon et Diane, puisqu'ils donnent directement de bonnes moissons, grâce au fait que le dieu du soleil les fait mûrir, et une progéniture nombreuse, parce que Diane se confond avec Lucine. Au vers 46, c'est le couple du Palatin qui est seul invoqué pour l'accroissement de la race de Romulus et sa prospérité : Romulae genti date remque prolemque. Et les vers de pure politesse (73-74) : Haec louem sentire deosque cunctos spem bonam certamque domum reporto, où Horace se déclare certain d'avance de l'opinion du reste des dieux, ne font que confirmer que tout le chant est en l'honneur du couple du Palatin (Léon Herrmann, A propos du Chant séculaire d'Horace, Revue des études latines, 1936 - books.google.fr). Les Parques (strophe 7), auxquelles Auguste et Agrippa avaient offert un sacrifice la première nuit. À l'origine, Rome connaît une espèce de démone, Parca Maurtia, qui préside à la naissance des enfants, et une Neuna Fata, ou fée du neuvième jour. Sous l'influence des Moires grecques, qui personnifient le destin individuel puisqu'elles président à la naissance, à la vie et à la mort, les Romains finiront honorer trois Parques, Nona, Décima et Morta, représentées comme filant et coupant le fil de la vie. Elles ont des statues au Forum par où passe la procession. La Terre (Tellus dans le texte latin) est la Terre mère, une divinité élémentaire qui a un double aspect : divinité chtonienne, qui recueille les morts, elle peut être maléfique, mais elle est aussi la déesse de la fécondité, celle qui donne l'abondance, personnifiée par Cérès (strophe 8). Auguste et Agrippa lui avaient sacrifié une truie noire pleine, au cours de la troisième nuit. L'accord de tous les dieux qui ont présidé à la fondation de Rome (strophe 10) est nécessaire à la survie de la cité; on les implore donc de continuer à assurer leur rôle de protecteurs en rappelant la filiation divine de l'empereur, «sang illustre d'Anchise et de Vénus» (strophe 13). Une mention particulière est faite pour Jupiter (strophe 19) ; quant à Junon, elle est associée à Uithyia par son épithète de Lucine (strophe 4). Auguste et Agrippa avaient sacrifié au Capitole deux taureaux blancs à Jupiter, le 1er juin, et deux génisses blanches à Junon, le 2 juin (Michel Kaplan, Le monde romain, 1995 - books.google.fr, http://nonagones.info - Autour de Rennes - Les Bergers des Abruzzes - Crognaleto). « "Les trois Parques", précise P. Grimal, "étaient représentées sur le forum par trois statues que l'on appelait couramment les "trois fées" - les "tria fata" » Comme nos fées, les Parques symbolisaient des tendances opposées que nos sages-femmes et nos baba-jaga peuvent incarner en une seule personne : «Clotho, la fileuse, tenait une quenouille, Lachesis, celle qui attribuait à chacun son dû, filait le lin de la vie, et Atropos, l'inflexible, était chargée de le couper. C'est ainsi que la naissance, la vie et la mort des hommes, se trouvaient entre les mains des trois déesses.» (Mireille Piarotas, Des Contes et des femmes, 1996 - books.google.fr). Troisième Rome La troisième Russie, celle des Romanov, qui a duré trois siècles, de notre Louis XIII à 1917, chacun la connaît pour autocratique. La deuxième où fleurirent les Ivan, l'était de même. Par un message aux chancelleries d'Europe, après son mariage avec la nièce du dernier empereur de Byzance, Ivan III s'était déclaré le continuateur de Rome. Il y avait eu, jusqu'au Ve siècle, la Rome de Rome; puis la Rome de Byzance jusqu'au xv* siècle. Avec Ivan III, ç'allait être la Rome russe. Il fit inscrire dans la lithurgie orthodoxe ces mots superbes : «Voici la troisième Rome. Il n'y en aura pas de quatrième !» Quant à la Russie première, fille de Gengis-khan, le plus grand despote du monde avant Staline, point n'est besoin de marquer qu'elle était dictatoriale. Nous voici dans la Russie quatrième, depuis trente-six ans. Elle est plus que dictatoriale; elle est totalitaire. Et d'ailleurs, atteinte de gigantisme - maladie mortelle, si l'on n'a pas un génie à sa tête. Que réserve demain ? Y a-t-il vraiment, là -bas, un dauphin, devenu tsar ? (Gaston Riou, Situation internationale : fatalité asiatique, Hommes et mondes, Volume 20, 1953 - books.google.fr). D'ailleurs, depuis que Moscou est devenu le siège officiel d'un patriarcat orthodoxe, le pays entier estime que sa capitale est bien la «Troisième Rome», dont rêvait Ivan III. Cette promotion religieuse éclaire d'un jour plus éblouissant encore la personnalité de Boris Godounov, qui a su l'obtenir de Constantinople, alors que l'épiscopat russe l'avait si longtemps espérée en vain. Devenu le champion de l'Église, il sait qu'il peut compter sur le dévouement sans faille du patriarche Job, intronisé naguère grâce à son argent et à sa diplomatie. Admiré par les gens de la rue, encensé par les plus hauts dignitaires de l'orthodoxie, Boris Godounov n'en est pas moins soucieux de son avenir. Il a constamment peur qu'un de ses meilleurs soutiens ne se dérobe au moment où il aurait besoin de son intervention pour conserver sa place. Certes, le décès du très pieux et très vénérable Job ne poserait pas un problème insoluble, car il existe en Russie une bonne demi-douzaine de prélats dignes de lui succéder. Mais que se passera-t-il si le tsar Fédor Ier, de constitution fragile et de volonté flottante, meurt inopinément ? Son seul héritier est cet enfant de huit ans à peine, le tsarévitch Dimitri, que Boris Godounov a relégué, avec sa mère la tsarine Maria Nagoï, dans leur fief d'Ouglitch, à deux cents verstes de Moscou. Est-il concevable que le destin de la Russie repose sur les têtes de ce gamin impubère et de cette femme inexperte ? Ne serait-ce pas un crime que de confier la direction de tout un peuple à deux êtres notoirement incapables de se diriger eux-mêmes? En vérité, plus Boris Godounov avance dans la pratique des affaires de l'État et plus il juge absurde que l'accès au trône soit déterminé par la seule hérédité au lieu de l'être par les qualités de cœur et d'esprit du prétendant. Arrivé à ce point de ses réflexions il est effrayé de son audace. Sans l'avoir voulu, il est en train de remettre en cause les fondements mêmes de la monarchie. Un pas de plus, et il aura Dieu contre lui. Ou, ce qui est peut-être plus grave en ce bas monde, l'Église. Ce pas fatidique, il refuse de le franchir. Il veut de toutes ses forces concilier son intérêt et celui de la Russie, son ambition personnelle et les règles successorales fixées par les ancêtres. À tout hasard, il multiplie ses visites au patriarche Job et ordonne des messes propitiatoires pour le maintien en bonne santé du tsar Fédor Ier. Chercherait-il à mettre toutes les chances de son côté qu'il n'agirait pas autrement ! Au début de l'année 1590, Boris Godounov n'est pas le seul à se préoccuper des bouleversements qui risquent de secouer la Russie à la mort de Fédor Ier. Considérant la difficulté qu'il y aurait à lui trouver un successeur acceptable par les boyards et par le peuple, l'ambassadeur d'Angleterre Georg Fletcher, écrit dans un rapport qui sera publié dès 1591, à Londres, sous le titre: Of the Russian Commonwealth : «Le jeune frère du tsar Fédor, âgé de sept ans, habite un endroit éloigné de Moscou, Ouglitch, sous la surveillance de sa mère et de quelques parents de la famille Nagoï. Mais, d'après ce qu'on dit, sa vie n'est pas en sécurité, car il est menacé d'attentats de la part de ceux qui aspirent à s'emparer du trône au cas où le tsar mourrait sans laisser d'enfants». Inquiet de ces rumeurs persistantes, Boris Godounov consulte les maîtres du droit coutumier en Russie. Leur opinion est formelle : quoi qu'il arrive, le petit prince Dimitri n'a aucun titre à la couronne, puisqu'il est né d'une union illégale aux yeux de l'Église. En effet, Maria Nagoï n'a été que la septième femme d'Ivan le Terrible. Or, les canons de la religion orthodoxe sont intransigeants sur ce point. Le nombre des mariages autorisés est de deux. « Celui qui contracte un troisième mariage est exclu pendant cinq ans du droit de communier et d'assister aux cérémonies liturgiques, disent les textes sacrés. Quant au quatrième mariage, même légal, ne l'invoquez jamais : la règle l'interdit. Celui qui n'a en vue que la satisfaction de ses débauches est coupable. Celui qui contracte un quatrième mariage ou plutôt un accouplement, fait injure aux lois divines et aux lois sacrées qui le proscrivent.» Donc, dans l'éventualité d'un prochain décès de Fédor, le petit Dimitri ne sera pas un rival pour Boris Godounov. Comme en Russie la loi salique est inconnue, que la succession est régie par le seul droit de primogéniture et que la transmission du pouvoir obéit, en cas de vacance, à la logique et à la tradition, c'est la tsarine Irène, femme de Fédor et sœur de Boris Godounov, qui doit recevoir le sceptre impérial (Henri Troyat, De Boris Godounov à Michel Romanov: biographie, 2008 - books.google.fr). Alors que les juristes occidentaux ont dû élaborer la métaphore du mariage du roi avec le royaume, la langue russe a permis d'éviter un tel travail et du même coup l'effort de penser la légitimité et les limites du pouvoir dans une perspective politique. Le rétablissement de l'ordre se produit, selon Timofeev, avec le nouveau mariage, celui du premier Romanov avec la terre : accouplement incestueux puisque le tsar est l'époux et le fils de la terre, mais la nouvelle dynastie se trouve ainsi légitimée. Au XVIIIe siècle, la Mère-Terre humide sera convoquée pour authentifier l'identité d'un faux tsarévitch, prétendant au trône. Vous devinez aisément mon propos : mettre en relief le formidable enchevêtrement du religieux et du politique. La présence forte de la religiosité en Russie est un fait connu. Vladimir Toporov, éminent linguiste et historien de la culture russe, a exposé la «pan sacralité» ou l'«hyper sacralisation» de la culture de l'ancienne Russie, montrant que par sa position dominante l'idée de sacralité contamine les trois. Une opinion répandue estime que la conception Moscou-Troisième Rome témoigne du messianisme à vocation universelle datant du XVIe, voire du XVe siècle. Les historiens ont cependant mis en évidence la distinction entre l'usage diplomatique de l'idée de translatio imperii en faveur de Moscou, destiné à asseoir la légitimité du grand-prince de Moscou parmi ses pairs européens, et la fonction interne - légitimer la non-limitation effective du pouvoir du tsar (Claudio Ingerflom, De la Troisième Rome au mausolée de Lénine, Villa Gillet, Numéros 13 à 15, 2001 - books.google.fr). GODOUN (du slave gody, banquet), le dixième des grands dieux, dans la mythologie slave. Boris Godounov, czar de Russie, né en 1552, mort en 1605. Il appartenait à une famille mongole. Il fit épouser sa sœur Irène au czar Fédor Ier, acquit le plus grand ascendant sur ce faible prince, gouverna en son nom, se débarrassa, par l'exil ou par la mort, des principaux conseillers de Fédor, et, pour se frayer la voie au trône, fit tuer le frère et l'héritier du czar, le jeune Dmitri. Bientôt après, Fédor mourait (1598), empoisonné, dit-on, par son ambitieux beau-frere, qui s'empara sans peine de la couronne. Godounof signala son avénement par de grandes largesses aux églises et aux monasteres; il chercha à se concilier l'affection du peuple, en prenant de sages mesures pour mettre un terme à la famine qui ravagea la Russie en 1601. Il attira dans ce pays des médecins et des pharmaciens, s'efforça d'y répandre la civilisation de l'Occident, entretint, pour favoriser le commerce, des relations étroites avec les villes hanséatiques. Enfin, pour se créer des alliés à l'exterieur, il négocia le mariage de sa fille Alexia avec le frere du roi de Danemark Christian IV. Godounof régnait depuis sept ans, quand un homme, prétendant être Dmitri, frère de Fédor (le même que Boris avait fait mettre à mort), apparut en Russie, rallia autour de lui de nombreux partisans, surtout dans la noblesse, et marcha sur Moscou. Le czar s'avança pour le combattre, mais il mourut subitement, d'une attaque d'apolexie suivant les uns, empoisonné (Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Tome 8 : F - Gyz, 1872 - books.google.fr). Rod - Rozanice La construction exacte des deux premiers vers est difficile à cerner : s'il fallait comprendre que le personnage recevra un nom terrible, tel que le lui donneront les trois soeurs qui portent le nom de fato, on attendrait la construction : «D'un nom nomfarouche tel proféré sera / par les trois Soeurs qu'auront fato le nom» ; mieux vaut sans doute comprendre que le surnom du personnage sera précisément celui de fatal (désigné par le destin), réminiscence du fatalis dux de l'Histoire romaine (Pierre Brind'Amour, Les premières centuries, ou, Propheties de Nostradamus (édition Macé Bonhomme de 1555), 1996 - books.google.fr). On peut lire que le nom des trois soeurs a pour radical celui, farouche, que porte une autre entité. Certaines sources médiévales mentionnent le dieu Rod (théonyme solidaire du verbe roditi, «engendrer») et les rozhenitsa («mère, matrice, fortune»), fées analogues aux Normes Scandinaves. Vraisemblablement, les rozhenitsa sont les épiphanies ou les hypostases de la vieille Déesse-Mère chtonienne, Mati syra zemlja («La Mère Terre humide»), dont le culte a survécu jusqu'au XIXe siècle. On connaît également une quinzaine de noms des dieux de la Baltique, région où le paganisme slave s'est maintenu jusqu'au XIIe siècle (Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, Tome 3, 1983 - books.google.fr). Les Rodzanice personnifient le destin des étoiles et chaque étoile est une nouvelle vie que Rod, efface à la mort. Rod et les Rodzanice ont un culte adoré depuis la nuit des temps chez les Slaves (Wieslaw Jagodzik, Bogowie Slowian "Les Slaves et le Paganisme", 2012 - books.google.fr). An ancient rain and fertility god who, along with his female
counterparts, the rozhanitsy, and the spirits of dead
ancestors, protected the home. Rod was originally the god of husbandmen, though his attributes went
far beyond this role. He was a universal deity, the god of heaven, rain, and
the thunderbolt, who had created the world and all forms of life in it. He
created man by sprinkling dust or gravel over the surface of the earth,established the importance
of the family, and united his devotees into a unified nation. His wife was
called Rozhanitsa (also spelled Rozanica).
The frequent use of the word with the plural ending -y (rozhanitsy)
implies that Rod had many wives; appropriately, polygamy was a common trait
among pagan Slavs. Later, Rod was toppled from his position at the head of the
pantheon by Perun and was reduced to his role as protector of the home and
guardian of ancestors. Rod is the Eastern Slavic equivalent of the Baltic deity
Svantovit. In the
Balkan states, right up to the twentieth century, the cult of the rozhanitsy involved a ceremony in which three women
(usually elderly) drank from a horn,or rhyton, and predicted the fate of a newborn child (Mike
Dixon-Kennedy, Encyclopedia of Russian & Slavic Myth and Legend, 1998 -
books.google.fr). "farouche" De la forestis silva sont issues deux autres notions, celle d'étranger - toujours celui qui vient du dehors (bas latin forasticus, espagnol forastero, italien forestiere) et celle de farouche (à nouveau du bas latin forasticus) : les hommes de l'extérieur sont farouches, étranges, sauvages (Serge Bahuchet, Les Jardiniers de la nature, 2017 - books.google.fr). Cf. quatrain VI, 82. Les Grecs leur donnaient le nom de Varègues ou bien de Rhos, terme que l'on retrouve en arabe (rous) et en finnois (ruotsi). Les marchands étrangers se firent dans la steppe les protecteurs des Slaves qu'ils encadrèrent et auxquels ils finirent par laisser leur nom, les Russes (Luce Pietri, Époques médiévales (Ve-XVe siècle), 1966 - books.google.fr). Un commentaire du texte de Constantin Porphy- rogénète semble établir que les Slaves de la région kièvienne, dès le début du Xe siècle, ont dû se mêler aux Varègues et, sous l'influence de leurs princes Ingvar (Igor), Holgi (Oleg)... fonder le premier État « russe » qui prit tout naturellement le nom de la minorité dirigeante (Ruotsi, Rôper, Rhos) (Origne de l'Etat russe, sur "Témoignage de Constantin VII Porphyrogénète sur l'état ethnique et politique de la Russie au début du Xème siècle" de I. Sorlin, Annales, Volume 21, 1966 - books.google.fr). On admet généralement que le mot de Rus est une seconde dénomination des étrangers venus de l'autre côté de la mer. Il a été emprunté par les Slaves aux Finnois, qui désignaient sous le nom de Ruotsi la Suède. Ce Ruotsi, c'était la côte orientale de la Suède, le Roslagen qui, chez les Suédois du temps des Vikings, était une vaste zone côtière de la Baltique, organisée en Skeppslag ou circonscriptions navales qui participaient aux expéditions (Le Monde slave, Volume 2, 1925 - books.google.fr). Le terme "Rousi est mis en rapport avec le grec "rousios" roux. Pour la première, on peut tenir compte des éléments suivants : le nom de Ruotsi, attribué aux Varègues, était d'origine suédoise et dérivé du nom par lequel les Suédois, à l'origine, se nommaient eux-mêmes ; il servit ensuite à désigner des populations estoniennes et finnoises. C'est à travers ces dernières qu'il se serait ensuite, dans la prononciation slave, transformé en Rus'. Le nom de Varègues est par contre d'origine byzantine sûre : "Baragoi". Quant aux noms des princes des premières générations, tels que Rjurik, Oleg, Igor', on peut croire qu'il s'agit d'altérations de noms Scandinaves : Oleg dériva certainement de Helgi. Sans entrer dans trop de détails, indiquons que ces deux questions de l'origine des noms ont eu une importance même pour l'histoire de la littérature, les deux théories historiques dont elles ont déterminé l'apparition s'y étant fréquemment exprimées : l'une est celle des normandistes, l'autre celle des anti-normandistes (ces noms s'expliquent par le fait que les «Ruotsi» ou Varègues ou Vikings étaient en substance des Normands). La théorie anti-normandiste l'emporte aujourd'hui chez les historiens russes ; elle s'appuie sur les découvertes archéologiques récentes qui ont permis de reconstruire un ensemble d'éléments d'organisation sociale autochtone, à laquelle l'arrivée des étrangers aurait apporté une vigueur nouvelle ; ceci cependant, selon certains, sur une ligne culturelle différente de la ligne d'origine. A cette ligne que nous appelons, un peu génériquement, culturelle se rattacha aussi le problème religieux qui devait contribuer en Russie, bien des siècles plus tard, à la division des esprits connue sous les noms d'occidentalisme et de slavophilisme, et qui caractérisa une grande partie de l'histoire russe du XIXe siècle. Cette division, surtout pour les slavophiles, concerna les origines chrétiennes de rite byzantin des Slaves russes, et eut donc aussi, dans ce sens, une valeur et une portée littéraires exceptionnelles. Il nous faut dire ici quelques mots de la situation religieuse des Slaves russes, telle qu'elle avait été avant la pénétration en Rus' du christianisme. Les Slaves orientaux ou russes eurent en commun avec tous les autres Slaves, occidentaux et méridionaux, et en général avec tous les peuples indoeuropéens avant le christianisme, le culte de la nature et le culte des ancêtres. Tels furent les deux traits caractéristiques de leur paganisme, auquel peut-être le paganisme des Scandinaves vint se superposer au cours des cent années, ou guère plus, qui s'écoulèrent entre la prise de possession de Kiev de la part d'Oleg et le baptême du prince Vladimir (988). Superposition qui se fit, tout au plus, au moyen d'idoles et d'autels, sans que l'on puisse parler de confusion : la primitivité même de la divinité des bois et des eaux (Ljesij et Vodjanoj) rendait cette confusion impossible. Il faut en dire autant des suggestives formes de culte de la famille, en vertu duquel, au XIIe siècle encore, les Slaves russes offraient des sacrifices à un dieu Rod (rod = race, famille) et respectaient le Domovoj, l'esprit de la maison, véritable dieu lare qui accompagnait une famille jusque dans ses pérégrinations. Plus marquée encore était l'originalité de ces esprits où s'unissaient de façon caractéristique le culte de la nature et le culte de la famille, telles la Mère-humide-terre et les Rusalke, aussi longtemps que ces dernières ne furent pas transformées par l'influence du christianisme (Ettore Lo Gatto, Histoire de la littérature russe: des origines à nos jours, 1965 - books.google.fr). Les rusalke (nymphe des eaux) ont le pouvoir de provoquer la tempête et la grêle. Selon la croyance populaire russe, ce sont les âmes des enfants morts sans baptême, ou encore des jeunes filles et des femmes qui se sont suicidées et ne sont pas dignes, pour cette raison, de funérailles chrétiennes (L'ethnographie, Numéros 54 à 57, 1960 - books.google.fr). Comme "farouche", on a évidemment Ivan IV le Terrible père de Fédor Ier. "proféré" On connaît les Slaves de Novgorod, en Russie au IXe siècle; on connaît, aujourd'hui encore, les Slovinces près de l'embouchure de la la Vistule, les Slovènes en Carniole, les Slovaques en Slovaquie (Hongrie septentrionale); pour les Albanais, les Serbes et les Bulgares de Macédoine n'étaient que des Skja, Skjeji, c'est-à -dire des Slaves. Le nom de Slave est d'origine indigène, mais, si étonnant que cela, soit, nous n'en connaissons pas exactement le sens primitif, l'étymologie. Outre les formes "Sklauènoi", "Stlauènoi", Sclaveni, Stlaveni, provenant directement de Slovène, il existait en latin et en grec des formes raccourcies "Sklaboi", "Sthlaboi", Sclavi, Stlavi, d'origine inconnue, formes apparues peut-être sous l'influence de la terminaison -slavü que l'on trouve si souvent dans les noms de personnes. On les recontre déjà au VIe siècle ; et, dès le VIIIe siècle, elles sont très répandues dans la littérature. Partant de ces formes abrégées (et du russe Slavjane), on a commencé dès avant le XIIIe siècle à expliquer le nom de la nation par le mot slava «gloire» et à le traduire par gloriosi, aivetoi. Cette explication s'est maintenue avec persistance jusqu'au XIXe siècle, et le célèbre poète et archéologue slave Jan Kollár l'a appuyée de son autorité. Une autre explication, non moins ancienne, car on la trouve déjà à partir du XIVe siècle, rattachait le nom de Slovan, Slovène au mot slovo «parole, mot» et l'interprétait «verbosi, sermonales, o moglottoi». Cette interprétation a été adoptée par les savants les plus éminents, tels que J.Dobrovsky, J. P. Safarsk; elle s'autorise surtout du fait, qui lui sert de pendant, que les Slaves ont appelé les Allemands, le grand peuple voisin dont la langue leur était incompréhensible, Nëmci (sing. Nèmec, dérivé du mot nèmu «muet»). Si les partisans de cette seconde hypothèse ont été nombreux, la plupart des philologues modernes se refusent pourtant à l'accepter, pour la raison que le suffixe slave -èn-, -ënin, -janin marque toujours un lieu et que Slovénin doit, en conséquence, être dérivé d'un nom de lieu (Slovo ?), nom que malheureusement l'on ne trouve nulle part. L'origine du nom des Slaves reste donc inexpliquée (Lubor Niederle, Manuel de l'antiquité slave, 1923 - books.google.fr). Il est interdit de proférer le Nom du Dieu du Zohar, dont on ne saurait ni représenter, ni voir le Visage, l'interlocuteur invisible de Moïse, celui que personne n'a le pouvoir d'approcher ni de toucher (Gérard Conio, L'Avant-garde russe et la synthèse des arts, 1990 - books.google.fr). On peut donc penser à un autre dieu, au nom farouche étranger à l'Europe de l'ouest. Il suffit ici, pour comprendre la place de Rod dans le système chronologique du «Sermon sur les idoles» (Sermon de Saint Grégoire (le théologien) sur comment autrefois les païens impies vénéraient les idoles, découvert en 1851, ou "Slovo ob idolax"), d'une simple énumération. Avant tout, le siège de Rod n'est pas la maison ou le foyer, place normale pour un esprit du foyer, mais «les cieux». De là -haut, Rod «envoie sur terre des amas», tout à fait comme le Zeus antique qui envoie sur la terre des pierres de foudre-météorites. Au nom de Rod sont liés l'éclair «rodia», les sources «rodniki» et le feu de l'enfer «rodstvo ognennoïé». Etymologiquement, le nom de Rod est lié à ceux de «priroda» : la nature ; «narod» : le peuple ; «urojaï» : la moisson ; «plodorodié» : la fécondité, etc. L'essentiel, cependant, il faut le voir dans le fait que les écrivains ecclésiastiques du XIe au XIIIe siècles comparaient Rod à leur divinité suprême, le dieu-père Sabaoth, créateur du monde. Le sermon, conventionnellement intitulé par son éditeur «Sur l'insufflation de l'esprit à l'homme» est particulièrement intéressant à cet égard. [...] Le commentateur russe (XIIe-XIIIe siècles) a consacré tout son article à une antithèse entre le païen Rod et le Dieu le Père du christianisme, comme à deux divinités de puissance semblable, avec cette simple différence que les païens, à son avis, attribuent de façon erronée à leur dieu la création et l'insufflation de la vie à l'homme. «Ce n'est pas Rod qui est assis dans les cieux et qui envoie sur la terre des amas dans lesquels naissent des enfants... le créateur de tout est Bog (=Dieu), et non pas Rod !» L'attention que porte au culte de Rod l'auteur du «Sermon sur les idoles», le mentionnant en cinq endroits de son œuvre et esquissant l'aire énorme de son empire (Egypte, Asie mineure, Grèce, Rome, monde slave), montre que nous n'avons pas le droit de sous-estimer Rod en en faisant un domovoï, petit dieu domestique au culte familial intime. Comment se fait-il que Rod, semblable à la divinité chrétienne de l'Univers, soit dans les documents toujours lié aux rojanitsy qui sont des divinités de rang inférieur, même si on les considère comme des divinités de la fécondité et de la moisson et pas seulement comme la destinée de chacun ? La réponse nous est fournie par les moires antiques auxquelles on aime tant comparer les rojanitsy : en effet les moires, divinités de la destinée humaine, étaient filles de Zeus et de Thémis. Zeus gouvernait le monde et les moires exprimaient la volonté des dieux, filant le fil de la vie et le coupant au moment voulu. Les moires sont relatées à Zeus de la même façon que les anges-gardiens chrétiens le sont à Dieu le père. Pour cette raison, nous devons partir des comparaisons suivantes : Zeus et les moires ; Rod et les rojanitsy ; Dieu le père et les anges chrétiens. L'ère de Rod est, dans le paganisme slave, l'époque de la naissance du monothéisme agricole primitif (Boris Aleksandrovich Rybakov, Le paganisme des anciens slaves, 1994 - books.google.fr). Les rojanitsy étaient fêtées lors d'un banquet le jour suivant la Nativité de la Vierge (8 septembre). Des "popes vénaux" fermaient les yeux sur ce "banquet diabolique". La Russie, c'est la mère, matouchka-rous'; le souverain, lui, est le père, batiouchka. Le meurtre de l'enfant d'Ouglitch, dernier chaînon d'une dynastie, consomme la rupture de ce couple indestructible qui a forgé la Nation russe. C'est pourquoi celle-ci, dès lors que ses certitudes sont remises en cause, se tourne vers la représentation symbolique ou illusoire de l'ordre chancelant : les saints et les imposteurs. Nulle histoire n'est aussi riche que l'histoire russe en saints qui furent d'abord des princes promis au pouvoir, et en imposteurs qui surgissent par temps de crise pour rappeler que l'ordre qu'ils sont supposés incarner ne peut-être durablement brisé. Quand cet ordre est restauré au XVIIe siècle avec le premier des Romanov, vient aussi l'heure de la réflexion. La plus poussée de toutes fut celle d'Ivan Timofeev, chroniqueur du début de la nouvelle dynastie. Il lui appartenait, en ce temps de en ce temps de changement dynastique, de définir clairement la nature du pouvoir et celle du prince. Dans la mesure où le prince avait été si malmené et affaibli, où rien n'avait permis de distinguer irrévocablement le vrai prince du faux prince, ce qui tendait à suggérer qu'ils pouvaient être parfaitement interchangeables, dans la mesure aussi où, depuis 1598, une élection plus ou moins régulière avait servi à désignerle prince, ce qui montrait à la fois qu'un choix était possible et que rien n'était immanent, il devenait urgent de rendre au prince toute l'autorité extra humaine dont il avait été dépouillé aucours de ces quinze années d'incertitudes. On comprend dès lorsque l'effort d'Ivan Timofeev ait porté avant tout sur la restauration, voire même sur l'extension de la part divine de la nature du Prince, celle qui le fait échapper aux aléas du jugement des hommes (Hélène Carrère d'Encausse, Le Malheur russe: Essai sur le meurtre politique, 2014 - books.google.fr). Dans le Vremennik, Timofeev fait le récit du Temps des Troubles, à peu près entre la mort d'Ivan IV et l'élection du premier Romanov. Il légitime l'avènement du premier Romanov par une pensée syncrétique. [...] Des deux veuves évoqués dans un de ses passage (pp. 333, 335, 337), la Terre-Russie, politique et impérissable, est en état de viduité car sans tsar depuis que Feodor, fils d'Ivan le Terrible, dernier monarque légitime aux yeux de Timofeev, est mort sans laisser d'enfants. Les trois tsars du Temps des Troubles (Boris, le Faux Dimitri, Sujskij) ont selon notre auteur usurpé le trône. La seconde veuve, la nonne Marfa, le demeure jusqu'à l'intronisation de son fils Mihail Romanov et le retour de captivité de son mari le patriarche Filaret. La viduité de l'une et de l'autre prend fin avec le couronnement-mariage (exprimés simultanément grâce à la polysémie du signifiant vencanie) du fils avec la mère. La veuve retrouve son mari dans le tsar Mihail, son fils. Le tsar est donc simultanément pensé comme le fils et l'époux de la Terre. [...] La longue liste de péchés commis par les hommes s'ouvre par le parjure («kljatvoprestuplenie pri kljatvah», p. 264). Timofeev se réfère ici au serment à Boris, accompagné par un chant à la Mère de Dieu, décrit dans le chapitre précédent (p. 236). Le dernier péché cité est l'injure. La terre dans ses trois hypostases est au centre du raisonnement de l'auteur (pp. 264-265). [...] La Terre-Mère qui gémit sous les jurons, est ici identifiée explicitement à la mère «natale» (rodnaja) et à la Mère de Dieu. Cette association imprègne l'orthodoxie et la culture russe (G. Fedotov, B. Kisin). Elle était présente dans les représentations collectives des contemporains de Timofeev, comme en témoigne la correspondance entre deux frères, citée par B. Uspenskij : «l'auteur de notre semence est le même et la terre que nous appelons le ventre maternel, d'où nous sommes sortis est la même.» Revenons au péché qui ouvre la liste, celui que Timofeev semble considérer comme le plus grave - le parjure. Parjure, car on a juré fidélité à un «esclave» - Boris Godunov est aux yeux de l'auteur un « rabocar'» (pp. 223,234). L'extrême gravité de ce parjure réside dans le fait que pendant ce faux serment est évoquée, dans le chant, la Mère de Dieu, donc la Terre-Mère La Terre est ici présente non seulement par l'association-identification avec la Mère de Dieu que les lignes sur l'injure ont explicitée, mais aussi par le signifiant choisi pour désigner ceux (tous les sujets du tsar) qui ont juré : «zemnorodnye» (p. 238), terme rare par ailleurs (Claudio-Sergio Ingerflom, Tamara Kondratieva, «Bez carja zemlja vdova» : Syncrétisme dans le Vremennik d'Ivan Timofeev. In: Cahiers du monde russe et soviétique, vol. 34, n°1-2, Janvier-Juin 1993 - www.persee.fr). "grand peuple" L'essentiel de nos réflexions se réduit à la formulation
du principe selon lequel la dénomination apparaissant dans les sources antiques
: Venethi (Tacite), Venedi
(Pline) et Venedai (Ptolémée) se rapporte à la grande
communauté balto-slave dont faisaient partie des peuples indubitablement slaves
(les Sclavini ac Antes et,
parmi les peuples plus anciens, probablement les Stavanoi)
et d'autres très certainement baltes (les Aesti-Osioi,
Galindai, Soudinoi). Le
domaine culturel des Baltes occidentaux constituerait donc un vestige,
saisissable sur le plan archĂ©ologique, du sĂ©jour au bord de la Baltique, Ă
l'époque des influences romaines, des deux fractions de la population vénédique installées le plus loin dans le nord-ouest : les
Estes et les Galindes. Les deux peuples sont issus,
dans leur plus grande partie, des groupements venus du bassin du Dniepr dès le
Fer ancien. [...] Tous les mouvements de population dans l'est de l'Europe, ainsi que les très profonds changements qu'a subis l'image de l'Europe après la chute du monde antique, ont abouti à la formation, dans les limites du domaine balte occidental (à savoir sur le territoire entre la Pasleka et le Niémen), de nouvelles unités culturelles constituant une étape intermédiaire de la formation des structures tribales de la Prusse, de la Galindie et de la Soudovie du haut Moyen Age. Ces changements semblent contemporains des événements qui ont lieu à cette époque dans le bassin du moyen Dniepr, où, après l'apparition et l'émigration des groupes slaves les plus actifs (les Sclavini ac Antes), on constate la désagrégation définitive de l'ancien conglomérat des Baltes et des Slaves - du "grand peuple" des Vénèdes, selon les termes de Ptolémée (Géographie III, 5, 7-9) (Wojciech Nowakowski, Katarzyna Bartkiewicz, Baltes et proto-Slaves dans l'Antiquité. Textes et archéologie.. In: Dialogues d'histoire ancienne, vol. 16, n°1, 1990 - www.persee.fr). Il faut attendre, semble-t-il, le XVIIIème siècle pour qu’on écrive « grand peuple » en ce qui concerne les Russes. Cf . quatrains I, 49 et II, 91. |