

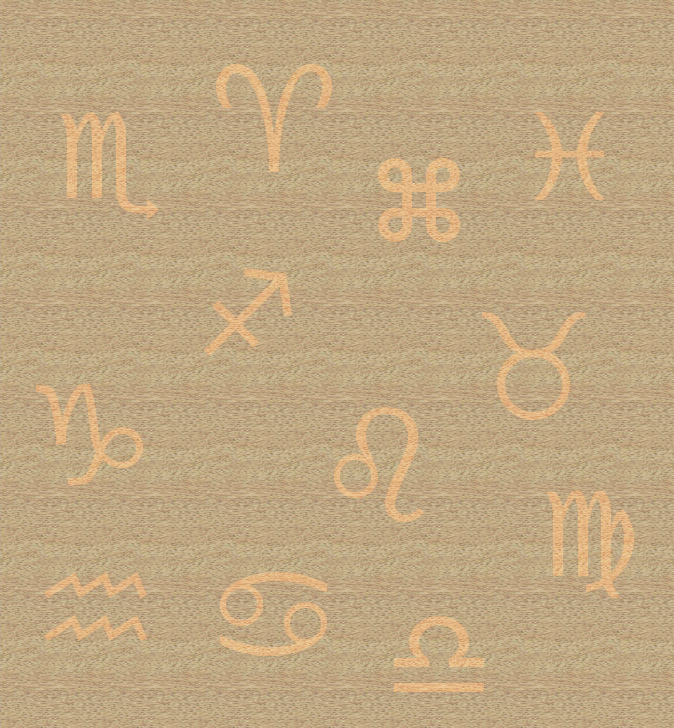
|
Venise et Protestants II, 94 1700 GRAND Po grand mal pour Gauloys
recevra : Vaine, terreur au maritin
Lyon : Peuple infini par la mer passera, Sans eschapper un
quart d'un milion. Venise 1700 Dans l'édition de 1555, on a
"Gran Po" (plaine du Pô), on restera donc
sur l'interprétation qui le désigne avec le "maritin
Lyon" (lion de saint Marc) comme République de Venise Les Vénètes, qui ont donné leur nom à la Vénétie,
seraient proches des Celtes selon l'historien Polybe sous le rapport des
coutumes et du vêtement, mais parleraient une autre langue Depuis, on a trouvé une vingtaine d'inscriptions vénètes et il a été facile de constater que le vénète n'est pas un dialecte celtique. Il est donc
impossible que les Vénètes d'Italie, peuple illyrien, établi au fond de
l'Adriatique dès le temps d'Hérodote, c'est-à -dire dès le cinquième siècle,
soient une tribu détachée des Vénètes de Gaule, peuple celtique. Que les
Vénètes d'Italie se rattachent ou non aux 'Enetoi de
Paphlagonie qui dans la légende homérique prennent part à la guerre de Troie,
ils n'en sont pas moins illyriens de nation et de langue La prochaine vacance du trône d'Espagne devenait l'objet
de l'ambition et de l'inquiétude générale. Le roi Charles II faisait et
refaisait son testament, et on se partageait d'avance ses dépouilles, par des
traités sur lesquels personne ne comptait. L'empereur, ne pouvant rester
spectateur d'un grand événement, dans lequel sa maison était intéressée, désira
terminer la guerre fatigante et infructueuse qu'il soutenait depuis quinze ans
contre les Turcs. L'Angleterre, la Hollande, qui souhaitaient son intervention
dans les affaires de l'Europe occidentale, dans la vue d'opposer ce prince Ã
Louis XIV, offrirent leur médiation à la Porte et aux puissances chrétiennes
liguées contre elle. Elle fut acceptée, et
un congrès s'ouvrit à Carlowitz, en Hongrie, où la
république envoya, pour son plénipotentiaire, le chevalier Charles Ruzzini. Les alliés étaient convenus que l'on partirait
de ce principe, que chacun conserverait ce dont il était en possession ; mais
les Turcs n'avaient point admis la nécessité de tout céder, et l'empereur, Ã
qui la Porte abandonnait la Transylvanie, annonçait la résolution de faire sa
paix séparée, si les Vénitiens ne voulaient pas se relâcher de leurs
prétentions. Le sénat, qui sentait que la république n'avait rien tant Ã
redouter que d'avoir à soutenir seul une guerre contre l'empire ottoman, le
sénat, dis-je, se résigna à subir la condition des Etats du second ordre,
engagés dans les intérêts des grandes puissances. Il accepta la paix qu'on lui
dictait, et sacrifia une partie de ses conquêtes. Ce qui lui en restait était
déjà beaucoup pour sa gloire, et trop pour ses forces, comme la suite le fit
bientôt voir. Par ce traité de Carlowitz, la Porte cédait la Transylvanie Ã
l'Autriche, la place de Kaminieck, les provinces de
Podolie et d'Ukraine à la Pologne, le
port d'Asoph au czar. Voici les articles qui intéressaient plus particulièrement la
république de Venise : elle conserva de ses conquêtes toute la Morée,
jusqu'à l'isthme de Corinthe, l'île d'Egine d'un côté, celle de Sainte-Maure de l'autre; Castel-Nuovo
à l'entrée du canal de Cattaro et Risano
: enfin, dans la Dalmatie, les forteresses de Sing,
Knin et Ciclut. Elle restituait les villes conquises au
nord du golfe d'Athènes et du golfe de Lépante ; mais les fortifications de
Lépante, de Romélie et de Prévésa
devaient être démolies. Enfin elle consentait à laisser aux Turcs la place
importante des Grabuses, quoiqu'ils n'y fussent
entrés que par trahison. On ne pouvait que se féliciter de cette paix, d'où
date l'abaissement de la puissance ottomane ; mais on avait le droit de se
plaindre des procédés des alliés. La Morée offrait à la république des ports
excellents, et une contiguité de possessions, qui
s'étendait depuis l'extrémité du golfe Adriatique jusqu'au milieu de
l'Archipel. Malheureusement, cette acquisition était susceptible d'être
attaquée par mer et par terre, et il était impossible de croire que les Turcs y
eussent renoncé sincèrement. Les Vénitiens revinrent, pour la troisième ou
quatrième fois, au projet de fermer l'isthme de Corinthe par une ligne de
forts, qui furent exécutés sous la direction du général Stenau.
Faible barrière contre une puissance comme la puissance ottomane ! Ce qu'ils
firent de mieux, ce fut d'envoyer dans cette nouvelle province un inquisiteur
chargé de redresser quelques torts faits aux habitants, et d'y établir une
administration qui les empêchât de regretter le joug des Turcs. Mais cela même était
fort difficile, parce que la Morée était peuplée de chrétiens de la religion
grecque, à qui les infidèles étaient beaucoup moins odieux que les chrétiens de
la communion latine. Le doge Silvestre Valier ne
survécut que d'un an à la signature du traité qui venait de rendre la paix à sa
patrie (1700). Le trône fut occupé après lui par Louis Moncenigo
; celui-ci régna jusqu'en 1709, et fut remplacé par Jean Cornaro. IX. Les treize premières années du XVIII°
siècle furent remplies par la guerre que les maisons d'Autriche et de Bourbon
se firent pour la couronne d'Espagne, et dans laquelle elles entraînèrent
presque toute l'Europe. La république de Venise s'attacha à n'y prendre aucune part On ne leur tint
pas grand compte de leur neutralité, parce qu'on ne l'attribua point à leur
modération; on ne la respecta guère, parce qu'elle décelait de la timidité et
de la faiblesse, et au moment où tout le monde posa les armes ils se trouvèrent
aussi peu recherchés que redoutés. Il n'y avait qu'une manière de conserver
à la fois leur neutralité et leur considération, c'était de profiter de la
paix, dont ils voulaient jouir, pour augmenter leurs forces, pendant que les
autres puissances épuisaient les leurs. Je suis loin de prétendre qu'il eût été
plus sage de se jeter au milieu des hasards de la guerre, ni plus louable
d'imiter la duplicité du duc de Savoie, ni plus profitable de prendre part Ã
une guerre dans laquelle la république n'avait aucun intérêt : je veux seulement
faire remarquer que dans ce système il fallait se ménager des moyens de se
faire respecter. Les Vénitiens firent pour cela tout ce qu'on peut faire avec
l'argent. Ils réparèrent et perfectionnèrent leurs forteresses, ils
entretinrent une armée d'une vingtaine de mille hommes; mais comme leurs
moyens, quoique considérables, étaient de beaucoup inférieurs à ceux des
grandes puissances, ce poids, qu'ils ne jetaient point dans la balance, ne
pouvait produire aucun effet. Les sacrifices pécuniaires ne suffisaient plus
pour assurer la supériorité, il aurait fallu prendre une attitude plus
imposante, inspirer une noble résolution à tous les princes de l'Italie, se
placer à leur tête, et se mettre en état d'empêcher les étrangers de ravager ce
beau pays; c'est ce qu'on ne fit point. La France, au commencement de cette
guerre, avait employé les sollicitations, les menaces, et jusqu'aux moyens de
séduction pour y entraîner les Vénitiens; elle leur avait offert l'évêché de
Trente, le Frioul autrichien, sans les ébranler. L'ambassadeur résidant Ã
Venise rendait compte au roi d'une conversation qu'une cérémonie lui avait
fourni l'occasion d'avoir avec un conseiller du doge. On venait de recevoir la
nouvelle de la maladie du roi d'Espagne, Charles II : le patricien convint «qu'il
était à craindre que la guerre ne se renouvelât dans la chrétienté s'il venait
faute de ce prince». Le ministre lui ayant témoigné son étonnement de ce que la
république ne prenait aucunes mesures, le Vénitien répondit : «Eh ! que voulez-vous qu'on fasse sans troupes et sans argent ? On
voit le mal; mais on ne peut y remédier.» Cet aveu aurait été étrange, s'il n'y
avait pas eu de la duplicité : leurs ressources n'étaient pas aussi épuisées
que ce patricien le disait; et c'était peut-être pour les faire croire telles,
qu'on avait imaginé des impôts bizarres, jusqu'à une taxe sur les perruques. Le
sénat affecta de regarder la querelle des maisons de France et d'Autriche,
comme lui étant indifférente. Ce n'était encore qu'un prétexte pour excuser sa
timide inaction; car il ne sentait que trop combien il était dangereux de voir
l'une ou l'autre de ces deux grandes puissances acquérir dans l'Italie les
États qu'on allait se disputer, le royaume de Naples et le duché de Milan. Il
suffit de rappeler aux lecteurs que Charles II, après avoir fait un premier
testament, par lequel il instituait l'archiduc Charles d'Autriche héritier de
tous ses royaumes, fut amené par ses ministres et par ses théologiens à en
faire un second, en faveur de Philippe duc d'Anjou, son petit-neveu, fils puîné
du dauphin de France. Louis XIV déploya tout l'appareil de sa puissance pour
soutenir les droits de son petit-fils. Ce prince, sous le nom de Philippe V, se
mit en possession de la couronne, et fut reconnu en qualité de roi d'Espagne
par l'Angleterre, la Hollande, les électeurs de Cologne et de Bavière, le pape,
les ducs de Savoie et de Mantoue, la république de Gênes et le roi de Portugal.
La république de Venise fut des premières à lui adresser ses félicitations sur
son avènement au trône; mais immédiatement après cette reconnaissance le roi
d'Angleterre, les états généraux et le roi de Danemark, signèrent une ligue , par laquelle ils se déclarèrent en faveur de
l'empereur Léopold, qui avait déjà dans son parti les rois de Prusse et de
Pologne et presque tous les princes de l'Empire. Les premières hostilités éclatèrent en Italie. Venise,
qui avait fait déclarer sa neutralité aux cours de Vienne, de Versailles et de
Madrid, voyait d'un côté, sur les bords du lac de Garde une armée de soixante
mille hommes, commandée par le maréchal de Catinat, sous le duc de Savoie, et
de l'autre, le prince Eugène, qui descendait des montagnes de Trente, à la tête
des Impériaux. Un officier vint annoncer
au provéditeur de Vérone que l'armée autrichienne allait passer sur le
territoire de la république, ne manquant pas de vanter sa bonne discipline en
effet le prince était en marche, et sans égard pour la neutralité il vint
camper sur l'Adige, le 27 mai 1701. Les Français et les Piémontais s'avancèrent
pour lui en disputer le passage, et la province de Vérone se trouva le théâtre
de la guerre; bientôt après, le fléau s'étendit sur le territoire de Brescia.
Dans cette situation, les Vénitiens étaient forcés de faire des vœux pour que
les Impériaux repoussassent les Français jusque dans le duché de Milan; cependant
ils étaient en même temps combattus par une autre crainte : comment
souhaiter des succès durables à l'empereur, à un prince qui, fidèle aux
prétentions de ses prédécesseurs, disait toujours ma Vérone en parlant d'une
place que la république possédait depuis trois cents ans? Le rappel de Catinat,
le choix du maréchal de Villeroy pour le remplacer,
la perfidie de Victor-Amédée, les affaires de Carpi
et de Chiari, facilitèrent successivement au prince Eugène le passage de
l'Adige, du Mincio, puis celui de l'Oglio, puis enfin celui de l'Adda, et grâce
à ces événements le territoire de la république, quoique toujours traversé par
les troupes autrichiennes, cessa du moins d'être ensanglanté. Mais le duc de
Vendôme, successeur du maréchal de Villeroy, si
heureusement fait prisonnier dans Crémone, arrêta les progrès des Impériaux. Il
les battit à Luzara, et se préparait à pénétrer
jusque dans l'évêché de Trente, lorsque la défection du duc de Savoie le força
de rétrograder. On dit que pour arrêter
l'ennemi ce général fut sur le point de couper les digues de l'Adige, et par
conséquent de noyer une partie du territoire des Vénitiens. La fortune leur
épargna ce désastre ; mais la neutralité de la république était journellement
violée sur terre et sur mer. L'empereur faisait partir de Trieste des
flottilles, qui traversaient le golfe et venaient porter à son armée des
munitions et des renforts. Une petite escadre française vint jusqu'au fond de
l'Adriatique intercepter ces convois. C'étaient autant d'atteintes portées au
droit de souveraineté que la république prétendait sur le golfe. Il faut avouer
qu'elle fournissait un prétexte aux violences des parties belligérantes, parle
peu de soin qu'elle prenait de déguiser sa partialité. Les vaisseaux vénitiens
allaient et venaient sans cesse d'une rive à l'autre, pour voiturer des armes,
des approvisionnements, des recrues à l'armée impériale. Le chevalier de
Forbin, qui commandait la flottille française, en rencontra quatre-vingts en un
seul convoi. Un détachement de son équipage fut massacré dans une île
vénitienne; enfin il apprit que le ministre autrichien avait acheté un vaisseau
anglais de cinquante canons, et le faisait armer dans le port même de Malamocco. Dès ce moment l'amiral français se mit à arrêter
toutes les barques vénitiennes qui venaient des ports autrichiens, à jeter à la
mer tout ce dont elles étaient chargées, à les brûler; il brûla de même un
vaisseau de cinquante canons portant le pavillon de la république, sous
prétexte qu'il l'avait rencontré à l'entrée d'un port impérial. Quelques jours
après, il pénétra à minuit, avec trois chaloupes montées de cinquante hommes,
dans le port de Malamocco, aborda le vaisseau anglais
armé pour le compte de l'empereur, le surprit, s'en rendit maître, y mit le
feu, se retira en emmenant ses prisonniers, et eut la satisfaction de voir
sauter ce bâtiment ennemi au milieu du port "terreur" En 1701 et 1702,
les armées franco-espagnoles et austro-allemandes déferlent dans la plaine du
Pô, Venise proteste, en vain. On peut juger de
l'alarme que cet incendie, cette explosion, avaient répandue dans Venise.
On croyait pallier toutes ces infractions au droit des gens, les Vénitiens en
protestant de leur neutralité, les Français en arborant le pavillon espagnol,
c'est-à -dire en imputant leurs violences à d'autres. Enfin, les victoires de Villa-Viciosa en Castille, et de Denain en Flandres,
amenèrent les esprits des alliés à cette modération, seule base des
pacifications durables. Traité* Un congrès avait été déjà ouvert à Utrecht. La
république, comme toutes les autres puissances, avait été invitée à y envoyer un
plénipotentiaire; mais elle n'était ni partie belligérante ni médiatrice
jouissant de quelque influence, car son crédit n'alla pas jusqu'à se faire
adjuger une indemnité pour les dommages que cette guerre lui avait occasionnés.
Elle fut seulement témoin du traité, qui, complété l'année suivante par celui
de Rastadt, assigna l'Espagne et les Indes au petit-fils de Louis XIV; Gibraltar
et Minorque à l'Angleterre; le Montserrat, 'une partie du Milanais et la Sicile
au duc de Savoie ; enfin Milan, Mantoue et Naples à la maison d'Autriche. Le résultat de cette guerre était de rendre les
possessions autrichiennes contiguës à celles de la république, depuis les
montagnes de la Dalmatie jusqu'à la rive gauche du Pô. On voit que tout le
territoire continental des Vénitiens se trouvait enveloppé par cette grande puissance Luigi Moncenigo, cent unième doge de Venise, mort le 6 mai 1709, succéda en juillet 1700
à Silvestre Valieri. La Libitine
presse, avant le trépas d'Innocent XII en septembre (Cf. quatrain II, 93). "grand mal" Cette expression se trouve dans les Pensées de Blaise
Pascal au sujet de Venise : XVII. Dans un état établi en république, comme
Venise, ce serait un très-grand mal de contribuer à y mettre un roi, et Ã
opprimer la liberté des peuples à qui Dieu l'a donnée. Mais dans un état où la puissance royale
est établie, on ne pourrait violer le respect qu'on lui doit sans une espèce de
sacrilège; parce que la puissance que Dieu y a attachée étant non-seulement une
image, mais une participation de la puissance de Dieu, on ne pourrait s'y
opposer sans résister manifestement à l'ordre de Dieu Il écrivait quelques années après la Conjuration de
Venise en 1617-1619 (cf. l'Histoire ou le Roman qui en a été écrit en François
par l'Abbé de Saint-Réal). Il y avait alors en Italie, pour y représenter l'Espagne,
trois hommes supérieurs par un caractère actif et l'habileté de leur Esprit;
deux dont j'ai parlé déjà ; le duc d'Ossone, vice-roi
de Naples, et le marquis dé Villa-Franca, gouverneur de Milan. Un troisième, La
Cuéva, marquis de Bedmar,
ambassadeur près la république de Venise. Tandis que le duc d'Ossone menaçait la république par Une guerre décidée, et
que l'Adriatique était remplie de vaisseaux sous le pavillon de Naples; tandis
que le marquis dé Villa-Franca attaquait hardiment le duc de Savoie et rompait
toutes les trêves que la prudence avait conclues, La Cuéva
tentait une conspiration contre le gouvernement de Venise même, et cherchait Ã
substituer les couleurs espagnoles au lion de Saint-Marc. Le roman a beaucoup
ajouté à cette histoire bizarre; mais il résulte de tous les faits réunis, la
certitude que Philippe III aspirait à la domination générale sur l'Italie;
l'esprit catholique s'y était maintenu comme en Espagne; le chef de l'Eglise
résidait à Rome; l'Empire était toujours dans la maison d'Autriche; un infant
d'Espagne pouvait y être appelé. Alors se fût encore renouvelée la grande
monarchie de Charles-Quint, cette œuvre que la réforme avait brisée. C'était un
autre plan avec le même esprit; la tendance de la monarchie espagnole n'avait
cessé d'être la même depuis deux siècles; elle avait changé de terrain. Sous la
ligue, elle avait voulu la couronne de France; sous Louis, XIII, elle rêvait la
souveraineté d'Italie; la politique de Richelieu l'empêcha de réaliser cette vaste pensée L'exil huguenot Il y a trois causes à l'expansion française. La première fut d'ordre démographique. La France fut jadis,
et de beaucoup, le pays le plus peuplé d'Europe. «Un peuple infini en ce
royaume», écrit Jean Bodin au XVIème siècle. Au XVIIIème, la France compte
environ 20 millions d'habitants, alors que l'on estime à 4,5 millions la
population des autres pays de l'Europe. La France surpeuplée voyait émigrer
nombre des siens, c'était normal. La deuxième cause est psychologique.
Plusieurs des peuples vivant en France ont toujours eu l'esprit aventureux, ont
toujours aimé les expéditions lointaines. C'est le cas des Gascons, des
Normands. La troisième raison des
départs est plus triste. Notre pays a connu bien des périodes de despotisme, de
persécutions, de cruelles guerres civiles. Les persécutés n'ont eu souvent
d'autre espoir que de trouver leur salut dans l'exil. Telles sont les causes
principales qui ont fait sortir de France une foule de gens, de toutes conditions,
de toutes les classes sociales, des types les plus divers Vauban, lui, se livre à une estimation des départs des
huguenots, ce qui s'avère encore plus difficile puisque l'édit de Fontainebleau
ordonne l'expulsion des pasteurs mais interdit l'émigration à tous les
ex-réformés, ce qui suppose des départs clandestins et nécessite un recensement
précis des domiciles On peut remarquer
la clairvoyance de Vauban lorsqu'il avance les chiffres de 80000 Ã 100000
départs, ce qui n'est pas très éloigné de l'évaluation donnée aujourd'hui par
les historiens de 150 à 250000 départs dans une communauté de huguenots estimée
à un million. Vauban est conscient du poids économique des protestants,
essentiellement dans les manufactures et les ateliers, et il donne, dans son
texte de 1693, l'exemple de la province de Normandie d'où dix mille artisans
huguenots seraient partis. Ce chiffre a été confirmé au Conseil du commerce de
1701 par un député de Marseille qui parle de 3 000 départs pour les seuls
fabricants de chapeaux (cité par W. Scoville, op. cit., p.
229). Il a dû aussi se procurer la liste dressée par l'intendant du Dauphiné,
Étienne-Jean Bouchu (voix solitaire parmi les
intendants), des conséquences économiques de l'édit dans une analyse minutieuse
de la place des huguenots dans une économie régionale, adressée au contrôleur
général dans une lettre du 24 juillet 1686. Nul doute que notre poliorcète n'ait trouvé le plus grand intérêt à cette
lecture, comme plus tard dans celle des dénonciations de la concurrence des
implantations industrielles par des huguenots émigrés. Par exemple, celles
rédigées par le Conseil du commerce, créé en 1700 et où siège le rouennais Thomas
Legendre, huguenot converti. Il faut noter que l'appréciation par les
contemporains de Vauban des départs des huguenots est subjective et dépend de
leur position à l'égard de la révocation. Ainsi Claude Ancillon,
huguenot émigré, mentionne, sans l'évaluer, «la désertion d'un nombre
innombrable de personnes qui sont sorties du Royaume et qui se sont retirées
dans des païs etrangers».
Le duc de Bourgogne, lui, les minimise en 1710 en estimant à 67 732 les départs
des hommes, des femmes et des enfants. Vauban, pour sa part, a conscience de la
gravité de la situation car toute perte humaine signifie, dans la logique de de
sa pensée, gain pour l'ennemi ; a contrario, rappeler les huguenots en 1689
provoquerait un affaiblissement des armées et renforcerait les rangs français.
La démonstration, on le voit, tente de mettre l'accent sur le renversement
nécessaire du rapport de forces. De
l'édit de Fontainebleau à la première rédaction du texte en décembre 1689,
Vauban a certainement communiqué ses idées car il reproduit les questions
soulevées, les objections et les réponses qu'il apporte, échos de ses
conversations avec des interlocuteurs restés dans l'ombre. Il s'est procuré des
ouvrages de protestants du refuge, interdits dans le royaume, qui l'aident à développer
son argumentation. Lui avance-t-on que le pape pourrait s'opposer au rappel
des huguenots ? Il en écarte toute possibilité en raison du contexte
conflictuel en 1689 entre Louis XIV et Rome et par l'affirmation du caractère politique
et non religieux d'une telle mesure. Ses propos sont confirmés par l'attitude
non interventionniste d'Innocent XI, peu soucieux de favoriser des recrues qui
pourraient être gallicanes. Lui parle-t-on des conséquences religieuses ? Il
répond, dans la seconde réflexion du 5 avril 1692, en insistant de nouveau sur
les effets néfastes des conversions forcées puisqu'elles entraînent une
profanation du Saint Sacrement Cf. quatrain II, 83 ("gros traffic...
changé"). Les nombres du quatrain correspondent bien à l'émigration
huguenote, mais le "sans eschapper"
contredit l'exil sauf si "exil" est sous-entendu. "sans échapper Ã
l'exil" ("échapper" suggérant l'exil), ou "sans echapper l'exil" Protestantisme Ã
Venise Au XVIe siècle, les idées de la Réforme se diffusent. On
voit surgir de nombreux mouvements qui se réclament tous de la culture
humaniste et dont le plus vigoureux est le spiritualisme, animé par Juan de
Valdès, espagnol exilé en Italie. Venise est «la porte de la Réforme» et
l’université de Padoue, toute proche, devient le centre culturel le plus
important, favorable au dialogue entre les différentes familles de pensée religieuse Le duc de Rohan, protestant révolté contre le roi Louis XIII, se réfugia un temps à Venise en 1630 avant que d’être rappelé par la France pour guerroyer dans la Valteline. La paix de 1629 ayant éteint le feu de la guerre civile,
le duc de Rohan se retira à Venise. Cette république le choisit pour son
généralissime contre les Impériaux. Louis XIII l'enleva aux Vénitiens, pour
l'envoyer ambassadeur en Suisse et chez les Grisons. Il voulait aider ces
peuples à faire entrer sous leur obéissance la Valteline, dont les Espagnols et
les Impériaux soutenaient la révolte. Rohan, déclaré général des Grisons par
les trois Ligues, vint à bout, par plusieurs victoires, de chasser entièrement
les troupes allemandes et espagnoles de la Valteline en 1633. La France ne paraissant
pas devoir retirer ses troupes, les Grisons se soulevèrent; et le duc de Rohan,
mécontent de la cour, fit un traité particulier avec eux en 1637, et se retira
à Genève pour éviter le ressentiment de sa cour. Il mourut d'une blessure qu'il
avait reçue au combat de Reinfeld en 1638, étant au
service du duc de Saxe-Weimar, son ami. Il fut enterré le 27 mai dans l'église
de St.-Pierre de Genève, où on lui dressa un
magnifique tombeau de marbre, avec une épitaphe qui comprend les plus belles
actions de sa vie. [...] Il y a une anecdote assez singulière, tirée des Mémoires
de la duchesse de Rohan, Marguerite de Béthune fille de l'illustre Sully. «Le
duc de Rohan étant à Venise, il lui fut proposé qu'en donnant 200 mille écus Ã
la Porte, & en payant un tribut annuel de vingt mille écus, le grand
seigneur lui céderoit le royaume de Chypre, & lui
en donneroit l'investiture.» Le duc de Rohan avoit dessein d'acheter cette isle
pour y établir les familles protestantes de France et d'Allemagne. Il négocia chaudement cette
affaire à la Porte par l'entremise du patriarche Cyrille, avec lequel il avoit de grandes correspondances; mais différentes
circonstances et particulièrement la mort de ce patriarche, la firent manquer Le secrétaire de l’ambassadeur d‘Angleterre à Venise, Baldassare Altieri, adepte de la
réforme, écrit à Luther en 1542, au nom des communautés évangéliques de Venise,
Vicence et Trévise ; il lui demande d’intervenir en leur faveur auprès des
princes de la ligue de Smalcade. A la suite de quoi,
l’électeur de Saxe, Jean-Frédéric plaide la cause des protestants auprès du
doge. Les adhérents de la Réforme, sont des artisans du textile, des libraires,
des marchands, avocats et médecins, quelques moines et membres du patriciat tel
le frère du doge Niccolo da Ponte, Andrea, protecteur
de ces crypto-évangéliques. Les cultes se tiennent dans la clandestinité dans
les maisons, les négoces. La ville est considérée comme «infestée par
l’hérésie». La politique religieuse de Venise est de se protéger d’une
ingérence de la papauté, le Sénat nomme le patriarche. Toutefois, après la
défaite de la ligue des princes protestants de Smalcade
en 1547 et l’élection de Caraffa qui devient le pape
Paul IV (1555-1559), la persécution des protestants se fait bien plus
intransigeante. Venise dont le déclin économique est entamé, ne peut s’aliéner la
papauté. L’Inquisition a commencé son œuvre de répression. Les marchands luthériens
allemands, qui forment une communauté de plusieurs centaines de personnes,
célèbrent leur culte dans leur comptoir, le célèbre Fondaco.
Les évangéliques vénitiens eux, subsistent dans la clandestinité. Aux premiers
cercles luthériens, se sont ajouté des groupes calviniste et anabaptiste mais
l’essor de la Réforme à Venise est brisé. En 1567 est arrêté le chef de la
communauté, le médecin Teofile Panarelli
di Monopoli, jugé puis expulsé à Rome où il meurt supplicié. C’est l’exil ou la
clandestinité de la communauté, même si les cultes se poursuivent au Fondaco, secrètement, pour les négociants allemands. En 1695, l’Inquisition perd un procès
contre l’un d’entre eux, les allemands obtenant le droit de pratiquer leur foi
comme les grecs ou les juifs, mais avec interdiction de faire du prosélytisme. En
1719 les luthériens allemands peuvent établir un cimetière et sortent de la
clandestinité avec la République transalpine puis les Habsbourg |