

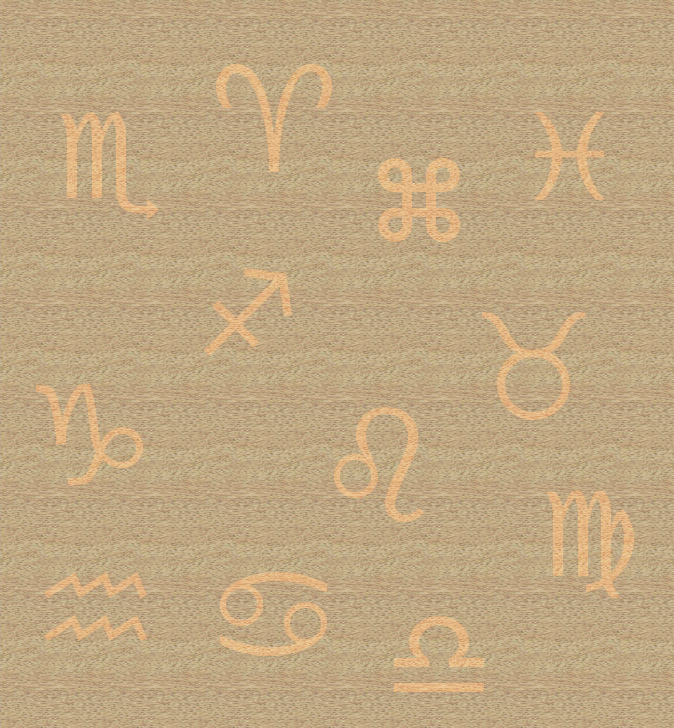
|
Prostituées et lépreux IX, 56 2144-2145 Camp près de Noudam
passera Goussanville, Et à Malotes
laissera son enseigne: Convertira en instant plus de mille, Cherchant les deux remettre en cha√ģne et legne. Noudam : nudam ? Coupl√© avec "linea" (mot proche de "legne", par ligne, qui designerait la "laine" cf. Tristan : "Il fu en legne sanz chemise. De tel burel furent les cotes"), nudam donne quelques vers du satyricon de P√©trone (Guy Dethurens, Tristan et Yseut (version B√©roul), 2016 - books.google.fr). Horace dans la Satire II du Livre II dit : Cois tibi pene videre est ut nudam. Coae vestes, √™toient d√©s habits d'une gase que l'on faisait dans l'isle de Cos & qui √©toit si fin & si transparente, qu‚Äôelle laissoit voir le corps comme √† nud. C‚Äôest pourquoi Varron appelloit ces habits vitreas togas. Publius Syrus les appelloit ventum textilem, du vent tissu, & nebulam lineam, une nu√©e de lin : "AEquum est induere nuptam ventum textilem. Palam prostare nudam in nebula linea ?". Est-il possible qu‚Äôune femme mari√©e porte des habits de vent, & qu‚Äôelle paroisse toute nu√ę sous une nu√©e de lin ? Seneque disoit, qu‚Äôune femme qui portoit des habits de cette gaze, n‚Äôauroit os√© jurer qu'elle n‚Äôestoit pas nu√ę: quibus sumtis mulier parum liquido nudam se non esse jurabit. Et dans le Livre de Confolation qu'il √©crit √† sa mere: Nunquam tibi placuit vestis, que ad nihil aliud exigenda quam ut nudam exponeret. Vous n‚Äôavez jamais aim√© ces habits qui ne font bons qu‚Äô√† faire paro√ģtre le corps nud. Et S. Jer√īme √©crivant √† Laeta [joie] sur l‚Äô√©ducation de sa fille : talia vestimenta paret quibus pellatur frigus, non quibus vestita corpora nudentur. A Rome, il n'y avoit que les courtisanes qui portassent ces sortes d'habits ; au lieu qu'en Orient les femmes & les filles les plus considerables en √™toient v√©tu√ęs. Car c'est ce qu'Esa√Įe appelle Interlucentes Laconicas, des habits transparents, en parlant des filles de Jerusalem (Remarques Critiques Sur Les Oeuvres D'Horace: Avec une Nouvelle Traduction, Tome 7, 1696 - books.google.fr). Ces vers sont inclus dans le Satyricon (chap. 55) et attribu√©s par P√©trone √† Publius Syrus (Yeh Wei-Jong, Le Satyricon √† travers la m√©trique. In: Vita Latina, N¬į183-184, 2011 - www.persee.fr). La modernit√© de P√©trone, pour les contemporains de Louis XIV, est avant tout historique : Petronius Arbiter redivivus, P√©trone se voit ressuscit√© par la d√©couverte d‚Äôune partie importante du roman. Le fragment de Trau, copie du manuscrit contenant le festin de Trimalcion, est en effet (re)trouv√© en 1650 et publi√© en 1664 : ce manuscrit vient combler une vaste lacune s‚Äô√©tendant du chapitre 37 jusqu‚Äôau chapitre 79 du Satiricon. Cette d√©couverte est de premi√®re importance, et le texte de P√©trone que nous lisons aujourd‚Äôhui n‚Äôa gu√®re vari√© depuis l‚Äôint√©gration du Codex Traguriensis Au d√©but de la Renaissance italienne, le Pogge, grand chercheur de manuscrits, retrouve des ¬ęextraits courts¬Ľ (excerpta vulgaria) du Satiricon qui seront publi√©s pour la premi√®re fois √† Milan en 1482 par Franciscus Puteolanus. Cette √©dition princeps se voit ensuite compl√©t√©e (¬ęextraits longs¬Ľ) par celles de Jean de Tournes (Lyon, 1575) et de Pierre Pithou (Paris, 1577). Les √©ditions des ¬ęextraits longs¬Ľ ne subissent ensuite que des remaniements de d√©tail. De l√©g√®res variantes sont ainsi apport√©es par les √©ditions de Jean Dousa (Leyde, 1585), de Melchior Goldast de Heiminsfeld (Francfort, 1610), de Jean Boudelot (Paris, 1618), de Th√©odore de Juges (Gen√®ve, 1629), de Gonsalo de Salas (Francfort, 1629). C‚Äôest la d√©couverte en 1650 √† Trau, en Dalmatie, d‚Äôune copie du manuscrit contenant la cena Trimalchionis qui modifie radicalement le texte de P√©trone. Ce fragment, publi√© seul en 1664 √† Padoue, est joint en 1669 aux extraits longs de P√©trone par Michael Hadrianides : cette √©dition (Amsterdam, 1669) comprend le premier texte complet de ce qui a surv√©cu du Satiricon, quasi semblable √† celui dont nous disposons aujourd‚Äôhui et qui repr√©sente environ un tiers de ce qu‚Äô√©tait le roman int√©gral (Carine Barbafieri, ¬ęIl est peut-√™tre le seul de l'Antiquit√© qui ait su parler de galanterie¬Ľ. P√©trone, figure tut√©laire des mondains √† l'√Ęge classique, Litt√©ratures classiques N¬į 77, 2012 ). L‚Äô√©pisode du Festin chez Trimalcion (en latin Cena Trimalchionis) couvre les chapitres 26, 7-78, 8 des √©ditions modernes du Satyricon. Il repr√©sente l‚Äô√©pisode le plus √©tendu du Satyricon et, probablement, le plus connu. Sa d√©couverte remonte √† la moiti√© du XVIIe si√®cle (en. 1645), quand Marino Statileo remarque une partie du Satyricon jusqu‚Äôalors inconnue dans un manuscrit appartenant √† la biblioth√®que de son ami le comte Niccol√≤ Cippico. La d√©couverte a lieu en Dalmatie, dans la ville de Trogir. Cette ville se trouve aujourd‚Äôhui en Croatie, mais √† l‚Äô√©poque elle √©tait sous domination v√©nitienne et couramment connue sous le nom italien de Tra√Ļ (en latin Tragurium). Le manuscrit de Tra√Ļ appartient aujourd‚Äôhui √† la BnF. Vers 1570 ‚Äėle cercle de Leyde‚Äô gravitant autour du c√©l√®bre philologue Scaliger red√©couvre P√©trone, en publiant, en outre les excerpta longiora. C‚Äôest le m√™me Scaliger qui sugg√®re l‚Äôidentification entre le P√©trone auteur du Satyricon et le P√©trone (27 ? ‚Äď 66) d√©crit par l‚Äôhistorien romain Tacite dans les Annales et reconnu comme ‚Äėarbitre du bon go√Ľt‚Äô (arbiter elegantiae) de la cour n√©ronienne (Le Fragment de Tra√Ļ). "Malotes" : "malauta"
malade en proven√ßal Ripa (De Peste, III, I, 463.) et apr√®s lui Zacchias (Quest. MED. LEG. III,3, 4) ont formellement prescrit l'expulsion des prostitu√©es de l'enceinte des villes en temps d'√©pid√©mie. Avant tous les progr√®s r√©alis√©s de nos jours par l'hygi√®ne publique, la prostitution devait appara√ģtre comme une v√©ritable cause d'infection dans les quartiers qu'elle occupait. Chez les Romains la vie militaire obligeait √† la chastet√© ; c'√©tait du moins une opinion commune : "Dicta caatra, quasi casta, quod illic custraretitr libido, nam numquam iis intererat mulier" (Isidore. HISPAL. 9, Etymol. 3) "Le mot castra (camps) est comme casta (chaste) parce que la volupt√© y √©tait castram (chatr√©e), car jamais aucune femme n'y paraissait". Scipion, r√©tablissant l'ancienne discipline, expulse de son camp 2000 prostitu√©es. (VAL. Max. II, 2, 4) (Julien Fran√ßois Jeannel, M√©moire sur la prostitution publique et parall√®le complet de la prostitution romaine et de la prostitution contemporaine, 1862 - books.google.fr). L'√©tude des termes injurieux n'est pas sans int√©r√™t pour la connaissance des mentalit√©s et des structures sociales. Plusieurs fueros (chartes municipales) l√©ono-castillanes des XII√®me et XIII√®me si√®cles ainsi que le Fuero Viejo de Castilla (mil. XIV√®me) rangent certaines insultes verbales parmi les actes d√©lictueux qui exigeaient sanction et r√©paration. [...] La sexualit√© est le th√®me dominant. Aucun fuero n'ignore puta, ¬ęputain¬Ľ. Les autres r√©f√©rences √† la conduite sexuelle sont beaucoup moins fr√©quentes : enceguladora (ceguladora), ¬ęcocufieuse¬Ľ , yo te fodi, ¬ęje t'ai foutue¬Ľ, yo te vi foder,¬† ¬ęje t'ai vue foutre¬Ľ. Il convient peut-√™tre de ranger dans la m√™me cat√©gorie : rocina (f√©minin de rocin, ¬ęroussin¬Ľ), o√Ļ je verrai plut√īt une connotation √©rotique qu'une allusion malveillante √† l'aspect physique ; monaguera (de monago, latin ¬ęmonachus¬Ľ), celle qui fr√©quente trop intimement les moines (?) ; alevosa, ¬ętra√ģtresse¬Ľ, (√† la foi conjugale ?). Deux insultes seulement rel√®vent de registres diff√©rents. Gafa/malata, ¬ęl√©preuse¬Ľ, suit puta en fr√©quence (J. Gautier Dalch√©, Remarques sur l'insulte verbale dans quelques textes juridiques l√©ono-castillans, M√©langes Jean Larmat: regards sur le Moyen Age et la Renaissance :(histoire, langue et litt√©rature), 1982 - books.google.fr). On peut peut-√™tre √©largir ce types d'injures √† des aires g√©ographiques plus larges. "Convertira" En parlant du sort d√©finitif des prostitu√©es, j'ai dit que plusieurs de ces femmes, touch√©es de repentir et mues par des sentiments religieux, entraient dans des maisons de retraite et s'y livraient, pour le reste de leur vie, au travail et aux exercices d'une vie p√©nitente. Je vais dire quelques mots sur ces maisons dignes, sous bien des rapports, du plus haut int√©r√™t. Le premier √©tablissement qui, √† ma connaissance, ait √©t√© consacr√© √† recevoir les prostitu√©es repentantes, remonte aux premi√®res ann√©es du XIII¬į si√®cle ; il fut fond√© par Guillaume III, √©v√™que de Paris, qui lui donna le nom de maison des Filles-Dieu. Nous avons vu saint Louis, lors de son premier √©dit, accorder √† cette maison une somme consid√©rable, √† condition qu'elle entretiendrait deux cents filles qui, renon√ßant √† leurs habitudes vicieuses, voudraient rentrer dans le chemin de l'honneur et de la vertu. Cette maison, se trouvant dans la direction de l'enceinte que Charles V faisait b√Ętir, on fut oblig√© de la d√©truire et de la transporter rue Saint-Denis, au coin de la rue qui porte encore aujourd'hui le nom des Filles-Dieu, o√Ļ elle a subsist√© avec la m√™me destination pendant plusieurs si√®cles. En l'ann√©e 1492, un religieux nomm√© Jean Tisserand, ayant converti par ses pr√©dications un certain nombre de filles d√©bauch√©es, les r√©unit en communaut√© sous le nom de filles p√©nitentes ; Charles VIII approuva leur institut en 1496, et le pape Alexandre VI le confirma en 1497. Dans les statuts qui leur furent donn√©s par l'archev√™que de Paris, Jean Simon, il fut sp√©cifi√© qu'on ne recevrait dans cette maison aucune fille qui n'e√Ľt perdu sa virginit√© (Voir F√©libien, Histoire de Paris, t. II, p.886). Une autre maison s'√©tablit en 1618 ; elle fut fond√©e par Robert de Montry, marchand de Paris, qui, ayant trouv√© deux filles d√©bauch√©es touch√©es de repentir, les retira chez lui et pourvut √† leur existence ; celles-ci furent suivies de plusieurs autres qu'il secourut de la m√™me mani√®re. ( Id., id., t. II, p. 1313.) Sainte-P√©lagie, √©tablissement devenu depuis tr√®s-c√©l√®bre, fut fond√©e en 1665 par la dame de Miramion, qui se trouvait, √† cette √©poque, √† la t√™te de toutes les institutions utiles; elle fit d'abord sur dix filles l'essai des moyens et de la m√©thode qu'elle voulait employer sur cette classe ; cet essai ayant r√©ussi, elle √©tendit sa maison , qui se trouva par la suite compos√©e de deux classes de personnes, l'une comprenant les filles renferm√©es par force et √† la demande de leurs parents, l'autre celles qui venaient s'y r√©fugier d'elles-m√™mes ; en peu de temps, le nombre de ces derni√®res s'accrut d'une mani√®re consid√©rable. A cette √©poque de z√®le et d'enthousiasme religieux, on voyait des particuliers sans mission former des maisons semblables et, de leur autorit√©, y faire enfermer des filles de mauvaise vie qu'ils voulaient forcer √† se convertir ; les choses, √† cet √©gard, en vinrent √† un tel point que le parlement fut oblig√© d'intervenir et d'arr√™ter ce z√®le indiscret. (Histoire de Paris, par F√©libien, t. II, p. 1491.) Il ne faut pas confondre avec les √©tablissements dont nous parlons, le Refuge de la Madeleine, que fonda Louis XIV. Il n'y avait, en effet, dans ces deux divisions de la Salp√™tri√®re, que des pensionnaires qu'on y renfermait contre leur volont√© : elles faisaient partie de la Force, o√Ļ se trouvaient les filles incorrigibles. Vers l'ann√©e 1686 , une veuve nomm√©e Lacombe, tr√®s-religieuse dame, re√ßut par charit√©, chez elle, une fille repentante ; celle-ci en attira d'autres, et Louis XIV, qui avait entendu parler de cette veuve et qui voulait la prot√©ger, lui donna une maison dans la rue du Cherche-Midi. Cette dame Lacombe avait pour principe de ne refuser personne et d'ouvrir son √©tablissement √† qui voulait y entrer. En peu de temps, la maison devint trop petite ; il fallut y b√Ętir une aile, puis en acheter une seconde, de sorte qu'en moins de deux ans, on y comptait 120 personnes. Telle fut l'origine de la maison du Bon-Pasteur, √† laquelle on donna des r√©glements en 1698. Dans les dix ann√©es qui suivirent , trois autres √©tablissements analogues se form√®rent dans Paris; ils √©taient d√©sign√©s sous les noms de Sainte-Th√©odore, de Sainte-Val√®re, et du Sauveur ; j'ignore √† quelle √©poque fut fond√©e la maison de Saint-Michel qui avait la m√™me destination. Toutes ces conversions √©taient-elles bien sinc√®res ? On a lieu d'en douter, lorsqu'on sait qu'elles s'op√©raient √† l'√©poque o√Ļ Louis XIV faisait ex√©cuter avec s√©v√©rit√© les r√©glements qu'il avait publi√©s contre les filles publiques. (Delamare, Trait√© de la Police, t. 1, p. 530, et F√©libien, Histoire de Paris, t. II, p. 1522.) (Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duch√Ętelet, De la prostitution dans la ville de Paris, Tome 1, 1837 - books.google.fr). Se d√©clinent sur none : ante-antain ('tante', amita), pute-putain (*putta ?) et quantit√© de formations onomastiques : noms de rivi√®res (pass√©s aujourd'hui au masculin) : Orne-Ornain, Loing, Morin (anciennement Loue-Louain, More-Morain, lat. Lupa, Mucra), et anthroponymes : Aie-Aien (effet de Bartsch), Berte-Bertain, Eve-Evain, Gisle-Gislain, Pinte-Pintain (nom de la poule dans le Rom. de Renart), encore lisibles dans les noms compos√©s d'agglom√©rations franques comme Goussainville ou Joinville (Gonzane/ Gaudiane villa) : Ja n'es tu pas filz de putain, / ne de moine ne de nonnain (Th√®bes, 65-66). Par devant dient qu'eus vos aiment, / et par deriers putain vos claiment (Rose, 9210) (Gaston Zink, Morphologie du fran√ßais m√©di√©val, 1997 - books.google.fr Les noms de lieu m'ont conduit √† une digression m√©dicale; les noms propres me ram√®nent √† la grammaire. On sait que l'ancienne langue avait une forme de r√©gime pour les noms de femme en e muet, et que cette forme √©tait en ain : Berte, Bertain, Ide, Itlain. √ąve, √Čvain, Jehaite, Jehanain, etc. Cela √©tait rest√© inexpliqu√©, mais ne l'est plus gr√Ęce √† M. Jules Quicherat. Les noms barbares de femme en a s'allongeaient, aux cas obliques, par l'addition d'une syllabe nasale; Truta, Trudan√¶, Bertrada, Bertradan√¶, Ercamberta, Ercambertanae, Fastrada, Fastradanae, Berta, Bertan√¶. La nomenclature territoriale fournit son contingent d'exemples : Attainville (Seine-et-√õise), Adtan√¶ villa, Dondainville (Eure-et-Loir), Dodan√¶ villa, Goussainville (Seine-et-Oise), GanzanŇď villa; tous noms faisant au nominatif Adla, Dada, Gunza. L'ancien haut allemand d√©cline les noms f√©minins en a ainsi : zunka, lingua, zunkan, linguam; et le gothique dit semblablement : tugg√ī, tugg√īn. Soit que cette finale an, on, f√Ľt accentu√©e ou ne le f√Ľt pas, le bas latin fareentua, et, en l'accentuant, la d√©veloppa en anem, anam. La langue ne borna pas aux noms propres cette formation ; elle l'√©tendit √† certains noms communs, par exemple antain, tante, et deux qui nous sont rest√©s, l'un familier, nonnain, l'autre grossier, putain (√Čmile Littr√©, Pour faire suite √† l'histoire de la langue fran√ßaise, 1880 - books.google.fr). Gaudiane se rapproche de "gaudia", la joie en latin qui se d√©cline en "fille de joie". "Chaine",
"laine" : tissage Quoique le lin f√Ľt connu √† Rome et dans l'Italie, il n'y devint d'un usage fr√©quent que sous les empereurs. On le recherchait surtout pour les v√™temens de dessous. Alexandre S√©v√®re pref√©rait sa blancheur √† l'√©clat de la pourpre. Il introduisit l'usage de m√™ler l'or aux tissus de lin, vain luxe, qui ne pouvait que leur faire perdre, avec leur souplesse, une partie de leur agr√©ment. Il para√ģt que les anciens ne furent gu√®re moins habiles que nous dans l'art de tisser le lin. Les femmes de l'antiquit√© ch√©rissaient, comme celles de nos jours, ces voiles √† jour, qui ne semblent faits que pour irriter les d√©sirs, et que Varron apelle des v√™tements cristal (vitreas togas), et P√©trone un nuage de lin, du vent tissu : AEquum est induere nuptam ventum textilem, Pal√†m prostare nudam in nebula. linea ? Les gazes de Cos √©taient surtout c√©l√®bres. Mais il para√ģt qu'√† Cos ces √©toffes transparentes se faisaient avec le cotou qu'on y cultivait. Pamphila , fille de Lato√ľs, les avait invent√©es : Non defraudanda, dit Pline (liv. XI, c. 22), gloria inventae rationis ut denudet fŇďminan vestis. L'art de la filature a √©t√© pouss√© si loin, qu'on tire d'une seule once de lin quatre mille aunes de fil (Dictionnaire des sciences m√©dicales, Volume 28, 1818 - books.google.fr). Du lin impudique, on passe par la conversion √† la laine qui servait √† tisser la robe de bure des religieux. On pense √† Robert d'Arbrisel et √† Vital de Savigny qui convertissent des prostitu√©es. Dans deux textes du XVII√®me si√®cle de l'histoire de Fontevraud la prostitu√©e visit√©e par d'Arbrisel "tombe √† l'instant √† ses pied" (Jacques Dalarun, Robert d'Arbrissel, fondateur de Fontevraud, 2012 - books.google.fr). A la fin du XVIIe si√®cle, par exemple, l'h√īpital g√©n√©ral de Paris, qui comprenait plusieurs √©tablissements (aussi appel√©s ¬ęasiles¬Ľ), dont notamment la Salp√™tri√®re (qui accueillait exclusivement des femmes), une maison de correction pour les prostitu√©es et la ¬ęmaison Scipion¬Ľ (qui √©tait r√©serv√©e aux femmes sur le point d'accoucher, aux accouch√©es et aux nouveau-n√©s), permettait de loger et d'enfermer quelques dix milles personnes. D√®s 1666, le travail est devenu obligatoire dans les diff√©rents asiles de l'h√īpital g√©n√©ral ; les accouch√©es de la ¬ę maison Scipion ¬Ľ se sont ainsi retrouv√©es oblig√©es de tisser et de tricoter (St√©phanie Perrenoud, La protection de la maternit√©: Etude de droit suisse, international et europ√©en, 2015 - books.google.fr). Le costume des filles du Bon-Pasteur √©tait √† peu pr√®s le m√™me que celui des communaut√©s analogues : leurs robes de bure ou de gros drap brun, √† manches larges et tombantes, √† col ferm√© et attach√© par une agrafe, se serraient √† la taille avec une ceinture de cuir noir, garni d'une boucle de fer noirci; elles portaient, n√©anmoins, par-dessus leurs robes, un corset en toute saison, et un jupon en hiver seulement, avec une camisole blanche, de rev√®che, sans appr√™t; elles avaient des bas de laine tricot√©e et des sandales de bois, en guise de souliers; elles mettaient par-dessus le gros bonnet de laine qui couvrait leur t√™te ras√©e, une double coiffe d'√©tamine tr√®s-√©paisse en forme de cornette, longue de deux tiers et profonde d'un quart d'aune. A leur ceinture pendait un gros chapelet de bois brun, termin√© par une croix portant un christ en cuivre jaune. Elles ne se servaient de gants que dans la rigueur de l'hiver, pour √©viter que leurs mains ne se ger√ßassent et ne fussent hors d'√©tat de travailler; elles ne se d√©barrassaient de leurs tabliers, de serge d'Aumale, √† bavette, que les dimanches et les jours de f√™te, o√Ļ elles ne travaillaient pas √† l'ouvroir (P. L. Jacob, Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde, depuis l'antiquit√© la plus recul√©e, jusqu'√† nos jours, Tome 7, 1855 - books.google.fr). "enseigne" Le port d'une ¬ęenseigne¬Ľ est obligatoire pour les filles publiques √† compter d'une ordonnance du XIIIe si√®cle, renouvel√©e au XVe et au XVIe si√®cle. Quant aux interdits vestimentaires (d√©fense deporter un mantelet fourr√©, un bonnet orn√© d'or et d'argent, des bijoux, des chapelets pr√©cieux, etc., sous peine de 50 livres d'amende, √† Avignon), ils se rangent dans le cadre d'ordonnances somptuaires valables pour toutes les cat√©gories sociales, et d'ailleurs respect√©es. Ils visent √† distinguer des autres les ¬ęfemmes d'√©tat¬Ľ et √† √©viter que de pauvres jeunes filles, √† la vue de leurs belles parures, soient incit√©es √† suivre leur exemple. Des interdits fiscaux enfin (d√©fense de recevoir chez soi et donner √† d√ģner et souper aux filles communes) emp√™chent le ¬ęsecteur priv√©¬Ľ de ruiner le monopole urbain (Madeleine Lazard, Les Avenues de F√©mynie: Les femmes et la Renaissance, 2001 - books.google.fr). De m√™me les l√©preux se devaient de porter une enseigne, en particulier en Languedoc. Des lettres du 7 mars 1407, produites par Charles VI, r√©pondant √† la plainte des consuls de Toulouse, exigent que les l√©preux "doivent porter certaine enseigne pour estre comme (distingu√©s) des saines personnes, et aussi doivent demourer et vevre (vivre) s√©par√©ment, √† ce que les soins n'en soyent pas entami√©s et corrompus" (F√©lix Martin-Doisy, Dictionnaire d'√©conomie charitable, Encyclop√©die th√©ologique, Migne, 1857 - books.google.fr). Pierre, chantre de Notre-Dame, Foulques, cur√© de Ne√ľilly, Pierre de Roissy, chancelier de l'√©glise de Chartres, Guillaume de Seligny, √©v√™que de Paris, saint Louis et Jean Tisserand, t√Ęch√®rent vainement de convertir les femmes publiques, tant√īt par la sainte vie qu'ils menoient et qu'ils pr√™choient, tant√īt par les menaces et par les rigueurs, tant√īt par l'esprit de mansu√©tude qui est si propre √† gagner le cŇďur du peuple. Foulques montrait au doigt et chargeoit de mal√©dictions, en pr√©sence de tout le monde, les pr√™tres qui ne se rend oient pas √† ses remontrances : il appeloit Jumens du diable, les femmes qu'ils entre-tenoient : il les remplit, pour la plupart, d'une si sainte horreur, et leur donna tant de terreur des ch√Ętimens de l'autre vie, que de toutes ces femmes, les unes se mari√®rent, les autres s'arrach√®rent les cheveux, quelques-unes expi√®rent leurs crimes par des p√®lerinages et par des aust√©rit√©s, et les autres crucifi√®rent leur chair et leur passion dans l'abbaye de Saint-Antoine-desChamps, qu'on fonda tout expr√®s pour elles (Henri Sauval, La Chronique scandaleuse de Paris: Ou Histoire des mauvais lieux, 2016 - books.google.fr). Henri Sauval, ou Sauvalle, baptis√© le 5 mars 1623 √† Paris et mort le 21 mars 1676 √† Paris, est un avocat et historien fran√ßais du XVIIe si√®cle. Il consacre la plus grande partie de sa vie √† des recherches sur les archives de sa ville natale et obtint en 1656 une licence pour imprimer son Paris ancien et moderne. Cependant √† sa mort le travail restait toujours √† l‚Äô√©tat de manuscrit. Ce n‚Äôest qu'en 1724, pr√®s d'un demi-si√®cle plus tard, qu'il fut publi√© gr√Ęce √† son collaborateur Claude Bernard Rousseau, sous le titre Histoire et recherches des antiquit√©s de la ville de Paris. Il √©tait toutefois remani√© par de lourdes digressions qui n‚Äô√©taient pas de Sauval. D'autre part, toute une partie du texte, √©cart√©e, ne fut publi√©e qu'en 1883 sous le titre Chronique scandaleuse de Paris, ou Histoire des mauvais lieux (fr.wikipedia.org - Henri Sauval). Foulques de Neuilly autre saint Paul et les 1000 prostitu√©es de Corinthe L'abb√© Lebeuf rapporte, d'apr√®s un √©crivain du XIIIe si√®cle, Jacques de Vitry que ¬ęPierre, chanoine de Paris, voulant faire conna√ģtre les talents extraordinaires de Foulques son disciple, le fit pr√™cher en sa pr√©sence et Dieu donna une telle b√©n√©diction √† ses sermons, quoiqu'ils fussent d'un style fort simple que m√™me, tous les savants de Paris s'excitaient √† venir entendre le pr√™tre Foulques qui pr√™chait, disaient-ils, comme un second saint Paul¬Ľ (d'apr√®s l'Historia occidentalis de J. de Vitry, ch. 8) (Adolphe D√©my, Essai historique sur l'√©glise Saint-S√©verin, 1903 - books.google.fr). Venite & audite Fulconem presbyterum tanquam alterum Paulum (Jacobus de Vitriaco, Historia orientalis et occidentalis, 1597 - books.google.fr). Le sanctuaire d'Aphrodite regorgeait √† tel point de richesses qu'il poss√©dait √† titre d'hi√©rodules plus de mille courtisanes, que des donateurs de l'un et de l'autre sexe avaient offertes √† la d√©esse ; elles attiraient, bien entendu, une foule de gens √† Corinthe et contribuaient √† l'enrichir ; les patrons de navires avaient t√īt fait de s'y ruiner ; de l√† vient le proverbe : De Corinthe le voyage / Ne peut √™tre le partage / Du premier venu. On rapporte m√™me ce mot d'une courtisane : √† une femme qui lui reprochait de ne pas aimer travailler et de ne pas toucher √† ses laines, elle aurait dit : ¬ęEh bien, telle que tu me vois, j'ai, en ce peu de temps, d√©j√† men√© √† bien trois entoilages.¬Ľ (Strabon, G√©ographie - Baladi√©, p. 183). Une autre source de richesse pour Corinthe, c'√©taient les foules attir√©es par les plaisirs offerts par plus d'un millier de prostitu√©es sacr√©es desservant le temple d'Aphrodite. Bien des introductions et des commentaires du Nouveau Testament insistent l√†-dessus, y voyant l'explication de l'importance que Paul a √©t√© amen√© √† accorder au sexe en 1 Co 5 - 7. Mais le contexte montre nettement qu'ici Strabon parle de la cit√© telle qu'elle existait ant√©rieurement √† 146 avant J.-C, non de la colonie romaine de fondation r√©cente qu'il a visit√©e en 29 avant J.-C. A cette √©poque, il n'y a vu qu'un ¬ępetit temple d'Aphrodite¬Ľ (21 b) ; le m√™me qualificatif convient aux deux temples mentionn√©s par Pausanias. Les fouilles n'ont mis au jour aucun temple d'Aphrodite, de quelque p√©riode que ce soit, correspondant aux chiffres mentionn√©s. On a mis en doute le r√©cit de Strabon m√™me pour la p√©riode ant√©rieure √† 146 avant J.-C. (Conzelmann, 1967). Si Strabon dit vrai, Corinthe s'est singularis√©e parmi toutes les cit√©s grecques. La prostitution sacr√©e ne fut jamais un usage grec et si Corinthe sur ce point a fait exception, il est impossible d'expliquer le silence de tous les autres auteurs anciens. Apparemment, Strabon aura combin√© entre eux des √©l√©ments pris √† des sources diff√©rentes pour aboutir √† une image totalement d√©form√©e de la r√©alit√©. Il savait qu'il y avait des femmes qui servaient dans le temple d'Aphrodite, - mais il ne s'agissait pas de prostitu√©es. Il connaissait la r√©putation licencieuse de Corinthe (voir plus loin) ; et peut-√™tre a-t-il interpr√©t√© √† contresens une ode de de Pindare. Il aura assembl√© tout cela √† la lumi√®re de ce qu'il savait personnellement de la ville de Comana, dans le Pont : il y avait l√† ¬ęune multitude de femmes qui tiraient profit de leurs charmes ; la plupart d'entre elles √©taient consacr√©es √† la d√©esse, car en un sens cette cit√© est une petite Corinthe¬Ľ (G√©ographie, 12, 3. 36). La prostitution sacr√©e √©tait courante en Orient et, en r√©alit√©, Strabon a fait de Corinthe ¬ęune grande Comana¬Ľ, en vertu d'une fausse pr√©misse selon laquelle la m√™me situation devait y r√©gner. Corinthe avait bien une certaine r√©putation en mati√®re de sexe. Aristophane (autour de 450-385 avant J.-C.) avait forg√© le verbe korinthiazesthai, ¬ęse conduire comme un Corinthien¬Ľ, c'est-√†-dire forniquer. Phil√©t√®re (IVe si√®cle avant J.-C.) et Polioque (Ath√©n√©e, Deipnosophistes, 313 c, 559 a) ont √©crit des pi√®ces intitul√©es korinthiast√™s, ¬ęLe d√©bauch√©¬Ľ. Dans une liste des produits caract√©ristiques de chaque cit√© grecque, Antiphanes (environ 388-311) accole ¬ędessus de lit¬Ľ au nom de Corinthe (Ath√©n√©e, Deipnosophistes, 27 d*). Platon (vers 429-347) emploie korinthia kor√™, ¬ęune fille de Corinthe¬Ľ, au sens de prostitu√©e (R√©publique, 404 D) (Jerome Murphy-O'Connor, Corinthe au temps de Saint Paul: d'apr√®s les textes et l'arch√©ologie, 1986 - books.google.fr). Paul pr√īne logiquement une chastet√© qui exalte une vie consacr√©e √† la pr√©paration du salut; en effet le Royaume est tout proche; la Parousie du Christ est attendue ; c'est pourquoi, comme le rappelle L. Rougier la premi√®re communaut√© chr√©tienne de J√©rusalem priait en appelant le retour du Christ : ¬ęMaranatha (Viens Seigneur! cf. 1 Cor. 16,22)¬Ľ Cette pens√©e s'exprime fortement √† travers les √Čp√ģtres de l'Ap√ītre des gentils comme la premi√®re lettre aux Corinthiens. [...] Toutefois cette chastet√©, √©tat id√©al symbolique de l'indiff√©renciation ou, si l'on pr√©f√®re, de l'uniformisation des √™tres le Royaume des cieux, n'est pas accessible √† tous et le risque du p√©ch√© est grand malgr√© la foi. En cons√©quence, le mariage, dans son aspect "hygi√©nique" (Hygieia en Gr√®ce, Salus √† Rome sont les divinit√©s de la sant√© du corps et de l'esprit), trouve sa place dans la pens√©e de Paul, mais au second rang derri√®re la chastet√©. Or, l'√©tat marital, ce pis-aller, entra√ģne pour les premiers chr√©tiens le rappel par Paul des normes d'une conduite sexu√©e pr√īn√©es par le juda√Įsme. La Premi√®re √Čp√ģtre aux Corinthiens exprime avec minutie l'opinion de Paul (Sylvie Vilatte, La repr√©sentation des femmes dans le discours savant du premier christianisme (Ier-IIe si√®cle), Femmes plurielles: Les repr√©sentations des femmes : discours, normes et conduites, 1999 - books.google.fr). Goussainville et
Goussainville Le nom de Roissy est devenu c√©l√©br√© dans l‚ÄôHistoire par ceux qui l‚Äôont port√©, et qui se sont distingu√©s dans leur √©tat en diff√©rentes mani√©r√©s. Sur la fin du XIIe si√®cle fleurit Pierre de Roissy, que Rigord qualifie Pr√™tre du Dioc√®se de Paris, homme lettr√© et de sainte vie, que Foulques, Cur√© de Neuilly, s‚Äôassocia pour pr√™cher la p√©nitence aux femmes de mauvaise vie. Il y a √† Rome, parmi les manuscrits de la Reine Christine de Su√®de, un volume intitul√© : Manuale Magistri P√©tri de Roissiaco Cancelarii Carnotensis, qui est sans doute du m√™me s√ßavant. Cet ouvrage dont j‚Äôai vu un exemplaire √† la Biblioth√®que de Saint Victor de Paris, et un autre dans celle du Coll√®ge des Cholets, ne paro√ģt pas avoir √©t√© imprim√© : c‚Äôest une explication des c√©r√©monies de la Messe qui commence par ces mots : Frumentum desiderat nubes, √©criture du XIIIe si√®cle. En 1482 Raoul Jouvenel des Ursins, Chanoine de Notre-Dame de Paris, paro√ģt avoir √©t√© le seul Seigneur de cette terre. Il avoit obtenu cette ann√©e-l√† au mois d‚ÄôAo√Ľt de Louis XI, √©tant √† Meun-sur-Loire, la haute Justice en cette Seigneurie, pouvoir d‚Äôy √©tablir Bailly, Pr√©v√īt, Voyer, Procureur, Garde-Scel et Sergens, dresser Fourches patibulaires et Prisons, avec exemption du ressort de la Ch√Ętellenie et Pr√©v√īt√© de Gonesse. Le Roi ayant √©crit au Parlement de v√©rifier ses Lettres, il y eut informations faites Reg. Parlant, de commodo et incommodo, et le 19 Novembre de la m√™me ann√©e 5 Sept. la Cour d√©clara que les Lettres Patentes seroient registr√©es pourvu que les habitans de Roissy ressortissent √† Gonesse en cas d‚ÄôAppel pardevant le Bailly \ ajoutant que le sieur Jouvenel n‚Äôaura ni Tabellion ni Scel √† Contracts, et tiendra cette Justice du Roi en foi et hommage √† cause du Ch√Ętelet de Paris. Mais quarante ans apr√®s, ces obstacles parurent lev√©s, puisque le sieur Juv√©nal des Ursins fit acquisition des droits qui lui avoient √©t√© contest√©s (Jean Lebeuf, Histoire de la ville et de tout le diocese de Paris, Tome 5, 1755 - books.google.fr). Pierre de Roissy commen√ßa de pr√™cher avec Foulques de Neuilly en 1198. ¬ęEn cette ann√©e, dit Vincent de Beauvais, Foulques s'adjoignit, pour le minist√®re de la pr√©dication, un autre pr√™tre nomm√© Pierre de Roissy, homme instruit et bon qui convertit beaucoup de libertins et d'usuriers. Il poussa plusieurs courtisanes publiques √† la continence conjugale, et pour les doter il obtint 250 livres des √©coliers et plus de 1000 livres des bourgeois ; d'autres, rejetant le mariage, prirent l'habit religieux et furent plac√©es dans la nouvelle abbaye de Saint-Antoine, fond√©e expr√®s pour elles ; d'autres enfin se condamn√®rent √† des p√®lerinages et √† de grandes fatigues¬Ľ Ce ne fut pas la seule Ňďuvre de Pierre de Roissy : sur l'ordre d'Innocent III, il pr√™cha aussi la Croisade (Alexandre Clerval, Les √©coles de Chartres au Moyen-√Ęge du Ve au XVIe si√®cle, M√©moires de la Soci√©t√© arch√©ologique d'Eure-et-Loir, Volume 11, 1895 - books.google.fr). Parmi tous les monuments de cette √©poque, aujourd'hui disparus, on rappellera l'√©glise de l'abbaye cistercienne Saint-Antoine-des-Champs fond√©e, on l'a dit, sous l'√©piscopat d'Eudes de Sully pour l'accueil des prostitu√©es converties (vers les rues actuelles Crozatier et de C√ģteaux) (Bernard Plongeron, Luce Pietri, Le Dioc√®se de Paris, Tome 1, 1987 - books.google.fr √Ä l'origine, maison d'accueil pour des prostitu√©es repenties fond√©e √† la fin du XIIe si√®cle par le cur√© de Neuilly-sur-Marne, Foulques, qui fut transform√©e en abbaye, rattach√©e √† l'ordre cistercien en 1204. Le monast√®re fut tr√®s t√īt li√© √† la monarchie cap√©tienne, ainsi Saint Louis √©tait pr√©sent lors de la d√©dicace de l'√©glise en 1233. Tout comme d'autres fondations f√©minines cisterciennes de la r√©gion parisienne (abbayes du Lys et de Maubuisson), Saint-Antoine-des-Champs abrite alors les tombeaux de deux filles de Charles V, Jeanne et Bonne de France, mortes toutes les deux en bas √Ęge en 1360 (Alexandre Bande, Le cŇďur du roi (2009), 2014 - books.google.fr Le chancelier du chapitre de la cath√©drale de Chartres entre 1205 et 1211, Pierre de Roissy, a r√©dig√© plusieurs hom√©lies destin√©es aux prostitu√©es et un trait√© sur la liturgie. A plusieurs reprises, entre autres en octobre 1208, le pape le chargea de juger certaines affaires en son nom. Son obit est tr√®s √©logieux : ¬ęLe 8 septembre, mourut v√©n√©rable personne Pierre de Roissy (Resseio), pr√™tre et chancelier, docteur en la Sainte √Čcriture, et excellent pr√©dicateur, orn√© √† un haut point du savoir et de l'√©loquence. Il l√©gua de nombreux livres √† cette √Čglise : les Histoires de Pierre le Mangeur, les Sentences de Lombard, un Psautier glos√©, les Epitres de saint Paul glos√©es, les Moralit√©s sur la Bible, l'Apocalypse et les Douze petits proph√®tes, les Epitres canoniques et les actes des ap√ītres glos√©s en un volume; des gloses sur Paneien Testament en deux volumes; les sermons de Bernard de Clairvaux; les √©pitres de Gains, Sidoine Apollinaire; le livre de S√©n√®que de naturalibus, en un volume (Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, Tome 1, 1862 - books.google.fr). Dans l'Historia Occidentalis, compos√©e en 1219 et 1221, Jacques de Vitry pr√©sente deux visages successifs de Paris, qui correspondent bel et bien aux deux temps classiques d'une conversion collective, intervenue selon lui √† la fin du XIIe si√®cle. Avant l'arriv√©e de Pierre le Chantre, peu apr√®s 1170, la capitale et plus encore le milieu scolaire baignaient dans les t√©n√®bres et dans le stupre. Tout a chang√© √† partir du moment o√Ļ l'ancien lecteur en th√©ologie de Reims a commenc√© son enseignement et son apostolat. √Ä partir de 1195, selon Jean Long√®re, il a √©t√© √©paul√© par son disciple Foulques, cur√© de Neuilly-sur-Marne, qui s'est charg√© de poursuivre l'Ňďuvre entreprise apr√®s le d√©c√®s de son ma√ģtre, survenu en 1197. Tr√®s appr√©ci√© des √©coliers et des simples fid√®les, Foulques serait devenu, √† en croire Jacques de Vitry, un nouveau saint Paul. Attirant les foules sur la place des Champeaux, √† proximit√© des Halles, il aurait op√©r√© de spectaculaires conversions en s√©rie. Il aurait ensuite cherch√© √† √©tendre cette r√©volution des mŇďurs au royaume de France et √† une partie de l'Empire. Arch√©type du proph√®te itin√©rant, √©cout√© √† la fois par le peuple et par les princes, il √©tait capable de terroriser les p√©cheurs, de gu√©rir les √Ęmes, de soigner les corps et d'att√©nuer les plaies sociales en d√©terminant les accapareurs √† ouvrir leurs greniers en p√©riode de famine. Il engendra une brillante lign√©e de disciples, salu√©e par l'auteur des Sermones vulgares, o√Ļ Etienne Langton c√ītoyait Robert de Cour√ßon, Adam de Perseigne et Jean de Nivelles. Vu le z√®le d√©ploy√© par ces ¬ęathl√®tes de la foi¬Ľ, Paris serait devenue, vers 1220, une ville fid√®le et glorieuse, un ¬ępuits d'eaux vives capable d'irriguer toute la surface de la terre¬Ľ. Quel qu'ait √©t√© le v√©ritable Foulques de Neuilly, dont Alberto Forni a montr√© qu'il menait une existence confortable, tr√®s diff√©rente de celle des asc√®tes farouches du XIIe si√®cle, retenons que le st√©r√©otype du missionnaire ¬ęconvertisseur¬Ľ est est constitu√© avant l'entr√©e en sc√®ne des Mendiants (Herv√© Martin, Sur la conversion en France au XIIIe si√®cle, Clovis, Tome I, 1997 - books.google.fr). La l√®pre est assimil√©e au p√©ch√© mortel qui s√©pare de Dieu. Richard de Saint-Victor, mort vers 1173, commente ainsi un passage de saint Matthieu : ¬ęAlors que J√©sus descendait de la montagne, la foule le suivit, et voici qu'un l√©preux venait se prosterner devant lui et disait : ‚ÄúSeigneur si tu veux, tu peux me purifier¬Ľ (Mt, 8.) ¬ęCe l√©preux est le genre humain qui demeura s√©par√© et fort √©loign√© de Dieu et de la Cit√© de Dieu, c'est-√†-dire J√©rusalem, qui En Haut est notre m√®re, tant qu'il fut l√©preux.¬Ľ Les clercs n'acceptent pas sans r√©serve l'id√©e de la l√®pre sanction et, entre la fin du XIe si√®cle et le milieu du XIIIe si√®cle, la maladie acquiert une signification plus positive, ambivalente, sinon contradictoire : image du p√©ch√©, mais aussi incitation √† la conversion, √©vocation des souffrances du Christ. Toutefois, en intitulant trois de ses sermons ¬ęaux l√©preux et aux rejet√©s¬Ľ, le franciscain Guibert de Tournai se diff√©rencie de Jacques de Vitry ou du dominicain Humbert de Romans. Alors que Jacques de Vitry par exemple associe les l√©preux aux autres malades qu'ils repr√©sentent en quelque sorte, Guibert s√©pare la parole destin√©e aux pauvres et aux malades de celle r√©serv√©e aux l√©preux et abjects ; le rejet succ√®de √† la distinction (Jean Verdon, Le Moyen Age, ombres et lumi√®res, 2013 - books.google.fr). On retrouve Jacques de Vitry au quatrain suivant IX, 57. Roissy jouxte Goussainville (Val d'Oise). Neuilly sur Marne (Seine saint Denis) jouxte Chelles (Seine et Marne) au sud de Roissy. Nous entrons maintenant dans le dioc√®se de Chartres, dont la partie nord le long de la Seine formait l'archidiacon√© du Pincerais, qui se divisait en doyenn√© de Poissy et doyenn√© de Mantes. Gr√Ęces au pouill√© chartrain du XIIIe si√®cle, publi√© par M. Gu√©rard dans le cartulaire de Saint-P√®re, nous connaissons parfaitement l'√©tendue de ces doyenn√©s √† cette √©poque, et tels qu'ils sont rest√©s jusqu'√† la R√©volution. Le doyenn√© de Poissy commen√ßait √† Maisons-sur-Seine et Saint-L√©ger-en-Laye, laissant Saint-Germain-en-Laye au dioc√®se de Paris; la Seine lui servait de limite jusqu'√† l'embouchure de la Mandre; de l√† il prenait les paroisses de La Falaise, Boinville, Goussainville, Hargeville, Saint-Martin-d'Elleville, Osmoy , Behout, la Queue, Montfort et Saint-L√©ger-en-Iveline; il laissait au doyenn√© de Mantes, Epone, Arnouville, Septeuil, Orgerus, Grosrouvre, Gambaiseul, Coud√© et la Boissi√®re. Le doyenn√© de Mantes touchait par cette extr√©mit√© le doyenn√© d'Epernon; il renfermait tout le canton de Houdan; enfin il prenait dans Eure-etrLoir une lisi√®re o√Ļ se trouvaient Senantes, Favorolles, Pr√©mont, Bu, Rouvres, Anet et Saussay, o√Ļ il retrouvait l'Eure pour limite (M. de Dion, M√©moire sur le pagus Madriacensis, Trente-sixi√®me session tenue a Chartres au mois de septembre 1869, 1870 - books.google.fr). Le prieur√© Saint-Thibault de Goussainville d√©pendait de l'abbaye de Bourgueil Trouv√®re, Raoul de Houdan re√ßut une √©ducation de clerc et mena, semble-t-il, une vie pauvre et errante. L'origine de son nom reste incertaine : Le Houdenc (Picardie) ou Houdan (Yvelines) selon M. Friedwagner (Edition de Meraugis) ? Il est l'auteur d'un roman arthurien, M√©raugis de Portlesguez, et de deux po√®mes all√©goriques, Le Songe d'Enfer et le Roman des Eles de courtoisie (www.universalis.fr, Gilles Roussineau, La vengeance Raguidel de Raoul de Hodenc, 2004 - books.google.fr). "Cherchant" Le chancelier du chapitre de la cath√©drale, Pierre de Roissy, a r√©dig√© plusieurs hom√©lies destin√©es aux prostitu√©es: faut-il voir dans le vitrail du Fils Prodigue une sorte d'√©cho de ce type de pr√©dication en images? On sait, par un texte du XIIIe si√®cle de de Thomas de Chobham, qu'√† Paris des prostitu√©es avaient souhait√© offrir une verri√®re. Le fait que l'√©v√™que Maurice de Sully ait refus√© ce don avait m√™me choqu√© le th√©ologien Pierre le Chantre. On peut donc parfaitement imaginer que ces images sont le d√©veloppement des habituels portraits du travail humain, d√©veloppement qui n'est pas unique puisque la verri√®re de saint Lubin (baie 45) leur donne aussi une place tr√®s importante. Comment justifier autrement l'absence, exceptionnelle √† Chartres, de donateurs ? On conna√ģt, par les autres verri√®res, en particulier celle du Samaritain, le souci des concepteurs de trouver une mani√®re d'int√©grer ces destinataires dans le r√©cit. Cette int√©gration est ici parfaitement r√©ussie. La digression a peut-√™tre pour fonction de d√©signer le risque principal principal qui guette le p√®lerin au d√©tour de son itin√©rance. Elle t√©moigne en tout cas √† la fois de la tr√®s grande libert√© des hommes du Moyen √āge par rapport au texte √©vang√©lique et de l'extr√™me tol√©rance d'une soci√©t√© qui confie √† l'Ňďuvre d'art, et √† un lieu sacr√©, des sujets que bien des √©poques ult√©rieures, jusqu'√† la n√ītre, entourent de tabous (Colette Manh√®s, Jean-Paul Deremble, Vitraux de Chartres, 2003 - books.google.fr). Une verri√®re de la cath√©drale repr√©sente saint Nicolas (cf. quatrains VI, 78 ; IX, 59) donnant des pi√®ces d'or √† trois jeunes filles pauvres pour leur √©viter la prostitution. L'√©dification, sur les frais communs de la cit√©, du prostibulum publicum r√©pond au souci de r√©guler une activit√© en lui donnant des limites visibles. Le lupanar est une chose d'utilit√© publique, et la publicit√© que lui fait le vitrail atteste de la normalisation de son √©tablissement. Normal en est l'usage pour ce jeune homme riche, comme il l'est pour les jeunes gens ais√©s de ce d√©but de XIIIe si√®cle : l'acc√®s au prostibulum n'est r√©pr√©hensible que pour les clercs ou les hommes mari√©s. La fr√©quentation de ces lieux, loin de pr√™ter √† scandale, fait figure de pratique coutumi√®re, et c'est de cela d'abord dont le vitrail t√©moigne (Marie-Madeleine Gauthier, Colette Deremble, Les saintes prostitu√©es, l√©gende et imagerie m√©di√©vales, La Femme au moyen√Ęge: Actes du colloque, Maubeuge 1988, 1990 - books.google.fr). Au d√©but du XIIIe si√®cle, aux environs des ann√©es 1208 √† 1213, au temps o√Ļ l'on commence √† concevoir l'iconographie des baies lat√©rales Nord et Sud, Pierre de Roissy, √† son tour dans son trait√©, Job Glossatus secundum Magistrum Petrum cancellarium Carnotensem, reprend l'interpr√©tation typologique donn√©e de Job par saint Gr√©goire qu'il conna√ģt √† l'√©vidence, puisqu'il le cite √† maintes reprises. Qu'est-ce qu'un h√©r√©tique ? Comme nous l'avons dit, un chr√©tien adoptant de fausses doctrines. En aucun cas il ne s'agit de fid√®les d'une autre religion ni de philosophes. Dans les textes des IIIe et IVe conciles du Latran o√Ļ le terme ¬ęh√©r√©tique¬Ľ revient fr√©quemment, il en est bien ainsi. Et Pierre de Roissy √©tait homme trop savant pour avoir donn√© √† la l√©g√®re une acception diff√©rente √† ce terme. En revanche, nous allons bient√īt voir qu'au tympan de Chartres les opposants d√©sign√©s ne seront plus simplement les h√©r√©tiques. Malgr√© son obscurit√©, la description du chancelier de Chartres nous livre quelques indications int√©ressantes. A son tour il interpr√®te les noms des amis : Les trois amis de
Job, entendant par là ceux qui étaient de faux amis
et qui cependant viennent pour le consoler. Par ces gens-là on comprend
allégoriquement les hérétiques qui se disent faussement amis des simples
chrétiens. Parce qu'ils se prétendent amis, et sous prétexte de recevoir une
consolation, des chr√©tiens viennent √† eux. Le point d'o√Ļ ils sont partis permet
de les appeler √Čliphaz, qui signifie m√©pris de Dieu.
Ils sont hérétiques parce qu'ils ont du mépris et Thémanites
(de Téman) qui signifie vent du Sud. Ils disent
qu'ils ont, eux, le vent du Sud , c'est-à-dire
l'Esprit Saint, duquel "lève-toi Aquilon, et viens vent du Nord". De
même, Bildad qui doit être interprété comme
vieillesse, simplement parce que ceux-là sont pécheurs depuis longtemps et Suithes qui signifie parlant parce qu'ils disent qu'ils
ont, eux, la parole de Dieu. De même Sophar qui doit être interprété comme chercheur parce
que ceux-là disent eux-mêmes qu'ils examinent le monde céleste et qu'ils ont
l'intelligence de l'√Čcriture Sainte et Nantaa que
l'on doit interpréter par beauté parce qu'ils disent qu'ils ont, eux, la beauté
des vertus Le vers 4 semble renvoyer ces pr√™cheurs au Sophar du Livre de Job. L'injonction v√©t√©ro-testamentaire √† placer les l√©preux ¬ęhors du camp¬Ľ (Nombres, 5, 1-3) participe de la d√©limitation du pur et de l'impur, tandis que la purification du l√©preux par le Christ annonce la mission apostolique. La l√®pre entre ainsi dans un jeu all√©gorique qui caract√©rise, comme autour de la figure de Job, ¬ęles errements propres √† la nature d√©chue de l'homme¬Ľ (p. 106), entre p√©ch√© et r√©demption. L'association du p√©ch√© de et de la maladie de la chair, en relation avec les interdits du sang et du sexe, explique la contamination morale du discours m√©dical (qui fait par exemple de la l√®pre la cons√©quence du commerce des prostitu√©es). A l'inverse, l'id√©al monastique, qui valorise le m√©pris du monde et le m√©pris du corps, contribue √† faire de la maladie une ¬ęinvitation √† la perfection¬Ľ (p. 192). ¬ęPurgatoire pr√©sent¬Ľ selon Jacques de Vitry, la l√®pre conf√®re une fragilit√© exemplaire. Le l√©preux sanctifi√© se rapproche du Christ, et offre aux autres l'occasion de la saintet√© (ce que dit la l√©gende de saint Julien l'Hospitalier) : il n'est pas n√©cessairement un r√©prouv√©. En dehors de la diffusion d'un mod√®le d'assistance que r√©sume l'image de Saint Louis faisant l'aum√īne √† un ¬ęmesel¬Ľ et baisant sa main, Fr.-O. Touati montre d'ailleurs qu'avec saint Martin, Clovis (qui, lors du bapt√™me, selon Gr√©goire de Tours ¬ęs'avance, nouveau Constantin, vers la piscine pour se gu√©rir de la maladie d'une vieille l√®pre¬Ľ), et saint Denis (un l√©preux, ensuite gu√©ri, aurait √©t√© le seul t√©moin de la venue du Christ dans la basilique √† la veille de la cons√©cration), la l√®pre intervient dans la constitution symbolique de la royaut√© thaumaturge et sacr√©e (A. Provost, Compte rendu de "Maladie et soci√©t√© au Moyen √āge. La l√®pre, les l√©preux et les l√©proseries dans la province eccl√©siastique de Sens jusqu'au milieu du XIVe si√®cle" de Fran√ßois-Olivier Touati, 1998, Revue historique, 1999 - books.google.fr). Acrostiche : CECC, cecca CECCO D'ASCOLI, c√©l√®bre encyclop√©diste italien, n√© √† Ascoli, en 1257, br√Ľl√© en 1327. Il est d√©sign√© dans toutes les biographies sous le nom que nous venons de transcrire; mais son v√©ritable nom √©tait Francesco (dont Cecco est un diminutif) (Jean Chr√©tien Ferdinand Hoefer, Nouvelle biographie g√©n√©rale, Tome 9 : Casenave - Charost, 1854 - books.google.fr). Fran√ßois d'Assise avait 16 ou 15 ans en 1197. Mais "cecca" d√©signe la monnaie en italien ("zecca") (Fernand Braudel, La M√©diterran√©e et le monde m√©diterran√©en √† l'√©poque de Philippe II, Tome 1, 1966 - books.google.fr). Les Banquiers Lombards & Carsins furent jadis, & sont encor fort industrieux lezineurs, duits & dressez √† subtiliser sur les formules, sur les termes & les syllables des escritures, √† leur tourner le nez, pour les tirer √† contrepoil du cost√© de leur profit, Matheus Parisius in Historia Henrici tertij ad annum 1235.. Les Fran√ßois & tous les Peuples de de√ßa les Alpes, leur sont obligez de ce qu'ils leur ont apris l'Vsance Rafin√©e de l'Vsure, la Morale & Politique fourbe, ensemble l'exercice diuertissant de la chicane, lesquels sur leur complant y ont fait de grands aduancemens, & des prodigieuses excroissances, comme dit Monsieur Boudin en Sa Republique, Mathieu Paris l'atteste de la sorte, ad annum 1197. Istis diebus surrexit in Francia quidam pradicator egregius cui nomen Fulco qui vsuramin Francia maxim√® conatus est extirpare, quandoquidem ufura in Francia ab Italia transiens pululauerat nimis, & nobile Regnum iam maculauerat (Estienne Cleirac, Vsance du negoce, ou Commerce de la banque des lettres de change, 1656 - books.google.fr). Fulco est Foulques de Neuilly. La date de fondation de Saint Antoine des Champs est parfois repouss√©e √† 1197 (√ßa arrange la typologie) (Katherine Ludwig Jansen, The Making of the Magdalen: Preaching and Popular Devotion in the Later Middle Ages, 2001 - books.google.fr). Typologie En prenant la date pivot de 1197 et en y reportant 2145 on obtient 249. Mais, par malheur, l'√©p√©e ou plut√īt le poignard des soldats avait toujours le dernier mot. Et les deux Gordiens, et l'empereur patricien Balbinus, et l'empereur serrurier Maxime, et au bout de quelques ann√©es le jeune Gordien, tout cela est ou assassin√© ou contraint au suicide. Mais apr√®s eux, le hasard des r√©volutions am√®ne sous la pourpre, non plus seulement un prince tol√©rant, mais un prince chr√©tien, le t√©moignage de l'antiquit√© eccl√©siastique nous autorise √† le croire ; chr√©tien peu digne de ce nom, nous sommes oblig√©s de le dire. Soixante ans avant Constantin, l'Arabe Philippe porte dans le palais des C√©sars un front consacr√© par le bapt√™me. Et cet av√©nement du premier prince chr√©tien √† Rome est signal√© par le premier acte d'autorit√© de l'√Čglise chr√©tienne sur les princes. Lorsque Philippe, devenu Auguste par le meurtre de son pr√©d√©cesseur, se pr√©senta dans l'assembl√©e des fid√®les pour faire son offrande au temps de la p√Ęque, l'√©v√™que Babylas le repoussa comme plus tard l'√©v√™que Ambroise devait repousser Th√©odose ; comme Th√©odose, il se soumit, et le premier C√©sar chr√©tien fut le premier C√©sar p√©nitent. Il y eut donc pour l'√Čglise un moment de paix et m√™me de gloire. Les jeux s√©culaires qui marqu√®rent l'ach√®vement du premier mill√©naire romain furent c√©l√©br√©s par un prince chr√©tien, qui, selon le chr√©tien Orose, voua par la pens√©e cette solennit√© √† la gloire du Christ, la c√©l√©bra sans monter au Capitole et sans immoler une victime. Mais, bien plus que de son C√©sar, l'√Čglise pouvait se glorifier de ses √©v√™ques et de ses docteurs. Babylas √† Antioche, Cyprien √† Carthage, Gr√©goire le Thaumaturge √† N√©oc√©sar√©e dans le Pont, Firmilianus √† C√©sar√©e en Cappadoce, Denys √† Alexandrie, Orig√®ne en Palestine, √† Alexandrie ou pour mieux dire partout ; presque tous pa√Įens convertis, presque tous avant leur bapt√™me ou nobles, ou savants, ou philosophes, √©taient v√©n√©r√©s m√™me des Gentils. L'√Čglise √©tait en paix, et cette paix profitait √† la soci√©t√© romaine. Philippe osait faire √† Rome ce qu'Alexandre S√©v√®re avait √©t√© tent√© d'y faire, mais n'avait point os√© Habuit ((Alexander Severus in animo ut exoletos vetaret, quod postea Philippus fecit. Lamprid., in Alex. Sever., 23). A Rome, jusqu'au milieu du IIIe si√®cle, c'est-√†-dire, jusqu'au r√®gne de l'empereur Philippe, il y eut des maisons publiques de mignons, scorta virilia, √©galement soumises √† l'imp√īt sp√©cial des prostitu√©es. Philippe parvint √† les abolir. Mais c'en √©tait trop pour le monde pa√Įen. Il pouvait bien supporter un prince assassin, et il en avait support√© beaucoup; mais il ne pouvait supporter un prince qui se soumettait √† la censure √©piscopale et qui pr√©tendait purifier les mŇďurs de Rome. La patrie pa√Įenne √©tait en danger. Des r√©voltes militaires √©clatent, Philippe est vaincu, et il est tu√© par ses propres soldats. M. Julius Philippus, fils d'un chef de voleurs, n√© √† Bostra, en Arabie, devient pr√©fet du pr√©toire en 243, Auguste, le 10 mars 244, consul, 245, 247, 248. Il est vaincu par D√®ce et tu√© le 10 mars 249, ainsi que son fils M. Julius Philippus, qu'il avait fait C√©sar (Franz de Champagny, Les Antonins: Ans de J.-C. 69-180. Suite de C√©sars et de Rome et la Jud√©e, Tome 3, 1875 - books.google.fr, Alexandre Monnier, Histoire de l'assistance dans les temps anciens et modernes, 1856). Ainsi en 1197 r√©gnait Philippe II Auguste (cf. quatrain suivant IX, 57), et, en 249, Philippe l'Arabe, Auguste depuis 244. L'abb√© Lebeuf puis L√©opold Delisle ont fait na√ģtre Philippe Auguste √† Gonesse. Si le premier ne pr√©sente pas cependant le fait comme certain, le second a avanc√© les trois arguments suivants √† l'appui de sa th√®se. Le roi Philippe Auguste est appel√© ¬ęde Gonesse¬Ľ dans trois textes des XIIIe et XIVe si√®cles. A fa fin du petit pastoral du Cartulaire de Notre-Dame, une liste des rois de France compos√©e au temps de Saint Louis mentionne Philippe Auguste de la fa√ßon suivante : ¬ęPhilippus de Gonessa, filius Ludovici¬Ľ. En 1261, l'un des compilateurs de la G√©n√©alogie de saint Arnoul √©crit : ¬ęRegina genuit Philippum de Gonesse, regem Franciae, ex Ludovico rege¬Ľ. Enfin dans une liste de rois de France contenue dans un registre manuscrit de la Chambre des Comptes datant du XIVe si√®cle, L. Delisle a relev√© l'√©num√©ration suivante : ¬ęLudovicus Grossus, Ludovicus, Ludovicus de Gonessia, Ludovicus qui decessit apud Montpansier¬Ľ. Il faut lire en fait Philippus et non Ludovicus et il s'agit bien de Philippe Auguste qui figure entre Louis VI le Gros, Louis VII le Jeune et Louis VIII mort √† Montpensier en 1226. Le deuxi√®me √©l√©ment de la d√©monstration est le passage de la Grande Chronique de Tours compos√©e dans la premi√®re moiti√© du XIIIe si√®cle, dans lequel la terre de Gonesse est repr√©sent√©e comme le ¬ępatrimoine¬Ľ par excellence de Philippe‚ÄĒAuguste. [...] La r√©compense que re√ßut le sergent qui annon√ßa √† Louis VII, retenu √† Etampes, "une rente de trois muids de froment √† prendre sur la grange de Gonesse", la naissance tant attendue de son fils constitue le dernier argument de L. Delisle. Un quatri√®me argument qui a √©chapp√© √† Delisle est signal√© successivement par H. Delaborde puis par A. Cartellieri. Deux vers du po√®me de Philippe Mousket r√©v√®lent que Philippe Auguste dut r√©sider √† Gonesse pendant son enfance : ¬ęA la Gonesse fu nouris S'ot non Felipes de Gonnesse¬Ľ. Ces √©l√©ments suffisent-ils √† prouver la naissance gonessienne de Philippe II ? Les textes relatifs √† la naissance du roi sont rares. Le plus souvent, les auteurs comme Rigord se contentent d'√©noncer bri√®vement l'√©v√©nement en insistant surtout sur l'int√©r√™t politique de celui-ci, car jusqu'alors ¬ę...li rois Loys ses peres, qui estoit sains hons et bons crestiens, avoit receues pluseurs filles de III fames que il ot espous√©es; ne avoir ne pooit nul hoir masle, qui apr√®s lui governast le roiaume de France¬Ľ. La reine Alix, m√®re de Philippe, s√©journait-elle √† Gonesse le soir du samedi 21 ao√Ľt 1165 ? Rien ne permet de l'affirmer. Pas m√™me la charte dans laquelle Louis VII fait don √† Ogier d'une rente annuelle de trois muids de froment. Nous avons vu en effet que les lib√©ralit√©s royales puisaient beaucoup dans la grange de Gonesse bien avant la naissance de Philippe Auguste. Quant au surnom gonessien du roi assez r√©pandu il est vrai, il faut sans doute l'attribuer au fait que le domaine poss√©d√© par les Cap√©tiens √† Gonesse et les revenus qui lui √©taient li√©s avaient √©t√© donn√©s par Louis VII au jeune prince pour (Jean Pierre Blazy, Gonesse, la terre et les hommes: des origines √† la R√©volution, 1982 - books.google.fr). Le Crou, ou le Crould, Crodoldus, autrement nomm√© la riviere de Gonesse, a sa source √† la fontaine de Goussainville. Ce lieu est un gros Bourg, & un Chateau qui appartiennent √† M. de Nicola√Į Premier Pr√©sident de la Chambre des Comptes de Paris. On pr√©tend que les eaux seules de ce Ruisseau contribuent √† la bont√© du pain qui a pris son nom du Bourg de Gonesse. Cela est fond√© sur l'exp√©rience de ceux quitravaillent tous les jours √† former ce pain. Olivier de Serres, dans son Theatre d'Agriculture, rapporte que les Boulangers de Gonesse ayant √©t√© interrog√©s juridiquement sur ce qui donnoit √† leur pain les bonnes qualit√©s qu'on y remarqu√© , ils r√©pondirent unaniment que c'√©toit l'effet de l'eau dont ils se servoient. Mais, si c'est √† l'eau qu'il faut rapporter les qualit√©s particulieres de ce pain, d'o√Ļ vient qu'on n'en fait pas de pareil dans tous les lieux qu'arrose ce ruisseau ? Ils r√©pondront peut-√™tre que les qualit√©s de l'eau de la fontaine de Goussainville y sont trop alt√©r√©es par celles des ruisseaux que le Crould re√ßoit dans son cours. Mais √† cela on peut repliquer, & demander pourquoi le pain qu'on fait √† Goussainville n'a ni le go√Ľt, ni la blancheur de celui qu'on fait √† Gonesse (Jean Aymar Piganiol de La Force, Nouvelle description de la France, Tome 1, 1753 - books.google.fr). |