

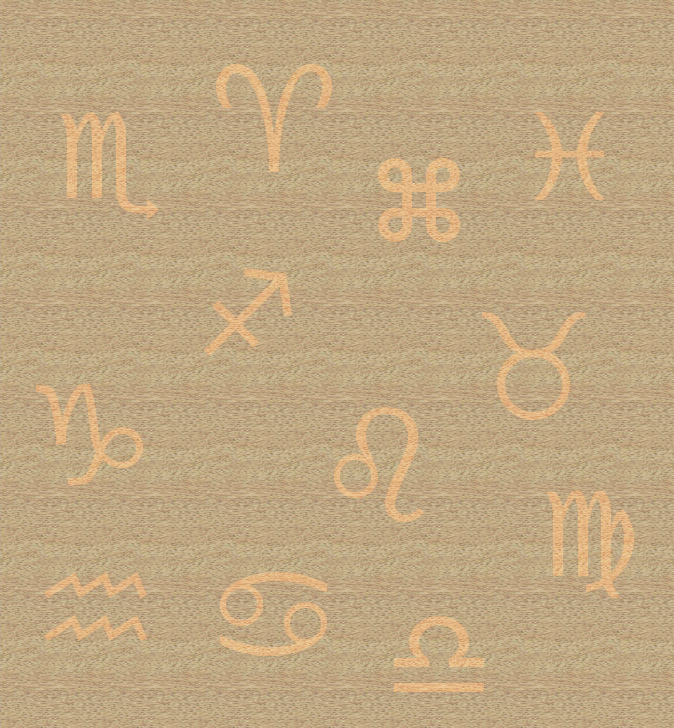
|
Le miroir ardent III, 13 1714 Par foudre en l'arche or & argent fondu,
De deux captifs l'un l'autre mangera De la cité le plus grand estendu,
Quand submergee la
classe nagera. Un
"foudre" plutĂ´t que la foudre : miroir ardent Le terme arche
désigne plutôt en verrerie les fours accessoires qui entourent le four
principal (on parle d'arche à pots, d'arche à recuire) (André
Claude, Un artisanat minier, 1974 - books.google.fr, Encyclopédie
méthodique: ou par ordre de matières: par une société de gens de lettres, de
savans et d'artistes, Tome 8, 1791 - books.google.fr). On attribuë la premiere invention de
ces Miroirs ardens à Promethée,
qui la chercha pour dérober le feu du Ciel & l'apporter en terre (Hésiode)
; & dont Archimede s'est heureusement servi pour la
défence de sa Patrie, en brûlant par son moyen
les Navires de Marcellus, qui avoit assiegé la ville de Siracuse :
ayant placé son Miroir ardent sur la plus haute tour de la Ville, d'où il lança
ce foudre impitoyable de Jupiter, qui excita en peu de tems
une horrible incendie sur cette grande Flotte, que Neptune ny
les eaux de la Mer ne purent sauver (Jean
Haudicquer de Blancourt, De l'art de la Verrerie, 1697 - books.google.fr, Joseph
Rouyer, Coup d'oeil rétrospectif sur la lunetterie, 1901 - books.google.fr). Un verre ardent (en latin : lens
caustica) est une grande lentille convexe qui permet
de concentrer les rayons du soleil sur une petite surface, la chauffant et
provoquant sa combustion. Les verres ardents étaient utilisés au XVIIIe siècle
pour étudier la combustion de certains matériaux et analyser les gaz qui
Ă©taient Ă©mis. On utilisait Ă©galement des miroirs ardents pour obtenir un
résultat similaire au moyen de surfaces réfléchissantes afin de concentrer la
lumière du soleil sur un point. La technologie des verres ardents est connue depuis
l'antiquité. Des vases remplis d'eau étaient alors utilisés pour allumer un
feu. Des verres ardents étaient utilisés pour cautériser des blessures et pour
allumer les feux sacrés dans les temples. Plutarque fait référence à un miroir
ardent, composé de miroirs métalliques triangulaires, installé dans le temple
des vestales. Aristophane mentionne les verres ardents au IVe siècle av. J.-C.
dans sa pièce Les Nuées. On dit qu'Archimède, le célèbre mathématicien, a
utilisé un verre ardent (ou, plus vraisemblablement, un grand nombre de miroirs
hexagonaux) comme arme en 212 av. J.-C., lorsque Syracuse fut assiégée par
Marcus Claudius Marcellus. La flotte romaine aurait été incendiée, mais
finalement la ville fut prise, et Archimède tué. La légende d'Archimède a donné
lieu Ă de nombreuses recherches sur les verres et miroirs ardents, jusqu'Ă la
fin du XVIIe siècle. Ils furent fabriqués avec succès par Proclos
(Ve siècle) (qui, grâce à eux, aurait détruit la flotte de Vitellius assiégeant
Constantinople)2, Anthemius de Tralles
(VIe siècle), Ibn Sahl, dans son Des miroirs et
verres ardents (Xe siècle), Alhazen dans son Traité d'optique (1021), Roger
Bacon (XIIIe siècle), Giambattista della Porta et ses
amis (XVIe siècle), Athanasius Kircher et Gaspar
Schott (XVIIe siècle), le Comte de Buffon à Paris en 1740. Ces recréations
montrent la plausibilité de la réalisation d'Archimède (fr.wikipedia.org - Verre
ardent). "submergee la classe nagera" :
le feu et l'eau Après la mort du petit-fils de Hiéron, Hippocrate,
général des Syracusains, voulut se placer sur le trône. Pour réussir, il brigua
la protection des Carthaginois, et leur sacrifia tous les Romains qui se
trouvaient alors Ă Syracuse, en les faisant mourir. Le consul Marcellus passa
en Sicile pour venger cet outrage, et fit le siége de
Syracuse par mer et par terre. Il l'attaqua du côté de la mer avec soixante
galères à cinq ordres de rames. Il établit sur huit vaisseaux attachés
ensemble, et affermis par des ancres, une vaste machine destinée à battre les
murs. Son appareil de guerre était formidable, et il aurait brusqué la prise de
cette place, sans Archimède qui la défendait. Ce grand ingénieur
fit pleuvoir, par le moyen de ses machines, sur l'armée de terre des
assiégeants, une grêle de grosses pierres qui rompirent les rangs et qui mirent
les troupes en désordre. Ensuite, il désola leur flotte en lançant de dessus la
muraille des pierres du poids de dix quintaux, sur les huit vaisseaux attachés
ensemble, et les mit en pièces, coula
une partie des autres avec un grand nombre de madriers qui, en tombant sur ces
navires, les enfonçaient dans l'eau.
Les uns, saisis par la proue avec des mains de fer qui les Ă©levaient, Ă©taient
plongés dans la mer par la poupe; d'autres, accrochés au dedans par de forts
grappins jetés des deux côtés du vaisseau, pirouettaient et s'allaient rompre
sous les murs de la ville; quelques-uns,
élevés en l'air, se brisaient ou s'abîmaient. Enfin il brûla plusieurs
vaisseaux romains, Ă la distance de trois milles, avec des verres ardents de
forme parabolique. Marcellus, ennuyé de se battre contre des ennemis
invisibles, cherchait tous les moyens de parer leurs coups. Comme les machines
d'Archimède, violemment tendues, portaient au loin, il se rangea au pied des
murs, dans la pensée qu'il y serait hors de leur portée. Mais Archimède fit
jouer d'autres machines qui tiraient de près. Les Romains furent donc accablés
d'une multitude de traits et de pierres, qui tombaient de haut et d'aplomb sur
eux et les écrasaient. Marcellus, obligé de quitter les murs et de s'éloigner,
perdit encore dans sa retraite beaucoup d'hommes et de vaisseaux, toujours par
l'effet des machines qui les atteignaient. Enfin, le courage des Romains Ă©tait
à bout, lorsque la place fut surprise. Marcellus peu de temps après fut rappelé
Ă Rome; il y transporta un nombre infini de statues et de tableaux,
chefs-d'œuvre des arts, dont Syracuse alors était le dépôt; mais ces richesses
étaient les dépouilles de la Grèce entière, inconnue aux Romains pour ainsi
dire. Quelques jours avant la prise de Syracuse, Octacilius
étant parti de Lilybée avec quatre-vingts galères, fit voile vers Utique, où il
n'était point attendu. Il y enleva cent trente vaisseaux chargés de blé,
ravagea la campagne et s'en retourna ensuite (Histoire
générale de la marine: comprenant les naufrages célèbres, les voyages autour du
monde, Tome 1, 1853 - books.google.fr). Cannibales et
Archimède : Montaigne et la préséance Pour Montaigne, la prééminence donnée au courage par les
cannibales est plus significative que leur nudité qui fait scandale. Le seul passage
des Essais oĂą Montaigne parle
proprement de son propre rapport aux règles de préséance, est dans le chapitre
«De la vanité». Montaigne utilise le mot
une autre fois au sens figuré à propos d'Archimède comme maître de cette «science
qui s'attribue la presseance sur toutes les autres»
(II, 12, 565 B). Dans la «police»
des cannibales, on retrouve également ce genre de réciprocité entre vertu et
préséance. Dans sa conversation avec un cannibale à Rouen, Montaigne lui
demande «quel fruit il recevoit de la superiorité qu'il avoit parmi les
siens [...] il me dict que c'estoit
marcher le premier a la guerre». Montaigne admire évidemment la vaillance de ce
roi-capitaine, et la fin de l'essai est pleine d'ironie par rapport aux
jugements portés sur les cannibales (Anders
Toftgaard, La cérémonie entre préséance et civilité: le chapitre I, 13 et
l'innutrition italienne des "Essais", Les chapitres oubliés des
essais de Montaigne: actes des journées d'étude à la mémoire de Michel Simonin,
2011 - books.google.fr). Cannibales :
Carthaginois ? Tite-Live rapporte
qu'Annibal faisoit manger de la chair humaine Ă ses
soldats, pour les rendre plus fiers & plus intrépides dans le combat (Dictionnaire
universel françois et latin, Tome 1, 1771 - books.google.fr, fr.wikipedia.org - Hannibal
Lecter). Gregorio Garcia
dans Origen de los Americanos
(1607), dit que "cannibale" et
"Annibal" proviennent d'une même racine sémitique (Alexander
von Humboldt, Aimé Bonpland, Personal Narrative of Travels to the Equinoctial
Regions of the New Continent: During the Years 1799-1804, traduit par Helen
Maria Williams, 2011 - books.google.fr). Le siège de Syracuse se déroule au cours de la deuxième
guerre punique (fr.wikipedia.org - Siège de Syracuse (213 av. J.-C.)). "De deux captifs l'un l'autre mangera" L'aspect spéculaire de l'expression "l'un l'autre" apparaît quand il est question de miroir (ardent). L'interprétation que donne Venturi de ce passage, d'après un manuscrit défectueux, ne résiste pas à l'examen : «Si deux hommes se regardent l'un l'autre dans le même miroir, l'œil de l'un voit l'œil de l'autre par le même point du miroir par lequel il en est vu». Le texte, tel que le donne Govi, impose une autre interprétation. Dans l'expression «situs oculorum», il n'est pas question de deux observateurs, et «alter alterum» désigne l'un et l'autre œil du même observateur en convergence sur un point du miroir. Il est question en outre de «ab altero oculorum» et de «in altero oculo», ce qui lève les derniers doutes. Du coup, le sens s'éclaire. L'observateur tient les yeux fixés sur un point de la surface spéculaire. Les deux yeux s'aperçoivent l'un l'autre en même temps. C'est donc que le trajet du rayon émis par l'œil droit et réfléchi sur l'œil gauche coïncide en tous ses points avec le trajet du rayon émis par l'œil gauche et réfléchi sur l'œil droit par le même point. Si les angles d'incidence n'étaient pas égaux aux angles de réflexion, la coïncidence du tronçon réfléchi du rayon appartenant à un œil avec le tronçon incident du rayon appartenant appartenant à l'autre œil serait évidemment impossible. Le texte prend un sens acceptable, mais nous n'apercevons pas la portée démonstrative de l'expérience décrite. Le passage où Ptolémée décrit l'expérience relative à la troisième loi de la réflexion est, au premier abord, fort obscur. le reproduire in extenso : «Fit etiam simili modo, cum fuerit situs oculorum sic constitutus, ut alter videat alterum in eodem tempore, quod fit cum ex utrisque in simul visus ceciderit super unum et eundem punctum de illis, qui sunt in speculo. Quod si ita non fit, accidit nullum eorum videre alterum, et hoc significat quod radii visus refracti sint ad invicem. Ex his quoque patet , quod reverberatio fit ad rectos angulos ; angulus enim erit unus et idem propter casum alterius duorum radiorum super speculuin, et reverberationem alterius radii a speculo. Si vero posuerimus illos esse inaequales in utraque parte, necesse est fieri ab altero oculorum radium obviante superficiel speculi angulum maiorem illo, qui fit ex radio post reverberationem eius a speculo, in altero autem oculo fieri e converso, videlicet ut angulus radii post reverberationem fit maior angulo alterius radii, qui cadit super speculum». (Albert Lejeune, Les lois de la réflexion dans l'optique de Ptolémée, L'Antiquité classique, Volume 15, 1947 - books.google.fr, Albert Lejeune, L'optique de Claude Ptolémée: dans la version latine d'après l'arabe de l'émir Eugène de Sicile, 1989 - books.google.fr). Archimdède est fait prisonnier par un soldat romain qui le tue. Lorsque, suivant le récit de Diodore, Syracuse fut livrée en trahison à Marcellus, ou, suivant Dion, lorsque la ville fut prise par les Romains pendant que les citoyens célébraient une panégyrie de Diane, voici ce que l'on rapporte de la mort d'Archimède : Il était baissé et occupé du dessin d'une machine, quand un soldat romain survint, et voulut le faire marcher comme prisonnier. Archimède, uniquement livré à son travail, se contenta de dire, «Range-toi, mon ami, et prends garde à mon dessin;» et, comme on continuait à l'entraîner, Archimède, en se retournant, reconnut que cet homme était un Romain, et s'écria : «C'en est fait, hélas! de ma belle machine !» Le soldat, frappé de cette exclamation, tua sur-le-champ celui qui l'avait faite, vieillard sans défense, mais véritablement un Dieu pour la science des machines. En apprenant ce meurtre, Marcellus versa des larmes, ensevelit le géomètre dans le tombeau de ses pères, en présence d'un nombreux concours des Romains les plus distingués, et je crois qu'il fit punir de mort l'assassin. Cette anecdote est rapportée par Dion et par Diodore (Tzètzès, Chiliade II) (Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, traduit par André François Miot de Mélito, 1837 - books.google.fr). Archimède, captivé par ses études, en oubliait de manger. Archimède avoit une ardeur invincible pour l'étude. On raconte de lui que, sans cesse retenu par les charmes de l'étude, il oublioit de boire et de manger. Traîné souvent par force aux bains et aux étuves, il traçoit des figures de Géométrie sur les cendres, et des lignes sur son corps enduit d'essence (François Peyrard, Jean Baptiste Joseph Delambre, Oeuvres d'Archimède, 1807 - books.google.fr). Plutarque parle d'ensorcellement par une sirène privée et domestique (Mireille Courrent, Eurêka, eurêka, Archimède ou la naissance de la mythologie de la science, Mythes et savoirs dans les textes grecs et latins, 2008 - books.google.fr). Au moyen âge la sirène est sculptée sur les chapiteaux romans tenant un miroir. Cf. quatrain III, 21 - Les deux maisons de Properce - 1720 Nous voudrions pousser la comparaison entre ce qu'Ulysse entend du chant des Sirènes et l'effet paralysant que peut procurer l'apparition de sa propre image dans un miroir. Il nous semble que le piège du chant des Sirènes relève d'une tromperie propre au principe de duplicité. Le miroir a toujours historiquement été reçu comme un objet ambivalent, offrant connaissance mais aussi reflet trompeur. L'exemple de Narcisse est probablement le plus connu d'une prise au piège par l'effet de miroir. Ce dernier joue sur l'écart entre identité et différence, sur l'inadéquation entre l'être et sa représentation. Le miroir décale es inverse. Et surtout, par l'image qu'il reflète, il peut paralyser celui qui le regarde, le figer dans une position contempla-tive. La fascination pour sa propre image est un des ressorts du mythe de Narcisse. Dans l'épisode de l'Odyssée, à la suite d'Ana Iriarte, nous pensons que le danger essentiel pour Ulysse ne vient pas de la séduction néfaste d'un savoir abstrait mais du reflet décalé de sa propre image. Ulysse a la dangereuse possibilité, à travers les voix et les paroles des Sirènes, de se contempler. Limage qui se reflète dans le chant n'est cependant pas celle d'Ulysse héros de l'Odyssée, le polutropos, l'homme aux mille ruses. Comme l'a montré Pietro Pucci, il s'agit d'une image du héros tel qu'il est vu et célébré dans l'Iliade. Ce sont évidemment ce décalage, crue faille qui sont dangereux. La façon dont les Sirènes chantent la gloire du héros le ramène en arrière, en Troade. En ce sens, elles nient le temps passé, les efforts accomplis. Elles tendent à faire oublier l'Ulysse de l'Odyssée, pris d'un désir essentiel, celui de retrouver Ithaque. Nous retrouvons donc un motif qui court tout au long de l'Odyssée, à savoir le pété de l'oubli. En ce sens, c'est autant ce qu'Ulysse apprend que ce qu'il oublie qui fait la dangerosité du chant des Sirènes. On est donc bien en présence d'un cas de duplicité. Quant au savoir en lui-même, il est totalement stérile, aporétique, il n'apporte rien de nouveau. Dans le cas d'Ulysse, il est une pure forme figée de célébration d'une gloire passée. Il est l'expression d'un temps immobile. De ce point de vue, il est en totale osmose avec l'univers qui entoure les Sirènes. Le savoir omniscient qu'elles prétendent posséder est une vaste tromperie. Elles sont bien inférieures aux Muses célestes réellement omniscientes, elles, car tournées autant vers le passé que vers le présent et l'avenir. Ulysse polutropos, héros de la nlètis, n'est pas connu des Sirènes; c'est pourtant ce qui fait son actualité par rapport à l'Iliade (François Dingremont, Les sirènes d'Homère, retour sur un effet-miroir, Les sirènes ou le savoir périlleux: D'Homère au XXIe siècle, 2018 - books.google.fr). Plutarque, en s'appuyant sur la littérature latine antérieure, réécrit le siège de Syracuse pour montrer non seulement que l'intelligence grecque, capable d'aller du principe des choses vers des applications concrètes, de l'idée vers sa vérification dans le réel, est inaccessible aux Romains dont l'esprit fonctionne en sens inverse, du concret vers le principe, mais surtout que le savant ne peut être réduit à un être humain qui réfléchir plus que les autres: la science grecque n'est pas une simple lecture rationnelle des phénomènes. Ce savant d'un monde grec qui s'achève ressemble en effet beaucoup aux premiers physiciens, figures à demi-légendaires et "hommes divins" (tels Pythagore, Héraclite, dont la langue était énigmatique, ou Empédocle dont l'Etna, dit-on, avait recraché la sandale) qui témoignent que l'histoire de la raison s'est élaborée à l'intérieur même d'une pensée mythique. De plus, en transformant un individu bien réel en personnage mythologique, Plutarque autorise ceux qui viendront après lui à entretenir sa légende. La vie et l'oeuvre d'Archimède échappent dors à l'histoire et le siège de Syracuse devient le théâtre du mythe, à tel point que même les repères de l'histoire des sciences en ont été longtemps brouillés. [...] Nombreux sont ceux qui, de nos jours encore, croient que cet épisode est réel, et la littérature ne manque pas sur la forme et l'inclinaison que devaient avoir ces miroirs ainsi que sur l'immense difficulté pour atteindre à distance une cible mobile et humide en dirigeant vers elle les rayons du soleil. Avec le mythe d'Archimède est née la mythologie des sciences (Mireille Courrent, Eurêka, eurêka, Archimède ou la naissance de la mythologie de la science, Mythes et savoirs dans les textes grecs et latins, 2008 - books.google.fr). Le déclin de la science dans le monde antique, qui s'amorce en même temps que s'affirme l'hégémonie de Rome, a eu vraisemblablement bien d'autres causes encore que l'esprit «utilitariste» des Romains. Il est vrai que les techniques ont connu à Rome un grand essor. Mais d'une part la technique n'exclut pas la réflexion théorique, ainsi que le montrent les traités qui les exposent, et d'autre part nombreux sont les témoignages d'un intérêt réel des Romains pour la science. Le discours scientifique romain, qui est loin d'être une réduction simplificatrice de la science grecque, même s'il est essentiellement vulgarisateur, a comme caractéristique d'être inséparable d'une préoccupation morale qui lui fait placer sa finalité en dehors de lui-même, dans le bien que la connaissance scientifique peut apporter à l'homme en le rassurant sur le monde. Plus qu'un parti philosophique, nous voyons dans cette exigence inquiète un trait de l'âme italique, héritage peut-être de l'ancienne Etrurie. (Ph. Mudry, Science et conscience, réflexions sur le discours scientifique à Rome, Sciences et techniques à Rome, Etudes de lettres, 1986 - books.google.fr). Cicéron (Tusculanes, 1, 2) félicite les Romains de ne ressembler point aux Grecs et de limiter l'étude des mathématiques au domaine des applications utiles. Il fallut que lentement pénétrât le Moyen âge pour rayonner à la Renaissance la conception grecque des exigences de la raison (Bibliographie : "Histoire des sciences exactes et naturelles dans l'antiquité" de M. Reymond, 1924, Revue de philosophie, Volume 32, 1925 - books.google.fr). De là , la science grecque serait captive puisque limitée. Archimède se serait ainsi "fait manger" par cette science. Passion dévorante (L'art de vivre content, 1707 - books.google.fr). Il fallait pour cela développer l'optique qui rapprochait les corps célestes et la géométrie qui calculait et figurait leur mouvement. La mécanique devint ainsi une science pilote appuyée sur d'autres sciences auxquelles elle emprunta leur méthode. Et elle le fit sans mal puisqu'Euclide avait montré le rapport entre optique et géométrie. La science grecque, science de la mesure, concourait ainsi à faire crouler l'édifice où on l'avait tenue enfermée en se servant de l'autorité d'Aristote à des fins contraires à son enseignement. Une fois la physique de l'impetus sur sa lancée, elle se développa d'autant plus vite qu'elle répondait aux interrogations qui naissaient du développement des techniques. Elle permettait de calculer la courbe des boulets, la chute des corps, le mouvement des astres, le poids d'une colonne d'eau et la hauteur que pouvait atteindre le jet vertical que l'on pouvait faire partir de sa base. Léonard de Vinci multipliait les calculs de ce genre et déployait sa virtuosité de géomètre-ingénieur dans la construction de perspectives hardies et dans l'invention de machines capables de ramer, de voler et de se propulser sur le sol. Tout confirmait la vérité dè ses calculs : si l'on projetait obliquement de l'eau en l'air, elle retombait en décrivant une parabole ; si on la contrariait dans son écoulement le long d'une pente, elle formait un remous en dessinant une spirale. Tout était en mouvement dans l'univers et tout mouvement s'observait et se décrivait par le moyen de la géométrie (Recherches anglaises et nord-américaines : RANAM., Numéros 28 à 29, 1995 - books.google.fr). Cet écolier ne veut point manger de l'étude, il lui faut faire manger de la guerre, il en sera bientôt saoul (Antoine Furetière, Dictionnaire universel, Tome 2, 1708 - books.google.fr). Typlogie Le report de 1714 sur la date pivot -212 (siège de
Syracuse) on obtient -2138. Dans Arlequin Deucalion, monologue en trois actes (25
février 1722) d'Alexis Piron, Arlequin dit qu'il est petit-fils de Prométhée
qui n'eut jamais de femme et que tout le
monde sait qu'il fabriqua son pere Deucalion de ses
propres mains, & qu'il l'anima avec un verre ardent (Ĺ’uvres
completes d'Alexis Piron, Tome 3, 1777 - books.google.fr). Alexis Piron, né à Dijon, comme Rameau, le 9 juillet 1689
et mort à Paris le 21 janvier 1773, est un poète, chansonnier, goguettier et dramaturge français. Sainte-Beuve nous dit
que Piron était "la gaîté même…, gai causeur, homme de verve et de
mimique" (fr.wikipedia.org
-Â Alexis Piron). La Sicile, oĂą la
mythologie plaçait les Titans, les Lestrygons
anthropophages, et les Cyclopes, forgerons de Vulcain dans les antres de l'Etna,
fut peuplée primitivement par des tribus ibériennes et pélasgiques de Sicanes
et de Sicules; elle reçut aussi quelques colons phéniciens; mais les colonies
helléniques qui s'y établirent, à partir du VIIIe siècle avant l'ère
chrétienne, finirent par dominer l'île entière (Joseph
Chantrel, Cours abrégé d'histoire universelle, Tome 1, 1866 - books.google.fr). Si l'on tient compte du fait qu'Homère, au chant VI de
l'Odyssée, use du mot : Cyclopes à peu près comme il ferait de l'adjectif :
corinthien, on peut envisager d'identifier
la terre des Cyclopes anthropophages avec les abords de Syracuse, colonie
fondée par Corinthe en même temps que Corcyre, mais restée fidèle à Corinthe
tandis que Corcyre adoptait l'attitude inverse (Roger
Dion, Aspects politiques de la géographie antique, 1977 - books.google.fr). Thucydide dans
son Histoire nous apprend plusieurs choses de la Sicile. Il remarque prémiérement
qu'on disoit, que cette Ile avoit
été habitée par les Cyclopes & par les Lestrygons
au tems de la de la prémiére antiquité. [...] Les
Historiens avoient exactement considérez, ils n'ont rien apperçû
en Gréce, en Sicile ni en Italie, qui allât au delà de deux mille ans avant la naissance de Jesus-Christ (Isaac
Jaquelot, Dissertations sur l'existence de Dieu ou l'on démontre cette vérité
par l'histoire universelle de la première antiquité du monde, 1697 -
books.google.fr). Verre ardent M, Hombert a dit que les matieres telles que l'or, l'argent, &c. qui Ă©tant en
fusion au foyer du verre ardent, ne paroissent Ă
l'Ĺ“il nud que fous la couleur de la lumiere, & avec un prodigieux Ă©clat, sont vues avec
leurs couleurs naturelles, si on les reagrade Ă
travers un vers enfumé (Collection
académique composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies
et sociétés littéraires étrangères, 1769 - books.google.fr). Guillaume Homberg publie ses Observations faites par le
moyen du verre ardent (sur l'exposition de l'or et de l'argent au miroir
ardent) en 1702 (Guillaume Homberg,
Éclaircissements touchant la vitrification de l’or au verre ardent, 1707 -
hal.archives-ouvertes.fr). L'essentiel des
informations délivrées par Saint-Simon concerne une activité précise : les
recherches entreprises par Philippe d'Orléans dans le domaine de la chimie, en
compagnie de Guillaume Homberg. Au début des années 1700, le duc d'Orléans
se passionne en effet pour la chimie et fait construire un laboratoire au
Palais Royal en mĂŞme temps qu'il recrute et pensionne un chimiste protestant d'origine
allemande, Guillaume Homberg. Né dans l'île de Java en 1652, Homberg devient
docteur en médecine après s'être formé à plusieurs sciences : astronomie,
botanique, physique, et finit par choisir de consacrer l'essentiel de ses
recherches à la chimie. Recruté à l'Académie des sciences par Colbert, il se
convertit en 1682 au catholicisme. En 1704, le duc d'Orléans le choisit comme
son premier médecin. Des recherches que le duc d'Orléans et Homberg ont donc
menées ensemble, Saint-Simon propose une interprétation très particulière. Non
seulement il les tient pour une activité parfaitement frivole, mais elles ont
également le grave inconvénient, bien que tout à fait innocentes, de manifester
une dangereuse proximité avec des pratiques beaucoup moins licites. [...] Saint-Simon se garde également, en dépit de leur
apparente proximité, de confondre ces travaux de chimie et «les recherches sur
l'avenir », qui relèvent d'un art divinatoire, voire de la magie' noire. Il est
donc pleinement convaincu de l'innocence d'une passion qui s'est cependant
révélée fatale par les rumeurs d'empoisonnement qu'elle a servi à autoriser. Ce goût absurde certes, mais innocent dans
son principe, a été en effet retourné contre le duc d'Orléans, et au prétexte
en partie de ses prétendues pratiques antérieures de magie noire, par ceux
d'abord qui, en 1709, voulaient empoisonner sa femme et lui faire porter la
responsabilité du crime ; puis par ceux qui, en 1712, l'ont accusé d'avoir
empoisonné les héritiers directs de Louis XIV afin de se rapprocher du trône,
entreprise pour laquelle il aurait d'ailleurs bénéficié de la complicité de
Homberg : «c'était avec lui que ce prince avait dressé sa fatale chimie, où il
s'était amusé si longtemps et si innocemment, et dont on essaya de faire contre
lui un si infernal usage» (Simone
Mazauric, Philippe d'Orléans et les sciences. In: Cahiers Saint Simon, n°34,
2006 - www.persee.fr). Nous apprenons de
M. Homberg lui-même, qu'ayant calciné avec le Verre ardent du Palais Royal,
quatre onces d'antimoine placées à dix-huit pouces du vrai foyer de ce verre,
elles se sont trouvées au bout d'une heure augmentées de trois gros; mais
qu'ayant été ensuite placées au vrai foyer, elles s'y font vitrifiées en
très-peu de temps , & ne pefoient plus que trois
onces & demie (Journal
des sçavans, avec des extraits des meilleurs journaux de France &
d'Angleterre, 1765 - books.google.fr). Construit par Richelieu en 1628, le Palais-Cardinal,
donné au roi Louis XIII en 1636, sert de résidence à Louis XIV enfant pendant
les troubles de la Fronde et devient le Palais-Royal. DonnĂ© en apanage Ă
Philippe d'Orléans en 1692, il devient le palais des Orléans. Le Régent y
réside (fr.wikipedia.org -
Palais-Royal). Du Palatinat, M. Hartsoeker fit des voyages dans quelques autres pays de
l'Allemagne, ou pour voir les Savans, ou pour Ă©tudier l'Histoire naturelle, sur-tout les mines. A
Cassel, il trouva un verre ardent de M. le Landgrave, fait par M. de Tschirnhaus, de la même grandeur que celui qu'avoit feu M. le Duc d'Orléans, & tout pareil. Il
répéta les expériences de M. Homberg, & n'eut pas le même succès à l'égard
de la vitrification de l'or, dont nous avons parlé en 1702, pag.
34, & en 1717, pag. 30. Il est le Philosophe Hollandois, aux objections duquel M. Homberg répondoit en 1707. Il ne s'en est point désisté, & a
toujours soutenu que ce qui se vitrifioit n'étoit point l'or, mais une matière sortie du charbon qui soutenoit l'or dans le foyer, & mêlée peut-être avec
quelques parties hétérogènes de l'or. Il nioit même
la vitrification d'aucun métal au verre ardent; jamais il n'avoit
seulement pu parvenir à celle du plomb, quelque temps qu'il y ait employé. Il
est triste qu'un grand nombre d'expériences délicates soient encore
incertaines. Seroit ce donc trop prétendre, que de
vouloir du moins avoir des faits bien constans (Ĺ’uvres
de Monsieur de Fontenelle, des Académies, françoise, des sciences, des
belles-lettres, de Londres, de Nancy, de Berlin, & de Rome, Tome 6, 1766 -
books.google.fr). Nous avons des preuves de cette grande division dans la
calcination des métaux, dont l'agrégation des parties une fois rompue, fait
qu'ils paroissent Ă l'Ĺ“il fous une autre couleur que
celle qui leur est propre. Je prends, pour exemple, l'or fondu au foyer du
verre ardent. Le cercle de pourpre qu'on apperçoit
autour de fa fusion, n'offre, au microscope, que des petits grains d'or extrĂŞmement
divisés. La vapeur de l'argent en fusion, ainsi que l'ont observé les
Commissaires nommés par l'Académie pour les expériences au verre de Tchirnhausen, & à la loupe de M. Trudaine, reçue sur une
lame d'or, ne présente, par sa grande division , qu'une poussière blanche ;
mais en rapprochant, avec un brunissoir, les parties divisées, on apperçoit aussi-tôt l'éclat &
le brillant de l'argent (Journal
de physique, de chemie, d'histoire naturelle et des arts, Tome 6, 1775 -
books.google.fr). Miroir ardent en Acadie Le miroir concave, ou miroir ardent, n'atteignit jamais la
popularité du briquet auprès des habitants de la Nouvelle-France. Son usage
Ă©tait en effet beaucoup plus limitĂ© puisqu'on ne pouvait pas s'en servir Ă
l'intérieur des habitations, durant la nuit, ou par temps trop couvert. Aussi
lui préférait-on l'attirail plus compliqué du briquet avec sa pierre, son
amadou et sa boite à amadou. Remontant à une très haute antiquité, le miroir
ardent était utilisé par les Grecs et les Romains à des fins religieuses. Les
premiers annalistes européens en ont même noté l'usage au Pérou et au Mexique. Cependant,
rien ne permet de croire qu'il était connu des Amérindiens d'Amérique du Nord
avant l'arrivée des Européens, car son emploi par les premiers missionnaires
fit sur eux grande impression, comme en témoigne le père Le Jeune en 1637.
"Il faut faire provision d'un fusil ou d'un miroir ardent, ou tous les
deux, afin de leur faire du feu durant le jour pour pétuner, et le soir, quand
il faudra cabaner, ces petits services leur gagnent le coeur".
Devenu très populaire, le miroir ardent
était, on l'a vu, un article de traite fort apprécié Il n'y a rien, rapporte Kalm, que les sauvages apprécient autant que cet instrument
qui leur-sert Ă allumer la pipe sans aucun trouble, ce qui n'est pas un
petit mérite aux yeux de l'indolent Indiens (Marcel
Moussette, Le chauffage domestique au Canada: des origines Ă
l'industrialisation, 1983 - books.google.fr). Cannibales Ce qu'il y avait
de plus horrible chez les Canadiens, est qu'ils fesaient
mourir dans les supplices leurs ennemis captifs, et qu'ils les mangeaient.
Cette horreur leur Ă©tait commune avec les Brasiliens,
éloignés d'eux de cinquante degrés. Les uns et les autres mangeaient un ennemi
comme le gibier de leur chasse. C'est un usage qui n'est pas de tous les jours
; mais il a été commun à plus d'un peuple, et nous en avons traité à part.
C'était dans ces terres stériles et glacées du Canada que les hommes étaient
souvent anthropophages : ils ne l'Ă©taient point dans l'Acadie, pays meilleur oĂą
l'on ne manque pas de nourriture; ils ne l'Ă©taient point dans le reste du
continent, excepté dans quelques parties du Brésil, et chez les cannibales des
îles Caraïbes. Quelques jésuites et quelques huguenots, rassemblés par une
fatalité singulière, cultivèrent la colonie naissante du Canada ; elle s'allia
ensuite avec les Hurons qui fesaient la guerre aux
Iroquois. Ceux-ci nuisirent beaucoup à la colonie, prirent quelques jésuites
prisonniers, et, dit-on, les mangèrent. Les Anglais ne furent pas moins
funestes à l'établissement de Québec. A peine cette ville commençait à être
bâtie et fortifiée (1629) qu'ils l'attaquèrent. Ils prirent toute l'Acadie;
cela ne veut dire autre chose sinon qu'ils détruisirent des cabanes de
pêcheurs. Les Français n'avaient donc dans ces temps-là aucun établissement
hors de France, et pas plus en Amérique qu'en Asie. La compagnie de marchands
qui s'était ruinée dans ces entreprises, espérant réparer ses pertes, pressa le
cardinal de Richelieu de la comprendre dans le traité de Saint-Germain fait
avec les Anglais. Ces peuples rendirent le peu qu'ils avaient envahi, dont ils
ne fesaient alors aucun cas; et ce peu devint ensuite
la Nouvelle-France. Cette Nouvelle-France resta longtemps dans un Ă©tat
misérable; la pêche de la morue rapporta quelques légers profits qui soutinrent
la compagnie. Les Anglais, informés de
ces petits profits, prirent encore l'Acadie. Ils la rendirent encore au traité
de Breda (1654). Enfin, ils la prirent cinq fois, et s'en sont conservé la
propriété par la paix d'Utrecht (1713), paix alors heureuse, qui est devenue
depuis funeste Ă l'Europe : car nous verrons que les ministres qui firent
ce traité n'ayant pas déterminé les limites de l'Acadie, l'Angleterre voulant les
étendre, et la France les resserrer, ce coin de terre a été le sujet d'une
guerre violente en 1755 entre ces deux nations rivales; et cette guerre a
produit celle de l'Allemagne, qui n'y avait aucun rapport. La complication des
intérêts politiques est venue au point qu'un coup de canon tiré en Amérique
peut ĂŞtre le signal de l'embrasement de l'Europe (Voltaire,
Essai sur les mœurs et l'esprit des nations: et sur les principaux faits de
l'histoire depuis Charlemagne jusqu'Ă Louis XIII, 1829 - books.google.fr). Un soldat breton
va en Canada : il se trouve que par un hasard assez commun il manque de
nourriture : il est forcé de manger d'un Iroquois qu'il a tué la veille. Cet
Iroquois s'était nourri de jésuites pendant deux ou trois mois ; une grande
partie de son corps était devenue jésuite. Voilà le corps de ce soldat
composé d'Iroquois, de jésuite, et de tout ce qu'il a mangé auparavant. Comment
chacun reprendra-t-il précisément ce qui lui appartient ? et
que lui appartient-il en propre ? (Article RĂ©surrection) (Ĺ’uvres
complètes de Voltaire, Dictionnaire philosophique, avec des notes et une notice
sur la vie de Voltaire, Volumes 18 à 19, 1876 - books.google.fr). Le jésuite
Charlevoix, que j'ai fort connu, et qui était un homme très-véridique, fait
assez entendre dans son Histoire du Canada, pays où il a vécu trente années,
que tous les peuples de l'Amérique septentrionale étaient anthropophages, puisqu'il
remarque comme une chose fort extraordinaire que les Acadiens ne mangeaient
point d'hommes en 1711. Le jésuite Brébœuf
raconte qu'en 1640 le premier Iroquois qui fut converti, Ă©tant malheureusement
ivre d'eau-de-vie, fut pris par les Hurons, ennemis alors des Iroquois. Le
prisonnier, baptisé par le P. Brébœuf sous le nom de
Joseph, fut condamné à la mort. On lui fit souffrir mille tourments, qu'il soutint
toujours en chantant, selon la coutume du pays. On finit par lui couper un
pied, une main et la tête, après quoi les Hurons mirent tous ses membres dans
la chaudière, chacun en mangea, et on en offrit un morceau au P. Brébœuf. Charlevoix parle, dans un autre endroit, de
vingt-deux Hurons mangés par les Iroquois. On ne peut donc douter que la nature
humaine ne soit parvenue dans plus d'un pays à ce dernier degré d'horreur; et
il faut bien que cette exécrable coutume soit de la plus haute antiquité, puisque
nous voyons dans la sainte Écriture que les Juifs sont menacés de manger leurs
enfants s'ils n'obéissent pas à leurs lois (Deutéronome XXVIII,53) (Article
Anthropophage) (Oeuvres
complètes de Voltaire, Dictionnaire philosophique, éd. de Ch. Lahure: vol, 1859
- books.google.fr). Joseph-François Lafitau,
missionnaire jĂ©suite, tira de son sĂ©jour de cinq ans (1712-1717) Ă
Sault-Saint-Louis, au Canada, la matière de son grand ouvrage Mœurs des
Sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps (1724). [...]
N'ayant personnellement parcouru que le Canada, il a par ailleurs puisé chez
les chroniqueurs espagnols ou les voyageurs français du XVIe siècle, notamment Léry, les informations qui lui manquaient sur les peuples
de Floride, d'Amérique centrale, du Brésil et des Caraïbes, non sans risquer
quelques extrapolations hasardeuses imputables à sa volonté de montrer l'unité
culturelle des populations amérindiennes. C'est
le cas semble-t-il des remarques sur la «pyrolâtrie»
[cf. miroir ardent], ou culte du feu sacré, ou encore sur la pratique des
tortures infligées aux prisonniers de guerre, abusivement étendues à l'ensemble
du continent. Si Lafitau est l'inventeur de
l'anthropologie moderne, c'est involontairement et si l'on peut dire par
surcroît. Le but des Mœurs des Sauvages américains comparées aux mœurs des
premiers temps est purement apologétique, comme le suggère le commentaire du
frontispice allégorique de l'ouvrage : une femme, la Théologie ou l'Histoire,
est assise à une table la plume à la main, entourée d'objets symbolisant pour les
uns l'Amérique sauvage moderne, pour les autres le monde antique, objets que
lui présentent deux génies «en lui faisant sentir le rapport qu'ils peuvent
avoir ensemble». Quant au vieillard Temps, dont la main désigne une nuée au
centre de laquelle on distingue Adam et Eve au pied de l'arbre de la
connaissance, il a pour charge de : lui [faire] comme toucher du doigt la
connexion qu'ont tous ces monumens avec la première
origine des hommes, avec le fond de nĂ´tre Religion,
et avec tout le Systéme de Révélation faite à nos
premiers Péres après leur péché, ce qu'il lui montre
dans une espèce de vision mysterieuse. Il n'est que trop évident que, pour employer le
vocabulaire des logiciens, Lafitau emploie une
argumentation non falsifiable oĂą les similitudes tiennent lieu de lien causal
et où l'analogie se substitue à la preuve, selon une démarche que Voltaire
tournera en dérision dans l'Essai sur les
MĹ“urs (Jean-Michel
Racault, La preuve par l'autre, Transhumances divines: récit de voyage et
religion, 2005 - books.google.fr). Fondation de villes en Amérique française au
XVIIIe siècle Louisbourg : Québec et Montréal
sont, en somme, des villes spontanées ayant obéi surtout aux suggestions de la
nature. Trois-Rivières et surtout Détroit dénotent un plan préconçu. La composition
urbaine la plus étudiée était Louisbourg. Malheureusement,
la chance ne lui a pas souri et ce n'est plus qu'un souvenir autour de quelques
documents d'archives. Nous sommes au XVIIIe siècle et le traité d'Utrecht
enlève en 1713 à la France la baie d'Hudson, Terre-Neuve, l'Acadie, lui
laissant toutefois la grande île du Cap-Breton à l'extrémité Nord-Est de la
Nouvelle-Ecosse, de l'autre côté d'un étroit bras de mer. Elle était
complètement inhabitée. Dès janvier 1714, Louis XIV résolut d'y crée un
Ă©tablissement pour remplacer les territoires perdus et jouer le double rĂ´le
d'entrepôt commercial et de place forte à l'entrée du Saint-Laurent. L'île
reçut le nom d'Île Royale. Après quelques hésitations, on décida de bâtir sa
capitale au Sud-Ouest, au bord d'une anse dite "le Havre Ă
l'Anglais", et de la baptiser Louisbourg. Le
site était vaste, avec un bon abri pour les bateaux, mais entouré de terres
basses, caillouteuses, stériles, dépourvue de bois, donc difficile à fortifier.
Le proximité des bancs de morue l'avait fait préférer
à la baie Sainte-Anne sur la côte Est, excellente rade, elle aussi, entourée de
terres fertiles et de forêts. Les travaux commencèrent en 1714. Des murs
abritaient, dès 1715, 700 habitants, venus de France ou chassés de Terre-Neuve
et d'Acadie. La colonie se développa grâce aux pêcheries et au commerce des
fourrures : 1.400 habitants en 1737, 118 navires ayant fait escale dans le port
en 1728. En 1744, Louisbourg tomba aux mains des
Anglais, qui, cinq ans plus tard, durent le restituer Ă la France (1749). Sa
prospérité reprit : 3.000 habitants en 1750. La ville faisait une concurrence
active à Halifax, fondé par les Anglais en 1749 en Nouvelle-Ecosse. L'ingénieur
Franquet traça de nouvelles fortifications, plus
puissantes et mieux conçues. Il ne put les achever et, quand la guerre reprit,
les Anglais s'emparèrent à nouveau de Louisbourg en
1758, après un siège de deux mois. L'importante place forte leur servit alors
de port et d'entrepĂ´t jusqu'Ă ce qu'en 1760, par ordre de Pitt, elle soit
systématiquement détruite, trois ans avant que le traité de Paris ne cède
définitivement à l'Angleterre l'Ile Royale et le Canada. [...] La colonisation française s'était aussi portée sur un
autre point de l'Amérique du Nord, la Louisiane, où elle a laissé plusieurs
grandes villes. Elle y fut plus tardive. Au printemps de 1682, premier parmi
les Européens, le Rouennais Cavelier de la Salle
parvint au golfe du Mexique en partent du Canada. Ayant pris possession au nom
de Louis XIV de tous les pays arrosés par le Mississippi, il les appela
Louisiane. Mais quelques années plus tard, il fut assassiné et toute influence
française cesse. En 1698, Le Moyne d'Iberville obtint
une mission dans le golfe du Mexique. Il découvrit et explora les bouches du Mississippi
et entreprit la colonisation. Dès son premier voyage, il fonda un petit poste Ă
Biloxi. En 1702, il remonta la rivière
de la Mobile et fonde la ville qui porte ce nom. La population de Biloxi
fut transférée à Mobile. C'est la première grande fondation française en
Louisiane. Elle a prospéré : c'est aujourd'hui la plus grande ville de
l'Alabama. Un plan manuscrit de 1711, aux Archive des Colonies, montre que sa
construction ne fut pas laissée au hasard. Des rues droites, parallèles et
perpendiculaires au fleuve, découpent une série d'ilôts
rectangulaires, subdivisés en 4 et 6 parcelles, quelquefois davantage. Les noms
da propriétaims sont donnés. Fait essentiel, la
valeur de plusieurs îlots a été réservée le long de rivière pour la place
publique. C'est un trait constant de l'urbanisation française en Louisiane, que
nous retrouverons à La Nouvelle Orléans et à Saint-Louis. La Nouvelle-Orléans. Jusque-là , on s'était tenu à l'écart
du Mississippi lui-mêne. En 1702, un négeciant et annuels, M. de Rémonville,
proposa la création d'un établissement au "portage du Mississipi, à 18
lieues environ de son embouchure, près du site actuel de La Nouvelle-Orléans. Mais
il se ruina avant d'être écouté. L'essor de la Louisiane est dû à Law et à sa
Compagnie d'Occident qui reçut en 1717 la monopole du
commerce dans cette région. On sait le propagande
faite Ă Paris, dans ses bureaux de la rue Quincampoix.
Un de ses premiers actes fut la création d'une grande ville sur les bords du
Mississippi. Le directeur de la compagnie, Jean-Baptiste Le Moyne
de Bienville, reprit l'idée de Rémonville
et les premiers travaux sur le terrain commencèrent au printemps de 1718, La ville fut appelée Nouvelle-Orléans, du
nom du Régent Philippe d'Orléans, protecteur de Law (Pierre
Lavedan, Jeanne Hugueney, Philippe Henrat, L'urbanisme Ă l'Ă©poque moderne:
XVIe-XVIIIe siècles, 1982 - books.google.fr). "estendu" Le 17 juin 1703, Le Ministre de la Marine adressa de
Versailles la dépèche suivante à Mgr de Québec, qui
se trouvait encore en France : "Monsieur,
les PP. Jésuites et les supérieurs
des missions estrangères vous ont parlé séparément de la mission du Mississipi.
Les Pères voulant esviter d'avoir aucune contestation
avec les missionnaires, ont demandé qu'il plust à Sa
Majesté de leur assigner un endroit où ils puissent travailler seuls et sans
concurrence avec eux. Ils disent avec quelque sorte de raison, que leurs
démêlez scandalisent les fidèles et retardent peut-estre
la conversion des sauvages, et qu'il serait du service de Dieu et du roi d'esloigner d'eux tout ce qui peut les détourner d'embrasser
la religion chrestienne; et comme ils sont les premiers qui ont esté au
Mississipi et à l'establissement qui a esté commencé à la Mobile, ils demandent qu'on leur assigne
ce quartier avec telle estendu de pays qu'il plaira Ă
Sa Majesté. Ils prétendent qu il suffirait pour
cela que vous eussiez agréable de prendre pour vostre
grand vicaire de cette colonie le supérieur qu'ils y establiroient.
MM. des Missions estrangères représentent, de leur costé,
qu'ils ont desjĂ plusieurs missionnaires venus en ce
pays, et qu'il seroit nécessaire qu'ils eussent un establissement dans le lieu où sera le principal siège de
la nation, qui est l'endroit où est le fort (de la Mobile) et où on a commencé
la ville et oĂą les JĂ©suites sont actuellement establis,
qu'ils ne peuvent y estre sans y avoir une
juridiction spirituelle, ny estre
sous la dépendance des Jésuites. Le roi n'a rien voulu décider sur cette
contestation sans avoir vostre advis.
Sa Majesté désire que vous examiniez avec soin les raisons des uns et des
autres, et, après y avoir fait de sérieuses réflexions, de proposer ce que vous
estimez devoir estre fait pour la plus grande gloire
de Dieu..." (Camille
de Rochemonteix, Les Jésuites et la Nouvelle-France au XVIIe siècle
, Tome 3, 1896 - books.google.fr). Naufrages en Amérique 22 août 1711 : naufrage de huit des trente-et-un
transports de l’escadre du contre-amiral Hovenden
Walker sur les récifs de l’île aux Œufs dans le Saint-Laurent. Il y a 884
morts. Cette force escortée par treize vaisseaux et frégates, deux galiotes,
devait attaquer Québec. L’expédition est abandonnée. Le Québec restera français
jusqu'en 1763. 28 août 1725 : naufrage du Chameau à proximité de Louisbourg. Ce navire amenait à Québec des personnages
importants comme Henri de Chazel, le nouvel intendant
à Québec, Charles-Hector de Ramezay, fils du
gouverneur de Montréal, Louis de La Porte de Louvigné,
gouverneur de Trois-Rivières, des pères jésuites et récollets. Il n’y a aucun
survivant. L’épave, retrouvée en 1965, a livré un important trésor monétaire
qui a été vendu aux enchères en 1971 (fr.wikipedia.org -
Liste de naufrages). Naufrage de Louis XIV Ce monarque aurait dû pour sa renommée mourir avec le
siècle dans lequel il Ă©tait nĂ©; car le suivant devait ĂŞtre fatal Ă lui et Ă
tous les siens. En effet dès le début, ce
siècle est marqué par le naufrage de la gloire de ce prince, qui fut longtemps
le premier de la terre; et la fin en est à jamais mémorable par la chute d'un
trône qu'il avait entouré d'un pouvoir absolu, et par la mort violente ou la
dispersion de toute sa famille. Les revers de la guerre de la succession
d'Espagne et le traité d'Utrecht précipitèrent la chute de la puissance
française en Amérique, quoique cette chute ait été produite par d'autres
causes, comme on l'a dit plus d'une fois ailleurs. Par ce traité fameux signé
le 11 avril 1713, Louis XIV renonça aux droits qu'il pouvait avoir sur le pays
des Iroquois et céda à l'Angleterre la baie d'Hudson, l'île de Terreneuve, l'Acadie avec la ville de Port-Royal,
c'est-à -dire tous les pays situés sur le littoral de l'Atlantique, sur lequel
il ne resta plus Ă la France que l'embouchure du St.-Laurent
et celle du Mississipi dans la baie du Mexique; elle se réserva seulement le
droit de faire sécher le poisson sur une partie de l'île de Terreneuve.
On peut juger, après que nous eûmes perdu son fils, nous vîmes son petit-fils
le Dauphin, duc de Bourgogne, la Dauphine sa femme, leur fils aîné le duc de
Bretagne, portés à Saint-Denis au même tombeau, au mois d'avril 1712; tandis qne le dernier de leurs enfans,
monté depuis sur le trône, était dans son berceau, aux portes de la mort. Le
duc de Berri, frère du duc de Bourgogne, les suivit deux ans après; et sa fille
dans le même temps passa du berceau au cercueil (François-Xavier
Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours, Tome 2,
1852 - books.google.fr). Si elle est fondatrice du mythe qui fait de Louis XIV un héros bâtisseur, l'histoire du Masque de fer porte pourtant en germe la chute du Roi-Soleil, emblème de la royauté française. Source du combat entre lumière et ombre, ce déclin se déploie aussi à la surface des miroirs. En effet, tout le mythe du Masque de fer considère la spécularité comme fondamentalement problématique. Car c'est bien la ressemblance de Philippe avec son frère qui menace un règne déjà fragilisé par les tourments de la Fronde. Le seul moyen d'en consolider les fondations est donc d'écarter du trône tout rival potentiel : la réclusion du Masque, véritable supplice, révèle en creux lu faiblesse d'un régime monarchique déjà entamé. Le pouvoir ne saurait être partagé ou même questionné. Dans cette économie tyrannique, le miroir vient jouer un rôle extrêmement ambivalent. Il est d'abord, pour Louis XIV, le moyen de "redoubler à l'infini son rayonnement", ainsi qu'en témoigne la construction de la galerie des Glaces. Cette réalisation, aussi megalomaniaque que narcissique, semble pourtant prendre valeur apotropaique chez un souverain dont on apprend par ailleurs qu'il pouvait parfois s'effrayer de son reflet, rendu monstrueux par le miroir ardent concave que lui présente François Villette. Robertson (1831-1833, Mémoires récréatif, scientifiques et anecdotiques) rapporte cette anecdote révélatrice : "Louis XIV, s'étant placé, l'épée à la main, devant ce miroir, et à quelques pas de distance, pour en bien voir l'effet, fut surpris de se trouver vis-à -vis d'un bras qui dirigeait une épée contre lui ; on lui dit d'avancer brusquement : aussitôt son adversaire parut s'élancer sur lui ; le roi manifesta un mouvement d'effroi, et en fut si honteux qu'il fit entonner le miroir". Cette menace, qu'en mn sein le miroir colporte, se lit en filigrane tout le long du roman de Dumas, ranimant au coeur du XVIIe siècle la fable de Narcisse. Comme le pâtre grec, Philippe ne rencontre la fatalité qu'au moment où ses yeux se posent pour la première fois sur son reflet (Mathieu Da Vinha, Louis XIV, l’image et le mythe, 2019 - books.google.fr). L’acrostiche du quatrain PDDQ ou la
préséance PDDQ : Posuerunt dedicaruntque (Abréviations
tirées du «Dictionnaire des Abréviations latines et italiennes» de A.Capelli -
www.arretetonchar.fr) Abréviation que l'on trouve à Lérida en Espagne, dans une
inscription romaine (Enrique
Florez, Antiquités de Tarraconaise, 1769 -
books.google.fr). Le siège de Lérida (de son nom catalan : Lleida) est l'un des épisodes de la guerre de Succession
d'Espagne, survenu le 11 octobre 1707 (fr.wikipedia.org
- Siège de Lérida (1707)). Pendant la guerre
de la succession d’Espagne, le duc d’Orléans s’acquit une grande réputation par
la prise de Lérida, qui avait été jusqu’alors l’écueil des plus grands
capitaines, tels que Spinola et le grand Condé. Tous les poètes du temps
s’évertuèrent sur cette conquête. Rousseau adressa au prince le rondeau qui
commence ainsi : En moins d’un mois,
prendre ville rebelle, Faire sauter
remparts et citadelles, Tours, bastions,
rochers et catera, Pour maint guerrier
c’était un opéra ; Pour mon héros
c’est une bagatelle. On lui disait :
Sonnons le boute-selle, Retirons-nous (www.france-pittoresque.com). L'ombre du futur RĂ©gent plane sur ce quatrain : cf.
quatrain III, 15. Louis XIV n'est pas le premier monarque à légitimer ses
enfants naturels, il innove, en revanche, en leur octroyant un rang particulier
à la cour. Cette promotion est néanmoins très progressive ce qui montre la
prudence de Louis XIV sur la question délicate de ses enfants naturels. La
décision d'accorder aux princes légitimés un rang supérieur à celui des ducs et
pairs date de 1694. Toutefois, depuis 1673, le roi
accorde Ă ses enfants un rang et un statut stable Ă la cour comme le note le
duc de Saint-Simon : «Dès qu'ils commencèrent à pointer leur nez à la cour, le
Roi leur fit usurper peu à peu toutes les manières, l'extérieur et les
distinctions des princes du sang, qui fĂŻit bientĂ´t
établi chez eux et partout sans que le Roi s'en expliquât sur le fait ». Les
ducs, ainsi que l'ensemble de la cour, sont mis devant le fait Ă©tabli. Le
statut des enfants naturels de Louis XIV n'est toutefois pas identique ce qui
montre les premières hésitations du roi sur la question. Cinq enfants sont nés
de sa liaison avec la duchesse de la Vallière. Les
trois enfants, morts en bas-âge n'ont pas été légitimés et seuls les enfants
survivants, Marie-Anne et Louis, sont légitimés en 1667 et 1669. De plus, la
procédure s'insère discrètement dans les lettres d'érection en duché-pairie que
le roi effectue pour eux. Pour les enfants de Mme de Montespan, la procédure
est plus rapide et plus directe. En 1673, les trois premiers enfants sont
légitimés en même temps, suivis de Louise-Marie en 1676 et de Louis-Alexandre
et Françoise-Marie en 1681. Dans un édit de janvier 1681, le roi les rend aptes
à se succéder les uns aux autres. Il faut noter que dans tous les actes
officiels, la mère n'est jamais nommée à la différence de la procédure suivie
par Henri IV. Saint-Simon juge la procédure «inouïe » (14). Les enfants de
Louis XIV sont en effet le fruit d'un double adultère et portent donc
doublement cette marque d'impureté qu'il faut impérativement cacher. Nommer la
mère reviendrait à évoquer les fautes du roi. Omettre de le mentionner permet
d'effacer l'origine adultérine de ces enfants. De plus, le ton des lettres de
légitimation est très différent de celles employées par Henri IV qui rappelait
ses actes glorieux au service du royaume. Louis XIV ne s'embarrasse pas de ce
type de préambule et montre qu'il légitime ses enfants par sa seule volonté. En mars 1710, une nouvelle étape est franchie dans la
promotion des princes légitimés. Les deux fils du duc du Maine prennent le rang
de petit-fils de France ce qui efface la bâtardise originelle et les place sur
un pied d'égalité avec les princes nés d'une union légitime. En mai de la même
année, le duc du Maine et le comte de Toulouse obtiennent le rang de prince du
sang dans toutes les cérémonies de la cour, ce privilège est étendu dès le
lendemain Ă leurs enfants lĂ©gitimes. Cette mesure paraĂ®t inacceptable Ă
Saint-Simon car elle constitue une usurpation de rang: Voilà l'usurpation de tout l'extérieur des princes du
sang faite par le père ; puis par les enfants, de la tacite volonté du Roi, non
même jamais verbalement exprimée, passée en titre bien clair et bien libellé
par écrit. Ces différentes décisions n'apaisent cependant pas toutes
les tensions et les conflits car elles ne règlent pas la question de la
représentation au parlement et lors du sacre. En 1711, «Un édit général, portant règlement pour les Duchés et les
Pairies» est publié. L'édit ne s'attache pas au cérémonial de cour dont les
usages ont été progressivement établis sur l'expérience et les décisions précédentes
mais aux cérémonies d'Etat comme les sacres et les lits de justice. L'argument
central, exposé en préambule, est que les nouveaux pairs ne peuvent prétendre
représenter les anciens pairs du royaume, la dignité s'étant multipliée au fil
du temps. C'est une manière pour le roi d'exposer publiquement le fait que les
titres nobiliaires ont connu une inflation certaine ce qui leur enlève de la
valeur. L'autre argument est de régler les rangs entre les princes du sang, les
princes légitimés et les pairs. Les trois catégories sont clairement
distinguées. Les princes du sang, considérés comme «pairs-nés » entrent au parlement
dès l'âge de quinze ans et représentent les anciens pairs au sacre du roi, les
princes légitimés entreront au parlement dès l'âge de vingt ans et pourront
aussi représenter les anciens pairs du royaume au sacre, à défaut des princes
du sang. Les ducs et pairs ne peuvent entrer au parlement qu'à l'âge de
vingt-cinq ans et selon le rang d'ancienneté de leur pairie. Ainsi, la
transformation de l'étiquette opérée par Louis XIV au profit de ses fils
naturels, aboutit-elle à une modification du cérémonial royal dans ses grandes
manifestations. La cour a servi de laboratoire et le roi n'a plus besoin de
l'artifice de la pairie pour promouvoir ses enfants. De plus, l'édit précise qu'en cas de transmission d'une pairie par une
héritière, une nouvelle érection sera faite de la pairie par le roi. Cette
dernière mesure vise à éviter toutes les contestations et surtout les recours
directs au parlement en imposant la décision du roi. En 1714-1715, une ultime étape est franchie lorsque le
roi donne Ă ses deux fils une place dans l'ordre de succession Ă la couronne.
Cette décision doit être comprise dans un contexte de fin de règne, marqué par
les deuils successifs. Un Ă©dit de 1714 appelle Ă la succession le duc du Maine
et le comte de Toulouse à défaut des princes du sang. Devant les difficultés du
parlement Ă enregistrer cet Ă©dit, le roi tranche en accordant le rang de prince
du sang à ses fils, ce qui revient à faire disparaître le statut de prince
légitimé et à intégrer ses fils à la famille royale. C'est que la question des légitimés renvoie pour
Saint-Simon aux fondements mĂŞme de l'Etat monarchique. Elle rejoint en effet
les questions essentielles de la participation Ă la vie politique et du
contrôle de la monarchie. La période de la Régence voit s'affronter plusieurs
conceptions. En dépit de la mise en place de la polysynodie au début de la
Régence, le duc de Saint-Simon estime que les pairs ont été lésés et rédige un
Mémoire sur les prérogatives que les ducs ont perdues depuis la Régence qui
résume un certain nombre de griefs contre Philippe d'Orléans. Au centre des
accusations, se trouvent encore la place du duc du Maine et la préséance de la
maison de Lorraine. L'affaire du bonnet, le laxisme en matière de cérémonial et
le sacre de Louis XV sont les points de focalisation du conflit pour le duc. L'étiquette quotidienne, les préséances au
parlement de Paris et le cérémonial d'Etat sont donc les trois formes de
représentation sur lesquelles les ducs et pairs auraient été lésés. Sur ces
trois sujets, les princes légitimés et les princes étrangers sont encore le
point de focalisation des critiques (Frédérique
Leferme-Falguières, Les rangs et préséances des princes étrangers et des
princes légitimés. In: Cahiers Saint Simon, n°39, 2011. Cérémonial, étiquette
et politesse chez le duc de Saint-Simon - www.persee.fr). Pour l'édit de 1711 voir le quatrain III, 10. Dès la séance remarquable du 2 septembre 1715, au lendemain de la mort du Grand Roi, la question du «bonnet» fut posée : alors même que chacun prenait conscience de l’enjeu politique capital que recouvrait la démarche précipitée de Philippe d’Orléans au Parlement de Paris pour l’ouverture du testament du feu roi, l’archevêque de Reims, comme premier pair de France, se mit en devoir, en préalable à toute action ou délibération, d’interpeller le prince sur la question du «bonnet» : il protestait au nom des pairs contre l’habitude « insidieuse » prise par le Premier président de ne pas se «découvrir» (la tête), en séance solennelle comme en lit de justice, lorsqu’il requérait l’avis des ducs et pairs comme il le faisait naturellement en relevant l’opinion des princes du sang. La belle et grande affaire ! En consignant, dans un dossier qu’il sait de première importance, les moindres paroles, faits et gestes des événements qui suivirent, au Parlement, la mort de Louis XIV, Jean Gilbert de L’Isle, qui n’est pas encore commis du greffe en titre d’office, ne manque pas de relever l’insistance des pairs à relancer à l’aube du règne de Louis le Quinzième, aussitôt éteint son prédécesseur, une de ces éternelles querelles de protocole ou de préséance (Isabelle Brancourt, L’Affaire du bonnet (1716) : De L’Isle versus Saint-Simon, 2013 - parlementdeparis.hypotheses.org). |