

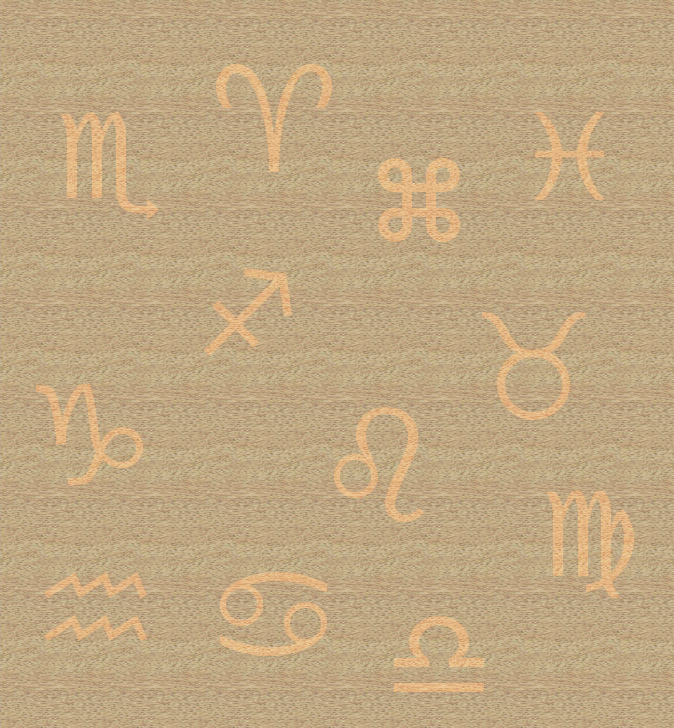
|
Le premier partage de la Pologne III, 89 1770 En ce temps là sera frustrée Cypres De son secours de ceux de mer Egée : Vieux trucidés, mais par masles galyphres Seduict leur roy ,
royne plus outragée Ottomans en
Méditerranées Les Ottomans commencent à pointer le bout de leur nez en
Méditerranée orientale au milieu du XVI° s. Le pirate Kayredin Barberousse fait
une rapide incursion en Crète en 1538, semant la désolation sur son passage.
Chypre est conquise en 1570, et il devient clair que leur prochaine Ă©tape sera
la Crète. En 1645, le sultan envoie 400 vaisseaux et 30 000 hommes qui
débarquent dans la région de Hania (La Canée). Toutes les villes tombent assez
rapidement, sauf Candie (Héraklion). Commence alors un siège incroyable, long
de 21 ans, où les Vénitiens, unis aux Crétois, font le gros dos. Cela
mériterait une inscription au Guinness des records, dans la catégorie «le plus
long siège de l'histoire» (voir le chapitre consacré à Héraklion). La Crète a
perdu beaucoup d'habitants : on ne dénombre plus dans l'île que 60000
chrĂ©tiens et 30000 musulmans. Revanchards, les VĂ©nitiens, qui ont rĂ©ussi Ă
conserver quelques places fortes, tenteront de reprendre l'île. Sans succès.
Les Crétois encaissent le choc de la «turcocratie» et, quand la coupe est
pleine, on repart dans une nouvelle série de révoltes. Une de celles qui ont le
plus grand retentissement a pour point de départ, en 1770, Chora Sfakion, au
sud de l'île. Les Russes, qui s'intéressent
à la région, ont approché un chef local, Daska-loyannis, lui promettant leur
soutien. Evidemment, rien de tel ne se fera, et les 2 000 combattants
sfakiotes se retrouveront face à 15 000 Turcs bien armés. Daskaloyannis, lui,
finit en martyr, écorché vif sur la grand-place d'Héraklion (Guide
du Routard Crète, 2020 - www.google.fr/books/edition). La révolution d'Orloff ou expédition des frères Orloff
est un Ă©pisode de la guerre russo-turque qui opposa la Russie de Catherine II
et l'Empire ottoman entre 1768 et 1774. Cet épisode révolutionnaire se déroula
en Grèce, principalement dans le sud du Péloponnèse à partir du Magne et en mer
Égée, dans les Cyclades. Elle est considérée comme un des prémices de la guerre
d'indépendance grecque. La Russie qui cherchait un débouché sur une mer tempérée
affrontait régulièrement l'Empire ottoman pour atteindre d'abord la mer Noire,
voire la Méditerranée. Elle sut utiliser les légendes grecques. Ainsi,
Catherine II avait prénommé son petit-fils, qui devait lui succéder,
Constantin. Elle avait également planifié l'avenir de toute la région dans son
projet grec, prévoyant notamment la restauration de l'Empire byzantin. Aussi,
lorsque les Russes attaquèrent les Ottomans en 1769, il sembla à certains Grecs
évident que les légendes allaient devenir réalité et que les prophéties
allaient se réaliser. En janvier 1769, les différends entre Russes et Ottomans
autour de leurs ambitions respectives en Pologne amenèrent une guerre entre les
deux empires. Le comte Grégory Orloff, alors le favori de la Tsarine, avait
noué des contacts avec des Grecs, principalement Gregori Papadopoulos,
originaire de Thessalie. Papadopoulos avait rencontré à Kalamata un chef de
guerre maniote de la famille Mavromichalis et des primats, des Ă©vĂŞques et des
klephtes. Il rapportait au comte Orloff un promesse
écrite et signée d'un soulèvement de 100 000 Grecs si une escadre russe,
apportant des armes, paraissait en Égée. En septembre 1769, une flotte de sept
vaisseaux de ligne, quatre frégates et des bâtiments de transport quittait
Saint-Pétersbourg. Cette flotte était commandée par deux frères du comte Orlov
: Fiodor et Alexeï. La Grèce se soulève en de nombreux endroits et les Russes
mènent des opérations conjointes à partir des côtes. Le siège fut mis à Navarin. Alexeï Orlov fut évacué en
mai 1770 par la seconde partie de l'escadre russe venue Ă son secours. La
flotte ottomane chercha Ă Ă©viter l'affrontement avec la flotte russe. Elle se
réfugia d'abord à Nauplie, puis entre Chios et la côte d'Asie mineure, en face
de Tchesmé. L'affrontement eut lieu là le 7 juillet 1770. La défaite ottomane
fut totale, un seul navire ne fut pas coulé : il fut capturé. Les autres
furent tous détruits, principalement grâce aux brûlots. La flotte russe alla
parader devant Constantinople puis mit le siège à Lemnos. Il dura trois mois, puis
les renforts ottomans obligèrent Alexis Orloff à évacuer.La flotte russe alla hiverner dans la baie de Naoussa, au nord de l'île
de Paros, dans les Cyclades. Touchée par une épidémie à l'été 1771, elle évacua
la Grèce, abandonnant ses alliés (fr.wikipedia.org
- RĂ©volution d'Orloff). Les Chypriotes se
révoltent en 1769 et sont apaisés par le Sultan par des concessions faites
dans l'intérêtes de leurs cultes respectifs (Nouvelle
biographie universelle, Tome 37, 863 - www.google.fr/books/edition). (De Venise le 12 décembre 1770) Des lettres de Constantinople portent que le Grand Seigneur ne veut se
prêter à aucun accommodement avec la Russie, & que Sa Hautesse paroît déterminée
à se mettre Elle-même, l'année prochaine, à la tête de ses armées. On mande d'Otrante que trois mille Soldats
Turcs sont arrivés de l'Asie dans l'Isle de Chypre pour la mettre à l'abri des
ennemis Sa Hautesse a déposé, le 5 novembre 1770,
Giafter Bey, Capitan Pacha, & l'a exilé dans l'Isle de Chypre : Elle lui a donné pour successeur Hassan Bey, le même qui a battu les
Russes dans l'Isle de Lemnos (Gazette
de France: journal politique, 1771 - books.google.fr). Le siège de Lemnos fut entrepris par l'escadre russe. Ce
siége durait depuis trois mois, et on espérait affamer la forteresse, lorsque
l'intrépide Haçan-Bey, appelé le Crocodile de la mer des batailles, part des Dardanelles
avec quinze cents hommes, débarque sur la plage de Lemnos, et afin que ses
soldats ne cherchent plus leur salut que dans la victoire, il repousse au large
les bateaux qui les ont apportés. Il surprend les assiégeants qui, saisis
d'effroi, ne songent qu'Ă fuir, gagnent leurs vaisseaux et appareillent en
toute hâte. Après ce hardi coup de main, Haçan-Bey, ravitaille la place et
revient en triomphe aux Dardanelles. Le sultan Mustapha récompensa par la
dignité de capitan-pacha l'auteur de cette action (Nouvelle
biographie universelle, Tome 37, 1863 - www.google.fr/books/edition). Pour Hassan Bey : cf. quatrain précédent III, 88. "mesles" (les éditions de 1555 et 1557 ont "masles") "mesles" : nèfles (Rabelais, Pantagruel : Livre
II, I) (Oeuvres
de François Rabelais, 1875 - www.google.fr/books/edition). Neffle : Fruit rond, & qui a cinq noyaux. Les neffles
ne sont bonnes que quand elles sont molles. Les neffles sont fort astringentes.
On les appelle mĂŞles du mot Latin mespilum, qui signifie la mĂŞme chose, qui a
été formé du Grec "mespilon". En Anjou, en Touraine, en Normandie,
& en Allemagne, on dit mespelen. Neffle est le mot du bel usage. Neffle, se
dit aussi en parlant des choses qu'on veut mepriser. On vous donnera des
neffles. Cela me coute de la bon argent, je ne l'ai
pas eu pour des nefles. NEFFLES, se dit proverbialement le temps & la
paille les nefles meurissent; pour la plupart des choses demandent du tems
& du soin. NEFFLIER. Arbre qui porte des neffles. Le neflier est de
mediocre grandeur : ses feuilles sont faites Ă -peu
près comme celles du laurier : les fleurs sont grandes, à plusieurs feuilles,
disposées en rose, de couleur blanche, ou rouge. Son fruit est gros comme une petite grain de ftiptique, presque rond, rougeâtre quand
il est meur. En Latin mespilus germanica folio laurino non serrato, sive
mespilus sylvestris. C. Bauh. Les neffles sont astringentes, propres pour
arrĂŞter le cours de ventre & le vomissement. On met les neffles sur de la
paille pour les faire meurir. Il y a plusieurs autres especes de nefflier (Dictionnaire
universel : contenant généralement tous les mots françois, tant vieux que
modernes et les termes des sciences et des arts, Tome 3, 1727 - books.google.fr). "lyphres" Brind'amour conjecture galifres (du gascon
"vorace", "goinfre") (Pierre
Brind'Amour, Les premières centuries, ou, Propheties de Nostradamus (édition
Macé Bonhomme de 1555), 1996 - books.google.fr). « Galifre » signifie « gros mangeur » et « lifre-lofre » est un sobriquet désignant un Suisse ou un Allemand (Revue de linguistique et de philologie comparée, Volume 16, 1883 - books.google.fr). Ainsi quand vous glosez «mesles et lyphres» par «les
tristes événements résultant de la promiscuité des occupants et des occupés».
Mon ami, répondit M. Leslucas, cette traduction s'impose. «Lyphre», comme l'a
bien vu Le Pelletier il y a quatre-vingts ans, est Ă©videmment une forgerie
d'helléniste : y en dénonce l'origine et l'inutile h de ph inutile puisque la
rime est -ipre «en remet», si vous me permettez cette vulgarité «Les lyp(h)res» ne peuvent être que le grec ta lypra, «les choses
tristes ou attristantes». Et voyez comme le mot, bien que suggéré par la rime
(«Cypres» est exigeante !) est opportun : il établit comme un lien naturel,
fatal, une prédestination entre la consonance du nom de Chypre et l'épreuve qui
va l'affliger On pense à cet autre vers, conservé je crois dans une biographie
de Sophocle, où Ulysse poursuivi par le sort s'écrie (j'arrange un peu) : «Oui,
c'est Ă juste titre que je m'appelle Odysseus, d'un nom de mĂŞme racine que
celui de la souffrance, odynè.» Ne nous étonnons pas non plus de voir ici
francisé un mot grec (Georges
Dumézil, Le moyne noir en gris dedans Varennes, sotie nostradamique suivie d'un
divertissement sur les dernières paroles de Socrate, 1984 -
www.google.fr/books/edition). Lyphre: de Grec «"lupros", triste, misérable,
pauvre, chétif.» (Bailly) (Guerre de
Chypre - donmichel.blog132.fc2.com). Par la dive Oie
Guenet, s'écria Pantagruel, depuis les dernières pluies, tu es devenu grand lifre-lofre, voire di-je, philosophe (Oeuvres:
Contenant cinq livres de la vie, faits, et dits heroiques de Gargantua, et de
son fils Pantagruel, 1605 - books.google.fr). Frédéric II Frédéric II de Prusse, dit Frédéric le Grand (en allemand :
Friedrich der GroĂźe), nĂ© le 24 janvier 1712 Ă Berlin et mort le 17 aoĂ»t 1786 Ă
Potsdam, de la maison de Hohenzollern, est roi de Prusse de 1740 Ă 1786, le
premier à porter officiellement ce titre. Il est simultanément le 14e
prince-électeur de Brandebourg. Il est parfois surnommé affectueusement der
alte Fritz (le vieux Fritz). Agrandissant notablement le territoire de ses
États aux dépens de l'Autriche (Silésie, 1742) et de la Pologne
(Prusse-Occidentale, 1772), il fait entrer son pays dans le cercle des grandes
puissances européennes. Ami de Voltaire, il est l'un des principaux représentants
du courant du «despotisme éclairé». Il fait publier en 1740 l'Anti-Machiavel où il expose
(anonymement) ses idées sur une monarchie contractuelle, soucieuse du bien des
citoyens. Il gagne ainsi, l'année même où il succède à son père, le titre de roi-philosophe (fr.wikipedia.org
- Frédéric II (roi de Prusse)). "séduict" Il reste à expliquer pourquoi Frédéric inclina de bonne
heure vers le sensualisme et tomba mĂŞme, Ă certains Ă©gards, dans le
matérialisme. [...] Ne parlant que notre langue, ne lisant que nos écrivains
classiques, charmé, séduit par l'esprit
français, admirateur enthousiaste autant que naïf de Voltaire, pouvait-il
ne pas accepter la philosophie régnante en France, surtout quand elle lui
arrivait revêtue des grâces de la poésie, et avec le prestige de ce maître
incomparable ? (G. Rigollot, Frédéric II:
philosophe, 1875 - books.google.fr). Travailler pour le
roi de Prusse Cette expression un peu sibylline, lexicalisée pour la
première fois par Quartet en 1842, a fait couler de l'encre. Cela veut dire
"Travailler sans recevoir aucun salaire" - plus exactement "en
être pour sa peine", avec une nuance de forte déconvenue. Mais de quel roi
de Prusse s'agit-il ? Et quelles sont les circonstances qui ont créé cette
formulation ironique ? Une chanson citée par Rey-Chantreau à propos de la
défaite de Rossbach le 5 novembre 1757, se moque du prince de Soubise battu par
les Prussiens de Frédéric II, en ces termes a travaillé pour le roi... de
Plusse. Une telle formulation laisserait supposer que la locution existait dĂ©jĂ
Ă cette date, et non pas qu'elle en est l'origine. En effet personne ne
s'attendait à une récompense quelconque de la part de Frédéric lors de ce
désastre historique, sorte de "coup de Trafalgar" avant la lettre,
que Voltaire rĂ©sumait ainsi "Les Français et les Autrichiens s'enfuirent Ă
la première décharge. Ce fut la déroute la plus inouïe et la plus complète dont
l'histoire ait jamais parlé. Cette bataille de
Rossbach sera longtemps célèbre. On vit trente mille Français et vingt mille
Impériaux prendre une fuite honteuse devant cinq bataillons et quelques
escadrons". (MĂ©moires, 1760) (Claude
Duneton, La puce à l'oreille: Les expressions imagées et leur histoire (2001),
2005 - books.google.fr). J'ai souffert tout cela pour me conserver au
public, comme si c'eût été des nèfles (Cardinal de Retz) : Des
nèfles, des riens. La locution est bizarre, mais s'explique par l'expression
proverbiale : «Cela m'a coûté de bon argent; je ne l'ai pas eu pour des
nèfles» (M.
Regnier, Manifeste de Monseigneur le duc de Beaufort par le Cardinal de Retz,
OEuvres, Tome 5, 1880 - books.google.fr). Poison Les amandes amères, les amandes des noyaux d'abricots, de
pêches, de prunes, de nèfles ou de cerises contiennent un puissant poison, le
cyanure (Christine
Rivereau, Guide sanitaire pour les professionnels de l'enfance, 2012 -
books.google.fr). Monsieur Guibert a dit dans son Eloge de Frédéric,
d'après le témoignage de Quintus Icilius, que ce prince portait du poison sur
lui pendant une partie de la campagne de 1761. [...] Le célèbre Guichard, dit
M. Guibert, un des favoris du roi, plus connu sous le nom de Quintus-Icilius,
qu'il lui avait donné à cause de son goût pour les légions romaines et pour l'antiquité,
a consignĂ© dans des MĂ©moires manuscrits, et m'a rĂ©pĂ©tĂ© plusieurs fois qu'Ă
cette Ă©poque, et pendant une partie de cette campagne, il portait du poison sur
lui. Admirateur des anciens, attaché par goût à la doctrine des stoïciens, il
devait non-seulement regarder le suicide comme une action permise, mais encore
comme une action glorieuse et héroïque. C'est ce qu'en pensaient les Romains,
lorsqu'il n'Ă©tait pas la suite des remords et du crime et les stoĂŻciens
disaient : Le sage saura quand il lui convient de mourir ; il lui sera
indiffĂ©rent de recevoir la mort ou de se la donner. Des faits viennent Ă
l'appui de ces conjectures. Il est certain que Frédéric s'est expliqué souvent
en faveur du suicide ; il est certain qu'il ne le croyait point un crime, et
qu'il ne pensait pas qu'il méritât d'être puni par les lois. [...] Voilà donc
un prince, admirateur des vertus que les anciens appelaient héroïques, imbu de
la morale des stoïciens, qui approuvait le suicide, déclarant plusieurs fois de
vive voix et par Ă©crit qu'il ne regarde pas le suicide comme un crime, Ă©crivant
en vers et en prose qu'il a envie de se tuer. voilĂ le
témoignage répété d'un de ses favoris, attesté par un officier respectable;
peut-on dire après cela qu'il n'est pas probable que Frédéric ait porté du
poison sur lui ? Mais si tout cela ne suffisait pas pour dissiper les
doutes que M. N. pourrait avoir fait naître, j'en appellerais au témoignage
d'un général respectable qui vit à Berlin, M. de Letschwitz. Ayant entendu
parler de cette anecdote, il demanda ce qu'on en devait croire, Ă une personne
qui pouvait le savoir mieux que tout autre, puisqu'elle avait accompagné le roi
dans la guerre de sept ans, et qu'elle avait joui de sa familiarité et de sa
confiance. Cette personne lui répondit : « Il est vrai, et très-vrai,
que le roi avait de quoi s'expédier au cas qu'il fût fait prisonnier, ou que
les affaires fussent désespérées. Quatre jours après une bataille, il me montra
un paquet de pilules d'opium, et d'autres pilules plus expéditives, en disant:
VoilĂ de quoi n'avoir rien Ă craindre, quelque malheur qui m'arrive; je puis
finir la comédie quand bon me semblera. A cette occasion le roi s'entretint
pendant deux heures avec moi sur le suicide, et le défendit avec beaucoup
d'éloquence et de chaleur » (Jean-Charles
Laveaux, Vie De Frederic II., Roi De Prusse, Tome 2, 1789 - books.google.fr). "trucidés" "trucider" : av. 1476
(Journal parisien de Jean Maupoint, éd. G. Fagnez ds Mém. Sté hist. Paris, t.
4, 1877-78, p. 103), semble disparaître entre le XVIe (Gdf.) et la fin du XVIIIes.:
ca 1792 (C. Desmoulins, Les RĂ©volutions de France et de Brabant, III, p. 165
[Germain au procès de Babeuf] ds Brunot t. 9, p. 42); devenu terme plais. 1863
(Gautier, loc. cit.). Empr. au lat.trucidare «égorger, massacrer». Cf. dès le
XIVe s. l'a. prov. trucidar «massacrer», hapax (ca
1330 Rouergue ds Levy Prov.) (www.cnrtl.fr). "Vieux
trucidés..." : suicidés par le fer et le poison Commençant par les mots horrendum scelus, l'acte que
produit le pape Jean XXII Ă l'intention de l'Ă©vĂŞque de Riez pour instruire le
procès de l'évêque de Cahors Hugues Géraud, affirme que, selon les lois
humaines, il est plus atroce de tuer par le poison que par le glaive : leges humanae atrocius judicant hominem
veneno extinguere quam gladio trucidare - reprenant une formule de
l'empereur Antonin le Pieux (Frank Collard, Gifteinsatz und politische Gewalt,
Die Semantik der Gewalt mit Gift in der politischen Kultur des späten Mittelalters,
2009). Tant que notre corps et notre esprit jouissent de toutes
leurs facultés et nous permettent de mener une vie digne, il n'y a pas de
raison de se tuer, affirme Sénèque. En revanche, continuer à vivre dans la
décrépitude et les souffrances d'une vieillesse avancée alors qu'il ne tient
qu'à nous de nous en délivrer est le comble de la sottise. Celui qui attend
lâchement la mort ne diffère guère de celui qui la craint; et c'est être bien
ivrogne, lorsque l'on a bu le vin, de boire encore la lie. Mais c'est une
question de savoir si cette dernière portion de la vie en est la lie, ou le
plus pur, particulièrement quand le corps n'est point usé et que l'esprit et
les sens prêtent leur secours ordinaire aux fonctions de l'âme [...]. Si le corps
devient inutile à toutes sortes d'emplois, pourquoi ne pas délivrer l'âme, qui souffre
en sa compagnie ? Il s'en trouve bien peu qui soient arrivés à la mort par
une longue vieillesse sans aucune altération ni déchet en leurs personnes. Mais
il y en a beaucoup à qui la vie est demeurée sans en pouvoir user. Pourquoi
donc estimerez-vous que ce soit une cruauté d'en retrancher quelque portion,
sachant bien qu'elle doit finir un jour ? Pour moi, je ne fausserai point
compagnie Ă la vieillesse, pourvu qu'elle me laisse en mon entier, j'entends de
la meilleure partie de moi-mĂŞme. Mais si elle vient Ă Ă©branler mon esprit, Ă
altérer ses fonctions, s'il ne me reste qu'une âme destituée de raison, je délogerai
de cette maison, la voyant minée et prête à tomber. [...] Si je sais que je
doive souffrir perpétuellement, je me tirerai de la vie, non pas à cause de la
douleur, mais à cause de l'incommodité qu'elle m'apporterait dans les actions
de la vie. En effet, j'estime lâche celui qui meurt de peur de souffrir, et sot
celui qui vit pour souffrir». La leçon sera entendue par beaucoup de vieux
patriciens romains de la fin du Ier siècle et du début
du IIe, formés dans la philosophie stoïcienne. Pline le Jeune rapporte avec
admiration dans ses lettres plusieurs exemples de vieillards malades qui décidèrent
de sortir dignement de cette vie : un de ses amis, âgé de soixante-sept ans,
perclus de goutte, souffrant «les douleurs les plus incroyables et les plus
imméritées», vient de se donner la mort, ce qui, note Pline, «soulève mon
admiration devant sa grandeur d'âme». Dam une autre lettre, il évoque Titus
Aristo, qui «pesa délibérément les raisons de vivre et de mourir», puis se
donna la mort. Ailleurs encore, il s'agit d'un homme de soixante-quinze ans,
atteint d'un mal incurable «Fatigué de la vie, il y mit fin.» Il rappelle aussi
le cas d'Aria, une Romaine qui, pour encourager son mari vieux et malade Ă se suicider,
lui montra l'exemple en se tuant devant lui; ou bien l'histoire touchante d'un
vieux couple d'humbles citoyens le vieil homme souffrant d'un ulcère incurable,
sa femme «lui conseilla de mettre fin à ses jours, et, l'accompagnant, lui
montra la voie par son exemple et en Ă©tant le moyen de sa mort; car,
s'attachant à son mari elle plongea dans le lac». [...] Ces suicides héroïques, accomplis par l'épée ou en se
tranchant les veines, sont rapportés avec admiration parles historiens romains
comme autant d'illustrations de la libertĂ© suprĂŞme des individus supĂ©rieurs Ă
leur destin (Georges
Minois, Histoire du suicide: La société occidentale face à la mort volontaire,
2014 - books.google.fr). Le retentissement du roman Les souffrances du jeune
Werther, de Goethe, est révélateur de la sensibilité ambiante. Werther ne crée
pas une mode; il est l'expression d'un climat auquel il donne une forme. Les débats
sur le suicide ont largement sensibilisé les milieux cultivés depuis le milieu
du siècle. La lettre de Saint-Preux date de 1761, le suicide de Chatterton, les
amants de Lyon et la version française du traité de Hume de 1770, la mort des
soldats de Saint-Denis de 1773. Werther arrive au moment oĂą les passions sur la
légitimité de la mort volontaire s'exacerbent (Georges
Minois, Histoire du suicide: La société occidentale face à la mort volontaire,
2014 - www.google.fr/books/edition). Outrage à la Reine Élisabeth-Christine de Brunswick-Wolfenbüttel (de la
branche de Bevern), née le 8 novembre 1715 à Wolfenbüttel et morte à 81 ans le
13 janvier 1797 près de Berlin, au château de Schönhausen, était l'épouse du
roi de Prusse Frédéric le Grand. Bien qu'ayant été élevée dans la religion
luthérienne, elle fut promise au prince de Prusse qui était de confession
calviniste. Les fiançailles d'Élisabeth et de FrĂ©dĂ©ric furent cĂ©lĂ©brĂ©es Ă
Berlin, le 10 mai 1732. Après l'accession au trône de Frédéric, le ménage cessa
toute vie commune (Frédéric préférait la compagnie masculine), mais se
retrouvait pour des cérémonies officielles, de rares anniversaires, etc. La
reine fut relĂ©guĂ©e au château de Berlin tandis que FrĂ©dĂ©ric vivait Ă
Sans-Souci. Frédéric ne vint jamais rendre visite à son épouse à Schönhausen et
Élisabeth ne vint pas non plus à Potsdam. Le couple n'eut donc pas d'enfant
mais le roi maria son frère et héritier à la sœur d'Élisabeth-Christine (fr.wikipedia.org
- Elisabeth-Christine de Brunswick-Wolfenbüttel-Bevern). Frédéric de Prusse
et la guerre russo-turque : le partage de la Pologne et la vieillesse du roi Les Turcs entrent en guerre contre la Russie au sujet de
la Pologne qui les appelle au secours après le massacre de Balta (Jean-Pierre
Bois, De la paix des rois Ă l'ordre des empereurs (1714-1815), Tome 3, 2014 -
www.google.fr/books/edition). Le premier partage de la Pologne a lieu en 1772 et est le
premier des trois partages qui ont mis fin Ă l'existence de la RĂ©publique des
Deux Nations en 1795. La croissance de la puissance de l'Empire russe, menaçant
le royaume de Prusse et l'empire des Habsbourg-Lorraine, a été le principal
motif de ce premier partage. Frédéric II de Prusse conçut ce partage comme un
moyen d'empêcher l'Autriche, jalouse des succès russes contre l'Empire ottoman,
de se mettre en guerre. Les terres de la RĂ©publique des Deux Nations, y compris
celle déjà contrôlées par la Russie, seront réparties entre ses voisins plus
puissants - l'Autriche, la Russie et la Prusse - afin de rétablir l'équilibre
des forces en Europe entre ces trois pays. La Pologne est incapable de se
dĂ©fendre efficacement, et avec des troupes Ă©trangères dĂ©jĂ installĂ©es Ă
l'intérieur du pays, le parlement polonais (Sejm) est obligé de ratifier le
partage en 1773 lors de sa convocation par les trois puissances (fr.wikipedia.org
- Premier partage de la Pologne). Le 18 novembre 1771 , Voltaire écrit à Frédéric : On dit,
Sire, que c'est vous qui avez imaginé le partage de la Pologne, et je le crois,
parce qu'il y a là du génie, et que le traité s'est fait à Potsdam (Oeuvres
completes de Voltaire, Correspondance avec le Roi de Prusse, Tome 3, 1821 -
www.google.fr/books/edition). LETTRE CCCLXXXI. Du Roi Ă Voltaire Potsdam, ce 9
octobre 1775. Je m'apperçois avec regret
qu'il y a près de vingt ans que vous êtes parti d'ici : votre mémoire me
rappelle Ă votre imagination tel que j'Ă©tais alors ; cependant si vous me
voyiez, au lieu de trouver un jeune homme qui a l'air Ă la danse, vous ne
trouveriez qu'un vieillard caduc & décrépit. Je perds chaque jour une
partie de mon existence, & je m'achemine imperceptiblement vers cette
demeure dont personne encore n'a rapporté de nouvelles. Les observateurs ont
cru s'appercevoir que le grand nombre de vieux militaires finissent par
radoter, & que les gens-de-lettres se conservent mieux. Le grand Condé,
Marlborough, le prince Eugène, ont vu dépérir en eux la partie pensante avant
leur corps. Je pourrai bien avoir un même destin, sans avoir possédé leurs
talens. On sait qu'Homère, Atticus, Varron,
Fontenelle, & tant d'autres, ont atteint un grand âge sans éprouver les
mêmes infirmités. Je souhaite que vous les surpassiez tous par la longueur de
votre vie & par les travaux de l'esprit. Sans m'embarrasser du sort qui
m'attend, de quelques années de plus ou de moins d'existence, qui disparaissent
devant l'Éternité, on va inaugurer l'église catholique de Berlin. Ce fera
l'évêque de Warmie qui la consacrera. Cette cérémonie, étrangère pour nous,
attire un grand concours de curieux. C'est dans le diocèse de cet évêque que se
trouve le tombeau de Copernic, auquel, comme de raison, j'érigerai un mausolée.
Parmi une foule d'erreurs qu'on répandait de son temps, il s'est trouvé le seul
qui enseignât quelques vérités utiles. Il fut heureux : il ne fut point
persécuté. Le jeune d'Etallonde, lieutenant à Vésel, l'a été : il mérite
qu'on pense à lui. Muni de votre protection & du bon témoignage que lui
rendent les supérieurs, il ne manquera pas de faire son chemin. J'en reviens à ce roi de Pologne dont vous me parlez. Je sais que l'Europe croit assez généralement que le partage qu'on a fait de la Pologne est une suite des manigances politiques qu'on m'attribue ; cependant rien n'est plus faux. Après avoir proposé vainement des tempéramens différens, il fallut recourir à ce partage, comme à l'unique moyen d'éviter une guerre générale. Les apparences sont trompeuses, & le public ne juge que par elles. Ce que je vous dis est aussi vrai que la 48ème proposition d'Euclide (Oeuvres Posthumes De Fréderic II, Roi De Prusse: Correspondance Avec M. De Voltaire. Tome V, 1789 - books.google.fr). Selon Frédéric II, la Pologne fut sacrifiée à la paix de
l’Europe. Le premier livre des Éléments d'Euclide se termine pour
sa part par la proposition 47 : "Dans les triangles rectangles, le
carré du côté opposé à l'angle droit est égal aux carrés des côtés qui comprennent l'angle droit", et par la proposition 48 :
Si le carré d'un des côtés d'un triangle est égal aux carrés des deux côtés
restants de ce triangle, l'angle compris par les deux côtés restant est droit (Revue
d'histoire des sciences et de leurs applications, Volume 20, 1967 -
books.google.fr). Ce n'est qu'au siècle dernier que l'appellation «de
Pythagore» a été accolée à ce théorème, sans la moindre raison sérieuse pour
cela. Voici une maxime qui appartient Ă l'Ă©cole de Pythagore :
«Si
tu es malheureux dans ta jeunesse, ne t'en plains pas : les nèfles
mûrissent sur la paille» (p. 264. Résumé des traditions morales et
religieuses par M. de SĂ©nancourt, 1825 ; Voyages de Pythagore en Egypte,
dans la Chaldée, dans l'Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile, Volume 6 par
Pierre-Sylvain Maréchal, 1798) (Oeuvres
et critiques, Volume 33, 2008 - books.google.fr). Acrostiche : EDVS,
edus Les «rustici», dit Varron (L. L., VII, 96), prononcent
mesium pour maesium ; on parle comme un «rusticus», dit Lucilius (1130 Marx),
si l'on dit Cecilius pretor ; le
nom du chevreau est Ă la campagne edus, dit Varron (L. L. V, 19, 97) (Collection
Linguistique, Numéro 53, 1949 - www.google.fr/books/edition). Le mythe orphique relate un meurtre, suivi d'un démembrement, puis d'une double cuisson
des chairs de la victime. Il est aux antipodes des pratiques du diasparagmos et
de l'ômophagie opérées à l'instigation du Dionysos «encorné comme un taureau»
et «coiffé d'une couronne de serpents» qu'Euripide met en scène dans ses
Bacchantes (100-101). Ce fils «rugissant» et «grondant» (bromios) que Zeus eut
d'une mortelle, la princesse thébaine Sémélé, fait partager à ses fidèles son
goût pour les lacérations de chairs vives. Le
rite consistait à dévorer la chair crue (ômophagie) d'un animal pourchassé par
monts et par vaux et déchiqueté vif (diasparagmos). Euripide a évoqué le
délice particulier que ressent le possédé de Dionysos quand, au terme de sa
participation Ă une danse bruyante et Ă une course tumultueuse Ă travers les
montagnes boisées, il se gave des chairs sanglantes et encore palpitantes de sa
victime. Le chrétien Arnobe surmontera son mépris et son dégoût pour décrire
avec réalisme ces festins ômophagiques au cours desquels les participants
déchiraient pleines dents les entrailles de victimes caprines dont les bêlements,
précise-t-il, se faisaient encore entendre (Advans. gentes, V). Ce caractère
délirant du dieu était connu d'Homère qui qualifiait déjà Dionysos de
mainomenos, «furieux», «délirant» VI, 132). Le mot pluriel «ménades», désignant
les servantes de ce Dionysos (Bacchios), est de la même racine que l'épithète
accolée au dieu dès l'Iliade. Un pan du vocabulaire orgiaque compte mania, le
«délire», la «frénésie» ; mainas, la «démente». Dionysos maintient ses
adeptes en perpétuel état d'affolement : hallucinées, les Bacchantes
croient voir sourdre des fontaines de lait, de vin et de miel; Ă peine
ont-elles entendu les mugissements d'un troupeau au loin qu'elles cessent de
donner le sein à des animaux sauvages couronnés de lierre et de liseron pour
bondir et fondre sur les bêtes qu'elles déchirent (Bacchantes, 689-711). La
victime est chargée d'efficace divine par la magie même du rite - lui-même
inséparable de l'état de transe orgiaque (ekstasis, sortir de soi). Les
Bacchantes s'incorporent le dieu (enthéoi, d'où enthousiasmes) quand elles
dévorent tout cru l'animal : il y a un Dionysos «chevreau» (rituels laconiens), un Dionysos «taureau»
(rituels éléatiques) ; un Dionysos «à la
peau de chèvre» (en Attique) ; un Dionysos «panthère» ou «faon». La
libération (lysis) orgiaque vise la régénération au contact du divin au moyen
d'une évasion par le bas de la banalité quotidienne diasparagmos et ômophagie déchaînent
et ensauvagent à force d'ébats frénétiques et de transports extatiques. La
confusion bestiale avec la divinité se prolonge dans le présent en s'affichant
jusque dans l'accoutrement des Manades flanquées de leur nébride (peau de
chèvre) (Reynal
Sorel, Orphée et l'orphisme, 1995 - books.google.fr). Les Ménades, possédées par le dieu, sont dans un état
second qui leur confère une énergie prodigieuse les rendant inaptes à la
fatigue. Enfin elles s’emparent de l’animal, et, Ă mains nues, le mettent Ă
mort en le déchirant, reproduisant sauvagement la façon dont les Titans ont mis
à mort, un jour, l’enfant Dionysos. Comme eux, ensuite, elles procèdent au
repas homophagique, à ceci près que les Titans avaient fait bouillir le dieu,
et qu’elles consomment crus les morceaux de leur victime. Ainsi, à travers le chevreau, Dionysos est d’abord mis à mort dans
l’éclatement de son corps, et ensuite reconstitué pour autant que le thiase des
Ménades, fusionnant en une unité mystique, symbolise la retrouvaille de l’unité
du dieu qui, redevenant Un Ă travers les MĂ©nades, se traduit en elles par une
effusion extatique : leur identification à la présence du dieu les
laisse absentes d’elles-mêmes, hors d’elles-mêmes. En ceci, elles forment un
corps mystique qui incarne la présence réelle du dieu renaissant à la vie (Alain Didier-Weill,
Dionysos : la naissance de l'acteur, Insistance, 2006/1 (no 2) - www.cairn.info). Thoas naît sur Lemnos, où Dionysos a enlevé Ariane, ses parents. Il devient ensuite roi de l'île ; Lemnos lui est donnée en récompense par Rhadamanthe dont il est un lieutenant ; il a une fille nommée Hypsipyle. Il joue un rôle remarquable dans l'épisode des Lemniennes, lorsque celles-ci décident de tuer tous les hommes de l’île après la malédiction d’Aphrodite : s'il périt dans certaines versions, il est généralement épargné par sa fille. Par la suite, il s’enfuit en Tauride, ou bien est tué lorsque les Lemniennes découvrent l'imposture (fr.wikipedia.org - Thoas (Lemnos)). La vieillesse de
ces grands qui se plaisoient si fort Ă l'Agriculture, qui se doit-elle donc Ă
plaindre. Pour moy je ne sçay s'il y a aucune sorte de vie plus heureuse que
celle-lĂ ? [...] Car dans les celliers d'un bon pere de famille, soigneux
& bon ménager, il y a toûjours du vin & de l'huile en abondance, &
de toute sorte de provisions. Sa maison est riche d'un bout Ă l'autre ; elle produit Ă foison des agneaux, des
chevreaux,des cochons, de la volaille, du fromage & du miel (Cicéron,
Cato Major - De senectute, chap. XVI) (Les
livres de Ciceron, de la vieillesse, et de l'amitie, avec les paradoxes du mĂŞme
autheur, traduits en françois sur l'édition latine de Graevius, avec des notes,
& des sommaires des chapitres, par M. Du Bois, 1698 - books.google.fr). Or, si aucun
mouvement, aucun art, ne peut faire revenir des poissons au lieu de blé dans un
champ, ni des nèfles au lieu d'un agneau
dans le ventre d'une brebis, ni des roses au haut d'un chĂŞne, ni des soles
dans une ruche d'abeilles, etc.; si toutes les espèces sont invariablement les
mêmes, ne dois-je pas croire d'abord avec quelque raison que toutes les espèces
ont été déterminées par le Maître du monde ; qu'il y a autant de desseins
différens qu'il y a d'espèces différentes, et que de la matière et du mouvement
il ne naîtrait qu'un chaos éternel sans ces desseins ? (Voltaire,
Philosophie de Newton, 1738) (Oeuvres
complètes de Voltaire, 1828 - books.google.fr). Il est clair que, sur Jacob, Augustin est, comme
Ambroise, tributaire des clés interprétatives transmises par la tradition
exégétique de l'Église des premiers siècles. Mais l'évêque d'Hippone, qui
n'innove guère, apparaît comme un héritier plus fidèle de ce legs de la
tradition que le pasteur milanais, qui s'y réfère plus librement et de manière
plus occasionnelle. Prenons un exemple instructif. Le De Iacob semble ne rien dire des deux chevreaux que RĂ©becca invite
Jacob à aller chercher dans la bergerie (Gen 27, 9) afm d'en préparer un plat
pour Isaac ; il ne dit rien non plus de leurs peaux, dont la mère de Jacob
couvre les bras de son fils (Gen 27, 16). Augustin, lui, reprend
l'explication qu'on lit déjà chez Hippolyte les deux chevreaux sont une figure
des deux peuples, juif et chrétien, tous deux appelés, selon les termes
d'Hippolyte, «à être offerts à Dieu et constitués en nourriture spirituelle par
le Verbe». Le pasteur africain commente
le nombre deux, développant, en termes pauliniens, la dialectique de la dualité
et de l'unité, et, dans le sillage de Jérôme, lui-même tributaire
d'Hippolyte et de Victorin de Poetovio, il interprète aussi les chevreaux comme
la figure des pécheurs. Tout cela est laissé de côté par Ambroise qui substitue
aux chevreaux des brebis, un subterfuge qui parait relever de ce procédé qu'on
a appelé l'iségèse, mais qui ouvre une voie herméneutique neuve, permettant,
sur le plan moral, de montrer en Jacob un modèle de l'innocence, et sur le plan
mystique, de faire de lui une figure du sacrifice du Christ. [...] Le propos
d'Augustin nous aide à comprendre la métamorphose chez Ambroise des chevreaux
en brebis, car il révèle le texte qui l'a favorisée, et que le pasteur milanais
avait certainement présent à l'esprit bien qu'il ne s'y réfère pas, c'est Jean
10, 16 : «J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie» («Habeo
alias oues, quae non sont de hoc ouili»). Ce rapprochement entre Gn 27, 9 - «Va
donc au troupeau et apporte-m'en deux beaux chevreaux» («Et pergens ad gregem
(Vetus Latina, texte E : ad oues affer mihi duos haedos optimos») - et Jn
10, 16, que nous lisons chez Augustin, devait appartenir Ă une tradition plus
ancienne connue aussi d'Ambroise. Quoi qu'il en soit, la substitution des brebis aux chevreaux oriente l'explication vers un
tout autre motif, celui du sacrifice, avec des tenons intermédiaires, Isaïe
53, 7 («sicut omis ad occisionem ducetur») et Jérémie 11, 19 («Et ego quasi
agnus mansuetus qui portatur ad uictimam»), cités par Ambroise sous forme de
claire réminiscence. Mais celui-ci n'occulte pas pour autant le figuralisme
habituel qui voyait dans les chevreaux une métaphore des pécheurs (Gérard
Nauroy, Formes de l'exégèse pastorale chez Ambroise et Augustin, Saint Augustin
et la Bible, 2008 - books.google.fr). |