

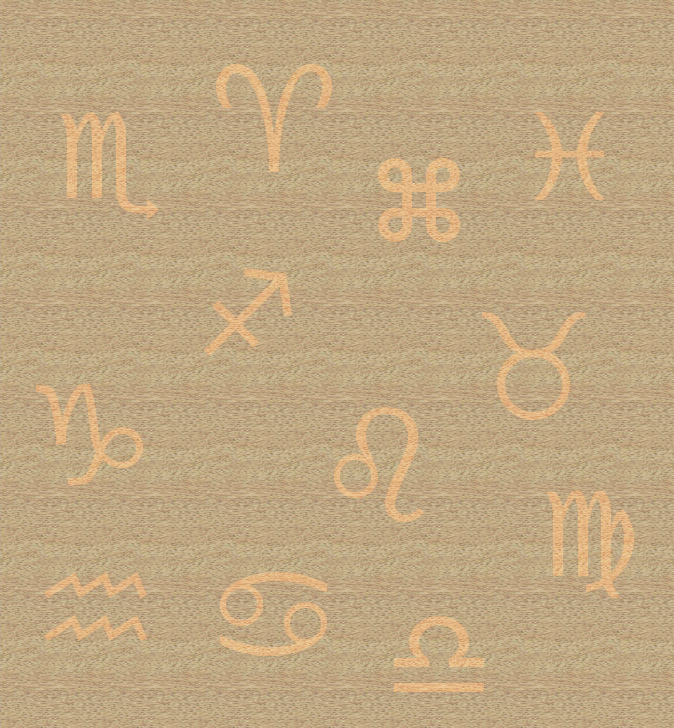
|
Projet de mariage du duc d'Alençon et de la reine Elisabeth X, 56 2218-2219 Prélat royal son baissant trop tiré, Grand flux de sang sortira par sa bouche, Le rÚgne Anglicque par rÚgne respiré, Longtemps mort vifs en Tunis comme souche. "Anglicque" Cf. X, 42 - John Dee et saint Dunstan - 2208 pour
interprĂ©ter Anglicque-angĂ©lique sous l'identitĂ© d'Elisabeth IĂšre d'Angleterre. Tunis La TempĂȘte est
une comĂ©die-fĂ©erie en cinq actes, de William Shakespeare. La TempĂȘte paraĂźt
avoir été composée, si l'on se rapporte à Malone, vers 1611 ou 1612, et, par
conséquent, c'est un des derniers ouvrages de Shakespeare. Prospero, duc de
Milan, a été chassé de ses Etats par son frÚre Antonio, aidé d'Alonzo, roi de
Naples. Il aborde avec sa fille Miranda dans une Ăźle dĂ©serte, oĂč les secrets
magiques que de longues études lui ont fait acquérir soumettent à sa volonté
tous les esprits. Ariel, génie aérien,
léger, rapide et gracieux, jouit de toute la confiance de Prospero et exécute ses
ordres avec la promptitude de l'éclair; tandis que Caliban, sorte de génie
malfaisant, abject et difforme, produit d'une sorciÚre et d'un démon, livré aux
travaux matériels et grossiers, n'ouvre la bouche que pour accabler son maßtre
des plus noires malédictions. Depuis
douze ans Prospero est dans cette Ăźle, lorsqu'il apprend que tous ses ennemis
sont sur mer, revenant de Tunis, dont le roi a épousé la fille d'Alonzo. Prospero
ordonne alors Ă Ariel de soulever une violente tempĂȘte, qui amĂšne le naufrage
du navire sur lequel voyageait Alonzo et sa suite et qui les jette dans l'Ăźle.
Mais lorsqu'il a ses ennemis en son pouvoir il se borne, pour toute vengeance,
Ă les faire passer par divers enchantements; puis il se fait reconnaĂźtre,
pardonne Ă son frĂšre Antonio et au roi de Naples, dont le fils Ferdinand Ă©pouse
Miranda, et quitte enfin l'Ăźle pour aller reprendre possession de ses Etats (www.cosmovisions.com). La TempĂȘte est
un poÚme sur les sciences occultes détenues par Prospero. Mais la magie de.
Prospero est la magie blanche, la magie bienfaisante. Il n'y a guĂšre de piĂšce
de "Shakespeare" sans surnaturel, sans présages et prédictions à la
maniÚre de l'antiquité. Le don de prophétie attribué aux hommes supérieurs
quand ils sont sur le point de mourir, est dévolu à Jean de Gand, dans Richard
II. Or Ă l'Ă©poque d'Elisabeth vivait en Angleterre (1574-1641) un personnage
historique trĂšs Ă©trange astronome et astrologue, alchimiste et magicien, trĂšs
considéré par la haute société, trÚs bien vu par la reine. Il voyagea, surtout
en Allemagne et en Hongrie. Il vécut longtemps dans l'opulence et mourut dans
la pauvreté, persécuté par le roi Jacques Ier, l'ennemi fanatique desdites
sciences et le brûleur de sorciÚres. Il fut le pÚre de onze enfants et d'un
plus grand nombre d'ouvrages. On a de lui des Mémoires. Nous sommes renseignés
sur ses évocations par des procÚs-verbaux publiés en 1659 par le Français Méric
Casaubon. Il fait penser à Cornélius Agrippa, à Paracelse, au Docteur Faust,
mĂȘme Ă Svedenborg. Ce personnage, c'est John Dee. Il est un personnage-clef. Il
a été en relations suivies avec William Stanley, qu'il nomme à maintes reprises
dans ses Mémoires. Stanley l'a vénéré et aimé comme un ami et comme un maßtre. Le
miroir magique oĂč Macbeth contemple la lignĂ©e des futurs rois d'Ecosse Stanley
l'a vu fonctionner au laboratoire de John Dee (Etienne
Burnet, Don Quichotte: Cervantes et le XVI e siĂšcle, essai, 1954 -
books.google.fr). Cf. le miroir magique de Nostradamus qui y fait défiler
les portraits des rois qui se succéderont, devant Catherine de Médicis. La critique a vu d'abord en Prospéro un personnage
inspiré du mathématicien, astronome et astrologue John Dee (1527-1609 ?),
conseiller de la reine Ălisabeth IĂšre et dĂ©tenteur de l'une des plus vastes
bibliothĂšques du temps dans sa maison de Mortlake, prĂšs de Richmond, au
sud-ouest de Londres. John Dee
prétendait converser avec les anges, dont Uriel, à l'aide à l'aide de médiums
comme John Kelly, en réalité un véritable escroc qui allait finir ses jours en
prison à Prague. La relation que Prospéro entretient avec Ariel, esprit
païen mais aussi proche de l'archange biblique Uriel dont le nom signifie «feu
de Dieu», renvoie peut-ĂȘtre Ă un type de communication invisible effectuĂ© par
télépathie (Prospéro convoque en effet Ariel par ces simples mots : «Arrive
avec ma pensée !». Prospéro rappelle également la figure du médecin
astrologue et cabaliste Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535), de Roger
Bacon (1214-1294), du chancelier Francis Bacon (1561 - 1626) avec ses Magnalia Naturae Ă©voquant le pouvoir des
mages de dĂ©clencher des tempĂȘtes, de l'empereur Rodolphe II (1552-1612) fĂ©ru de
sciences occultes (William
Shakespeare, La TempĂȘte, 2011 - books.google.fr). David
Scott Kastan (A Companion to Shakespeare, 1999) links the marriage of Ferdinand
and Miranda with that of Princess Elizabeth and Frederick, the Elector
Palatine, and with James I's "fantasy of European peace and
coherence" (John
S. Mebane, Cymbeline, The Winter's Tale, and The Tempest: An Annotated
Bibliography of Shakespeare Studies, 1864-2000, 2002 - books.google.fr). Le projet de
mariage d'Elisabeth IĂšre avec un mort-vivant Dee of course knew all about Elizabeth's long
flirtation with the King of France's brother, Duc d'Alençon, and her diplomatic
holding off from the match. He notes Mr. Stafford's arrival as an emissary from "Monsieur"
on February 16, 1580, and his return in June. On August 16, "Monsieur cam secretly to the Court from Calais." In ten days he
mentions the departure of "Monsieur." The Queen kept a very tender
spot in her heart for this ugly little deformed suitor, and Dee has a remarkable note of a call from
her at Mortlake as she returned from Walsinghams on February 11, 1583:
"Her Majesty axed me obscurely of Monsieur's state I said he was
"biothanatos" (dead-alive) (Charlotte
Fell-Smith, John Dee (1527-1608), 1909 - books.google.fr). Par le biais de ce mariage néfaste entre Henri de Navarre
et Marguerite de Valois, Marlowe fait allusion dans sa piĂšce Massacre at Paris
au projet de mariage entre Ălisabeth et le duc François d'Alençon, futur duc
d'Anjou. Les négociations matrimoniales remontaient en fait à juin 1572 , deux
mois avant la Saint-Barthélemy, mais le duc ne figure pas parmi les personnages
et Marlowe se contente d'une Ă©vocation vaguement Ă©logieuse Ă la fin de la piĂšce
(XIX, 1035) (Laurent
Berec, Un plaidoyer en faveur des Huguenots, Bulletin de la Société de
l'histoire du protestantisme français, Volume 153,Numéro 3, 2007 -
books.google.fr). Ce projet avait été précédé de celui de la reine avec le
futur Henri III, frÚre du duc d'Alençon, alors duc d'Anjou qui avait participé
au massacre. Elisabeth négociait encore avec Don Juan d'Autriche (Hector
de La FerriĂšre, Les projets de mariage d'une reine d'Angleterre III, Revue des
deux mondes, 1881 - books.google.fr). John Stubbes Dans le
pamphlet de John Stubbes écrit en 1579, la figure du monstre est utilisée dans
le titre mĂȘme pour dĂ©crire lâintrusion Ă©trangĂšre sur le territoire: The
Discoverie of a Gaping Gulf whereinto England is like to be swallowed by
another French Mariage, if the Lord forbid not the banes, by letting her Maiestie
see the sin and punishment thereof. Stubbes
dĂ©peint le mariage dâĂlisabeth IĂšre avec le Duc dâAlençon comme un acte de
dĂ©voration oĂč un monstre marin français viendrait engloutir lâAngleterre. Dans
lâutilisation de cette figure monstrueuse, Stubbes sâinscrit dans la lignĂ©e des
autres pamphlétaires de son époque, qui utilisaient le monstre afin de
persuader leur auditoire. Mais cette image lui permet Ă©galement de convoquer
les peurs que les contemporains ont de voir leur identité absorbée par la
présence étrangÚre. (Manon
Turban, «O monstrous ! O strange !» : Le monstrueux dans le théùtre de
Shakespeare, 2017 - journals.openedition.org). Cf. quatrain I, 29 - Le duc dâAlençon, frĂšre de Henri
III, roi de France - 1578-1579. The
âPuritan commoner,â John Stubbs, had the audacity to write a pamphlet urging
the queen not to marry the âsyphiliticâ
French Catholic duc d'Alençon, Elizabeth
had his right hand struck off. The Gaping Gulf argued against the union
with jealous fervor and referred to Elizabeth's frog as a "venemous
toad" (Robyn
Arianrhod, Thomas Harriot: A Life in Science, 2019 - books.google.fr). Notons que
l'angalis "stub" signifie "souche" comme stump. From
Middle English stubbe (âtree stumpâ), from Old English stybb, stubb (âtree
stumpâ), from Proto-Germanic *stubbaz (compare Middle Dutch stubbe, Old Norse
stubbr), from Proto-Indo-European *(s)tew-; compare
steep (âsharp slopeâ) (en.wiktionary.org
- stub). Et suédois "stubb". François d'Alençon Jusqu'à ce moment, nous avons laissé le duc d'Alençon dans
l'ombre : il convient de l'introduire sur la scĂšne oĂč dĂ©sormais il se
mĂȘlera Ă tous les dĂ©sordres et Ă toutes les intrigues. François de France, le
plus jeune des fils de Henri II et de Catherine de
Médicis, était né le 18 mars 1554 ; il était donc en 1572 ùgé de dix-huit
ans. Sa mÚre, pensant, dit BrantÎme, «lui baptiser la fortune meilleure», lui
avait donné d'abord le prénom d'Hercule, qui fut mal justifié. Jamais prince ne
fut plus chĂ©tif. Il Ă©tait si petit qu'Ălisabeth comparait sa taille Ă celle
d'un enfant, et la petite vérole l'avait défiguré à ce point que La
Mothe-FĂ©nelon se vantait prĂšs d'Ălisabeth d'avoir dĂ©couvert un mĂ©decin qui en
effacerait les traces. Le duc de Bouillon écrit à ce sujet : «Monsieur eut la petite vérole en telle
malignité qu'elle le changea du tout, l'ayant rendu mesconnoissable, le visage
lui estant demeuré tout creusé, le nez grossi avec difformité, les yeux
appetissés et rouges de sorte qu'il devint un des plus laids hommes qu'on
voyoit». Le moral valait encore moins. Perdu de meurs, licencieux
dans ses discours, lĂąche, perfide, il Ă©tait plus dangereux pour ses amis que
pour ses adversaires. «Ce prince, disait Henri de Navarre à Sully, me trompera
bien s'il ne trompe tous ceux qui se fieront en luy... Il a le a cĆur si double
et si malin, a le courage si lasche, est tant inhabile Ă toutes sortes de
vertueux exercices que je ne me saurois persuader qu'il fasse jamais rien de
généreux.» Il n'avait que neuf ans quand sa mÚre écrivait : «Je suis ce matin
revenue d'Amboise oĂč j'ay veu un petit moricau qui n'a que guerre et que
tempeste en son cerveau.» Quand il eut grandi, elle continua Ă dire qu'il faisoit tousjours le fol.» Sa sĆur
Marguerite qui l'aimait beaucoup, parodie un mot célÚbre du roi Jean en
assurant que si la fraude avait disparu du monde, on la retrouverait dans le cĆur
de ce prince. «C'est, disait Louis de Nassau, un vase vide, oĂč manquent Ă la
fois la tĂȘte et le cĆur.» Son plus fidĂšle serviteur le vicomte de Turenne qui
fut depuis duc de Bouillon, cherche à l'excuser en alléguant «combien les
mauvais exemples et l'approchement des personnes vicieuses ont de pouvoir Ă
corrompre un bon naturel.» BrantĂŽme qui vĂ©cut Ă la mĂȘme cour, flĂ©trit son
ambition, sa légÚreté et toutes ces hautes menées qui prenaient terriblement
feu ; mais ce n'était qu'un feu de paille. Il faut aussi citer ce témoignage
des relations vénitiennes que ce prince qui visait à de si éclatants exploits,
n'eut jamais que des aventures. Cavalli le dépeint taciturne, porté à la
duplicitĂ© et Ă la dissimulation, prĂȘt Ă tout entreprendre pour dominer, n'ayant
pas plus de prudence qu'un enfant, sans amis et ambitieux outre mesure. «Je ne
sais « qui pourrait ĂȘtre pire que lui», Ă©crit le cardinal de Granvelle,
résumant ces jugements divers. On avait voulu
faire du duc d'Alençon un roi d'Alger, au moment oĂč l'on disait que don Juan
deviendrait roi de Tunis ; mais la négociation la plus sérieuse était celle qui,
Ă une Ă©poque rĂ©cente, avait paru l'appeler Ă partager avec Ălisabeth la
couronne d'Angleterre. Le duc d'Alençon, bien plus que le duc d'Anjou,
Ă©tait portĂ© par son caractĂšre remuant et inquiet Ă ĂȘtre un instrument aux mains
de tous les factieux. DĂ©jĂ , en 1570, le
vidame de Chartres, dans une lettre au marĂ©chal de Montmorency oĂč il se
prononçait en faveur du mariage du duc d'Anjou avec Ălisabeth, ajoutait qu'on
pourrait placer le duc d'Alençon à Milan ou à Naples afin que là aussi on
secouÄt le joug de Rome, Coligny avait, peu de jours avant sa mort, désigné
le duc d'Alençon aux Huguenots comme le chef qu'ils devaient se choisir, au
lieu du duc d'Anjou, dans la grande entreprise des Pays-Bas : legs funeste
qui pÚsera sur toute sa vie et qui jusqu'à la fin de ces récits laissera
presqu'à chaque page une trace de honteuses et stériles intrigues. Depuis longtemps, le duc d'Alençon
entretenait des relations intimes avec les Huguenots : «Quelle
trahison !» s'était-il écrié en apprenant l'attentat de Maurevel. «Il regrettoit
la mort de l'admiral qui l'avoit pris en affection pour le servir et avoit en
horreur la Saint-Barthélemy ?» C'était aux yeux des Huguenots un grand mérite
que d'avoir été l'ami de Coligny. Le prince d'Orange, aprÚs la capitulation de
Mons, s'était déclaré en sa faveur. «Le roi de France, écrit Walsingham le 25
septembre 1572, a été informé de divers cÎtés que le prince d'Orange et le duc
d'Alençon vont vraisemblablement s'entendre. Cependant, quand on renonça au
projet d'employer contre les Huguenots le produit des confiscations prononcées
lors de la Saint-Barthélemy, le duc d'Alençon en accepta une large part. Sa
mĂšre avait cru peut-ĂȘtre se l'attacher par cette libĂ©ralitĂ© ; elle s'Ă©tait
trompée, et le duc d'Alençon, dévoué aux Huguenots, servira leur cause en
portant leurs dépouilles. La politique du duc d'Alençon est en ce moment aisée
à résumer. Tandis que Catherine de Médicis
exige, s'il obtient la main d'Ălisabeth, qu'il ne le doive qu'Ă sa mĂšre, il
cherche au contraire Ă y parvenir sans son appui; car il le juge trop
compromettant le lendemain de la Saint-Barthélemy. Pour atteindre ce but,
il est prĂȘt Ă se mĂȘler Ă toutes les intrigues. Il sera, si cela lui parait
utile, contre le roi avec les Huguenots, contre la France avec Ălisabeth. DĂšs le 21 septembre 1572, le duc d'Alençon rĂ©clame de
Walsingham une entrevue secrĂšte oĂč il proteste de son indignation au sujet de
tout ce qui s'est fait. Il lui répÚte combien il est affligé des rigueurs de la
Saint-Barthélemy, combien il est disposé à offrir aux Anglais son assistance et
son amitiĂ©. Il l'entretient de son vif dĂ©sir d'obtenir la main d'Ălisabeth ; il
sera toute sa vie le serviteur de la reine d'Angleterre et le défenseur des
intĂ©rĂȘts de son peuple (Joseph
Bruno Marie Constantin Kervyn de Lettenhove, Les Hugenots et les Gueux: Ă©tudes
historiques sur vingt-cinq années du XVIe siÚcle (1560-1585), Tome 3, 1884 -
books.google.fr). Flux de sang Peut-ĂȘtre faut-il faire intervenir un autre personnage : le prĂ©lat royal ne serait pas la victime du flux de sang. Charles IX
commença à cracher du sang pendant l'été 1573, mais son état se dégrada
soudainement en novembre. La période est caractérisée par la naissance du
«tiers parti», celui des Malcontents, fait de protestants et de catholiques
modérés (dont François d'Alençon, Henri de Navarre, les Montmorency), qui tenta
Ă plusieurs reprises entre janvier et avril 1574 d'imposer par la force le duc
Alençon comme successeur de son frÚre Charles. L'objectif des conjurés était
d'Ă©vincer Henri, pourtant premier dans l'ordre de succession, mais dont
l'implication dans le massacre de la Saint-Barthélemy laissait craindre la
reprise des guerres (Eliane
Viennot, Mémoires et discours, 2004 - books.google.fr). Le duc d'Alençon
était déjà atteint d'un flux de sang qui devait terminer ses jours comme ceux
de son frĂšre Charles IX, et le 10 juin 1584, il rendit le dernier soupir Ă
ChĂąteau-Thierry (Joseph
Marie Bruno Constantin Kervyn de Lettenhove, La Flandre pendant les trois
derniers siĂšcles, 1875 - books.google.fr). D'abord il lui
vint une difformité sur le visage qui le défigurait tellement, qu'il paraissait
avoir deux nez; il fut ensuite attaqué d'un flux de sang qui lui coulait par la
bouche et par le nez. A ces maux se joignit une toux violente qui lui rompit
une veine dans la poitrine, et lui fit cracher le sang; il tomba enfin dans un
Ă©tat de langueur, d'Ă©tisie qui ne lui laissait plus attendre que la mort.
Il disait que depuis qu'il avait Ă©tĂ© voir le roi Ă carĂȘme-prenant, il n'avait
pas porté de santé, et que cette vue, avec la bonne chair qu'on lui avait faite
à Paris, lui coûtait bien cher : ce qui fit entrer beaucoup de gens en
nouveaux discours et appréhensions. Au premier bruit de sa maladie, la
reine-mĂšre Ă©tait partie en diligence de Paris pour se rendre Ă ChĂąteau-Thierry.
Dans un de ses derniers voyages, voyant son fils abandonné des médecins, elle
fit démeubler le chùteau et transporter à Paris, par eau, les meubles les plus
précieux. Le roi avait déjà envoyé de son cÎté le duc d'Epernon au roi de
Navarre pour le prier de la part de sa majesté pour "ce que la vie du duc
a d'Alençon était déplorée, de venir à la cour, d'aller à la messe, parce qu'il
voulait le faire a reconnaßtre pour son vrai héritier.
Le dimanche 10 juin, sur le midi, Monsieur, frĂšre du roi, mourut au chĂąteau de
ChĂąteau-Thierry" (Alexandre
EusÚbe Poquet, Histoire de Chùteau Thierry, 1839 - books.google.fr). "Prélat
royal" et "baissant" Charles Ier de
Bourbon (22 septembre 1523 - 9 mai 1590), Charles X selon la Ligue, cardinal de
VendĂŽme, Ă©tait un prince de sang de la maison de Bourbon. Au cours de sa
carriÚre ecclésiastique, il devient abbé commendataire de plus de vingt
abbayes. L'accumulation de ces bénéfices fait de lui un des plus riches princes
d'Europe. Bien que dénué de caractÚre et d'intelligence, il fut un personnage
important des guerres de religion. En 1585, la Ligue catholique l'imposa au roi
Henri III comme héritier de la couronne de France à la place de son neveu
protestant le futur Henri IV. Lors des Ătats gĂ©nĂ©raux de 1588 Ă Blois, il est
mis en arrestation sur l'ordre du roi. En 1584, à la mort du duc François
d'Anjou, les ligueurs considÚrent le cardinal comme l'héritier du trÎne de
France, excluant de la succession tous les protestants. à la mort de Henri III, alors qu'il est toujours séquestré, il est
reconnu par les ligueurs comme le seul roi de France légitime. Il est proclamé
par le Parlement de Paris sous le nom de «Charles X» en 1589. Il meurt l'année
suivante Ă l'Ăąge de soixante-six ans. NĂ© le 22 septembre
1523 à La Ferté-sous-Jouarre, il est le fils de Charles IV, duc de VendÎme, et
de son épouse Françoise d'Alençon, duchesse de Beaumont. Il est le frÚre
pußné d'Antoine de Bourbon, pÚre d'Henri IV. Grand-neveu du cardinal Charles II
de Bourbon, il est le neveu du cardinal Louis de Bourbon-VendĂŽme et l'oncle du
cardinal Charles II de Bourbon (fr.wikipedia.org
- Charles Ier de Bourbon (archevĂȘque de Rouen)). Sur le tombeau de Charles de Bourbon, Ă l'Ă©cu de
Bourbon-VendÎme est adjoint celui de Françoise d'Alençon : «De France à la bordure de
gueules chargée de huit besants d'argent» (Achille
Lacroix de Vimeur de Rochambeau, Le Vendemois: Ăpigraphie and iconographie,
Tome 1, 1889 - books.google.fr). besant, bessant, besent, beseno, bezant, baxant =
eine GoldmĂŒnze, welche ihren Namen von der Stadt Byzanz hat, wo sie zuerst
geprÀgt wurde (Adolf
Stoeriko, Ueber das VerhÀltnis der beiden Romane Durmart und Garin de Monglane,
1888 - books.google.fr). Deux lignes de comtes dâAlençon se sont Ă©teintes avant
que le titre dâAlençon ne soit rattachĂ© Ă la maison rĂ©gnante de Valois. En
1268, Alençon fut donnĂ©e en apanage Ă Pierre, fils de Louis IX puis en 1293, Ă
Charles, comte de Valois, frĂšre de Philippe le Bel. En 1524, le duchĂ© dâAlençon
revint à la couronne à la suite de la mort sans héritier du duc Charles IV,
mariĂ© Ă la sĆur de François Ier, Marguerite de Navarre, qui en garda l'usufruit
jusqu'à sa mort. En 1559, le titre fut donné à Catherine de Médicis en douaire
et, en 1566, en apanage à son fils cadet, François (fr.wikipedia.org
- Liste des comtes puis ducs d'Allençon). A cĂŽtĂ© des gros revenus (ArchevĂȘchĂ© de Rouen depuis
1550), les petits ne firent point faute. De 1564 Ă 1571 le cardinal vit presque
chaque année ses bénéfices s'accroßtre. Successivement il reçut les abbayes de
Saint-Jean des Vignes (1565), Saint-Honorat de Lérins et Montiéramey (1567),
Fontenelle (1569), Pontlevoy (1571). Il prit encore possession des quatre
principales abbayes du cardinal de ChĂątillon : SorĂšze, Saint-Germer,
Froidmont, Saint-Lucien de Beauvais, qui, au dire de l'ambassadeur espagnol,
valaient autant que les quatorze restantes. Ce cumul vraiment exagéré n'alla
pas sans soulever de nombreuses protestations, et il est curieux de voirie pape
chercher à l'expliquer par la nécessité de procurer à Charles de Bourbon un
rang et des ressources proportionnés à sa dignité cardinalice
. Quand, en juillet 1576, une grave maladie fit craindre pour sa vie, on
estima que. s'il venait Ă mourir, vaqueraient plus de
quatre cent mille livres de rente des biens d'Ă©glise. Cette richesse colossale,
cet appĂ©tit insatiable firent mĂȘme dire Ă un ambassadeur du roi d'Espagne qu'on
serait toujours maĂźtre du cardinal en lui donnant Ă©vĂȘchĂ©s et abbayes.
L'ambassadeur le connaissait mal. Il n'y eut jamais que deux choses qui
préoccupÚrent sérieusement Charles de Bourbon et qui, lune aprÚs l'autre,
furent les causes déterminantes de sa conduite : la fortune de sa maison et la
défense de la religion catholique. Avec l'influence
considĂ©rable que lui donnaient ses litres de prince du sang, d'archevĂȘque de
Rouen et de cardinal, avec les immenses
richesses qu'il tirait de ses nombreux bénéfices, il eût fait un parfait homme
de cour. Le malheur voulut qu'il fût jeté dans la tourmente des guerres de
religion (EugĂšne
Saulnier, Le rĂŽle politique du cardinal de Bourbon (Charles X) 1523-1590, 1912
- books.google.fr). En 1550, il est nommé abbé commendataire de Saint-Ouen de
Rouen. De 1556 à 1558, il est l'abbé commendataire de l'abbaye Notre-Dame du
Tronchet, de Corbie Ă partir de 1557 et de l'abbaye de Saint-Wandrille de 1569
à 1578 ainsi que de l'abbaye de Bourgueil. En 1574, il devient abbé
commendataire de JumiĂšges. Il ne participe pas au conclave de 1559 qui Ă©lit Pie
IV. Le 15 janvier 1561, il devient cardinal de San Crisogono (fr.wikipedia.org
- Charles Ier de Bourbon (archevĂȘque de Rouen)). Tunis, Carthage, EnĂ©ide In
contrast to Marlowe's diplomatic rendering of the Medicis a decade later, John
Stubbs had published a vitriolic attack on the French royal family in 1579, the
year Elizabeth was engaged to marry Alençon. In The Discovery of a Gaping Gulf Stubbs dissuades the queen from that
alliance by interpreting the massacre as a divine signal warning against
trusting the French in any way: Â A king falsifled his sworn word; the marnage of
a king's sister imbrued with blood; a king murdered his subjects; many noble
and honorable gentlemen shamefully used; valant men surprised by cowards in their
beds; innocents put to death; women and children without pity tossed upon
halberds and thrown down windows and loto avers; learned men killed by barbarous
soldiers. Stubbs's
language recollects Virgil's descriptions of Troy in defeat, anticipating the
tale of bloody chaos that Marlowe's Aeneas will narrate in Dido. The lesson of
Troy is embedded in Stubbs's imagination, for he quotes a salient bit of wisdom
from the Aeneid: 'Timeo Danaos vel dona ferentes (I fear the Greeks, even when
they offer gifts)' (40, citing Aeneid 2:49). In Stubbs's text, the maxim
becomes even more haunting when we remember how the English traced their
ancestry to Aeneas. Building on fantasies of horror in his treatise, Stubbs
concludes that the union of Queen Elizabeth and a French prince - even a
Protestant one bearing dynastic gifts - would lead to disaster for England.
[...] In
efforts to abort the engagement of Elizabeth and Alençon, then, Stubbs and
others inflamed nationalism by claiming that under Alençon's projected command
as king of England, English soldiers might become as `barbarous' as the French
troops who had carried out the massacre. Worse, English soldiers might be
sacrificed in foreign campaigns led by inept or malignant commanders. Again,
John Stubbs: if the marriage comes to pass, 'our soldiers of necessity must be
sent out under some Joab for some more desperate service than Saint-Quentin,
one way or other to be dispatched and cut in pieces'. As it is, he says, those
French soldiers who effected the bloodletting in 1572 had won only a
'barbarous, unmanlike, and treasonous' victory (Alan
Shepard, Marlowe's Soldiers: Rhetorics of Masculinity in the Age of the Armada:
Rhetorics of Masculinity in the Age of the Armada, 2018 - books.google.fr). Dido, Queen of Carthage and The Massacre at Paris may seem an odd couple to discuss in tandem.
In many ways the plays represent polarities within the Marlowe canon. Despite
the many questions surrounding the dating of Dido, Queen of Carthage, most scholars agree that it is Marlowe's
first dramatic effort, perhaps scripted white he was still a student at
Cambridge, and The Massacre at Paris
one of his last, probably written sometime in 1592. Moreover, Dido finds its
provenance in classical epic, dramatizing Books 1, 2, and 4 of Virgil's Aeneid
with a veneer of Ovidian shading from the Heroides, whereas The Massacre is
Marlowe's only play based on topical events, a rehearsal of recent upheavals in
France. Additionally, whereas Dido was first performed by boy actors for a
private theatre, The Massacre was apparently acted by a professional company.
Finally, although many aspects of Dido have been interrogated - authorship,
date, genre - the text of the play has not been questioned; converscly, The Massacre is generally accepted as
Marlowe's most corrupt tent, most likely the truncated product of memorial
reconstruction by a troop of actors. However, despite these many antitheses,
similarities between the two plays abound, a number of which will be examined
in this chapter. Although both plays share a traditional scholarly neglect,
both have recently evoked con-siderable critical ineerest. Moreover, each play
presents tragic protagoniste - Dido and the Guise - who struggle for national
leadership within a complex web of political and amatory events that determine
their downfalls, even though in Dido the web is woven by the gods, in The Massacre by combating political
forces. In addition, in typical Marlovian fashion, both plays dramatise
multiple inversions of accepted rubrics of politics, gender, and sexuality, and
in both plays the accepted audience response to these subversive behaviours has
been debated by commentators. Some land Dido as an apotheosis of love over
honour; others read it as an affirmation of duty over passion. Similarly, some
expositors censure The Massacre as a
blutant piece of Protestant propaganda, while others praise it as a penetrating
appraisal of realpolitik (Patrick
Cheney, The Cambridge Companion to Christopher Marlowe, 2004 - books.google.fr). Dido, Queen of Carthage, begins with a comic vignette that
shows Jupiter toying erotically with the young Ganymede. In the fragmentary
drama The Massacre at Paris, there
are strong intimations that Henry III is sexually obsessed with bis male
minions (Gregory W. Bredbeck) (Encyclopedia
of Gay Histories and Cultures, 2013 - books.google.fr). "respiré" :
"breath" The
Gaping Gulf strikes hardest at the bordering peoples, at the Scots and the
Irish. By the time the book was published Fitzmaurice was dead, yet he lived on
in Stubbs's imagination, linked to Alençon and a widespread Catholic
conspiracy: "Yea, unless we
ourselves close our own eyes, we may see that it is a very French Popish wooing
to send hither smooth-tongued Simiers to gloss and glaver and hold talk of marriage,
and yet, in the meanwhile Fitzmaurice, who kath been in France... even now came
immediately thence into Ireland invade our Qoeen's dominion... Is it possible for the breath of marriage
well meant to England and war performed in Ireland to come out of one mouth?"
With a complete disregard for life and wealth, Stubbs concludes that England
does not need help in liberating the Netherlands or protecting its own borders:
"English money and Englishmen must do this enterprise. le
may be much better achieved now while we have the law in our own hands and may
command than when we shall have put our sword into another hand; we have not so
much need of him for a captain as he bath of our strength to serve him." (Richard
Berleth, The Twilight Lords: Elizabeth I and the First Irish Holocaust, 2002 -
books.google.fr). Bourbon - Tunis -
Besants : plus tÎt dans le temps Louis II, duc de Bourbon, surnommé le Bon, comte de
Forez, fut chargé du commandement de l'armée chrétienne que Charles VI envoya,
en 1390, contre les Sarrasins de Tunis, sur les instances du doge de GĂȘnes.
Cette armée comptait dans ses rangs les plus grands seigneurs de France. Cinq
cents chevaliers du Bourbonnais et du Forez suivirent aussi ce prince dans
cette expĂ©dition. Carthage, assiĂ©gĂ©e pendant neuf mois, ne put ĂȘtre prise par
l'armée chrétienne ; mais une victoire remportée dans une bataille rangée et
divers succĂšs obtenus dans plusieurs rencontres avec les Sarrasins permirent
d'obtenir un traité avantageux, qui rendit à la liberté tous les captifs
chrétiens qui étaient retenus en esclavage à Tunis. Louis II de Bourbon revint
dans ses Etats au commencement de l'année suivante ; car, le 27 mars 1391, il
fut célébré, dans l'église de Notre-Dame de Montbrison, deux messes en actions
de grĂące de l'heureux retour de ce prince (A.
Vachez, Les familles chevaleresques du Lyonnais, Forez et Beaujolais aux
croisades, Mémoires de la Société littéraire, historique et archéologique de
Lyon, 1876 - books.google.fr). Le prince français dicta lui-mĂȘme au bey de Tunis les
conditions du traité de paix ; il consentit à quitter l'Afrique pourvu que les
Barbaresques prissent l'engagement de ne plus exercer leurs ravages sur les
cĂŽtes de la Provence, de Naples et de toute l'Italie; qu'ils mettraient en
liberté les esclaves chrétiens; qu'ils payeraient sur-le-champ 10,000 besants
d'or pour les frais de la guerre, et pendant quinze ans un tribut annuel Ă la
rĂ©publique de GĂȘnes, en rĂ©paration des dommages causĂ©s par eux au commerce
ligurien. Le duc soumit le projet de ce traité à la sanction des principaux
officiers de l'armée, aux sires de Couci, de Rieux, d'Eu, de Saint-Priest, de
Graville, de ChĂątillon, de Lestrade, de Chastellux, de Cliffort, au comte de
Derbi : tous ces barons l'approuvÚrent, en déclarant que, suivant eux, cette expédition
devait ĂȘtre regardĂ©e comme trĂšs-glorieuse, et qu'ils n'auraient jamais cru
qu'elle pût avoir une issue aussi satisfaisante. Le duc de Bourbon avait exigé que les 10,000 besants d'or fussent
livrés avant son départ. Le bey de Tunis s'adressa, pour former cette somme
en numéraire, à des négociants catalans, napolitains et sardes, lesquels, établis dans la ville d'Africa, profitaient des prises
faites sur les chrétiens par les pirates. Ces marchands résistÚrent plusieurs
jours aux sommations des beys; il fallut en venir aux menaces pour les engager
à fournir cet argent. Les 10,000 besants furent enfin apportés dans la tente de
Louis de Bourbon, qui les employa à payer la solde des troupes salariées
marchant sous ses ordres : il distribua le reste aux chevaliers ou Ă©cuyers les
moins riches. Trois jours aprĂšs, la flotte se remit en ligne devant le rivage;
on disposa les navires pour recevoir les croisés. Tandis que ces préparatifs se
poussaient avec ardeur, on vit approcher une division assez nombreuse de
cavalerie maure, qui s'avançait lentement, à mesure que les chrétiens montaient
sur les vaisseaux. Le duc de Bourbon connaissait le caractĂšre perfide de ces peuples,
et, voulant se mettre en garde contre quelque surprise, il fit cacher six cents
hommes derriÚre une vieille muraille, reste d'une ancienne jetée qui s'étendait
jusqu'Ă la mer; il se mit Ă la tĂȘte de cette division pour attendre l'ennemi.
En vain le sire de Couci lui représenta que ses fonctions de général en chef
imposaient d'autres obligations au duc de Bourbon, et qu'il devait laisser Ă un
de ses officiers le soin de repousser cette cavalerie; mais le duc persista Ă
quitter le dernier le sol africain. Il ne tarda point Ă s'applaudir d'avoir
pris d'aussi sages mesures : car les Arabes, ne voyant plus sur le rivage que
quart des troupes européennes, fondirent dessus bride abattue, en poussant des
cris horribles, voulant, au mépris de tous les traités, venger par une perfidie
la honte de leur dĂ©faite passĂ©e; mais au moment oĂč ils se prĂ©cipitaient sur les
chrĂ©tiens rangĂ©s le long de la plage, le duc de Bourbon, jusqu'alors cachĂ© Ă
tous les yeux, sortit de son embuscade et s'élança au milieu de cet essaim de
cavaliers. Le courage et la discipline des Français triomphÚrent de cette
multitude de barbares; les chevaliers coupaient les jarrets des chevaux Ă coups
de hache d'armes. L'Ă©pouvante s'empara des Kabiles : ils regagnĂšrent le
désert, en laissant sur le rivage un millier de morts; on leur prit quelques
chevaux magnifiques de pure race, que les Français emmenÚrent comme trophée (Alexandre
Mazas, Vies des grand capitaines français du moyen ùge, Tome 4 : Louis II de
Clermont et Jean le Meingre de Boucicaut, 1845 - books.google.fr). Le lourd stipes est un mot injurieux, pour qualifier une
personne lourde, stupide , en français une bûche, une
souche : «Caudex, stipes, asinus, plumbeus,» bûche, souche, ùne, Jourdaud.
(Ter., Heaut. V, 1, 4.). Outre caudex et stipes, les Latins employaient encore
frutex dans ce sens (E.
Barrault, Traité des synonymes de la langue latin, 1853 - books.google.fr). Acriostiche : PGLL pgl : pugillus (poignée, contenu
de la main) (Wilhelm
Fr. Wilibald Artus, Receptirkunst oder Anleitung, die verschiedenen Formen der
Arzneien nach den Regeln der Wissenschaft und Kunst zu verschreiben, 1857 -
books.google.fr). A great
number of pamphlets on the succession issue were published during the years
from 1580-1600, debating the issue in increasingly hysterical ways.
Shakespeareâs bastard characters are important in relation to this anxiety not
simply because they are connected with inheritance issues, but because the
central issue of these pamphlets is the concept of validity, linear descent and
legality. The idea of validity or truth is connected to the bastards in several
ways; âtrueâ and âlegalâ were both meanings of âlegitimateâ in early modern
English. John Stubbes uses these various connotations of legitimacy in The Discovery of A
Gaping Gulf. Stubbes feared that the nation would suffer if Elizabeth
married the French Catholic Duke of Alençon, and made reference to her being
too old to bear an heir. Stubbes argued that a pregnancy for a woman
Elizabethâs age would mean death, and leave England with more of a succession
crisis than it already faced. Another concern was that if the Dukeâs brother,
Henry III, were to die childless, Elizabeth would be forced to follow him to
France, leaving England. These fears about losing Elizabeth feed into a wider
anxiety about the future of England. The
severity of Stubbesâ punishment (losing his right hand) indicates the serious
level of his pamphlet; it drew attention to the instability at the heart of
the English government. The fact that Elizabeth reportedly wished Stubbes,
otherwise her prominent supporter, to suffer the death penalty reveals how
dangerous his opinion was considered to be Catholic
and Protestant subjects used legitimacy language to challenge her authority.
The Jesuit Robert Persons also published his Conference about the Next
Succession in 1594, arguing that the Spanish, Catholic descendants of the house
of Lancaster were the true heirs to England. Illegitimacy was a particularly
important metaphor for vulnerability in these cases, with Stubbes and Wentworth
shading their writing with reminders of Elizabethâs legal illegitimacy to
remind her that the source of her sovereignty was her subjects, to whom she
owed a parental duty. Though Pius Vâs Bull Regnans in Excelsis bastardised
Elizabeth in quite simple terms as illegitimate and hence unable to inherit, Persons
uses models of conceptual illegitimacy and legitimacy to make the Spanish
Infantaâs claim, suggesting that birth legitimacy may be far less important
than personal. [âŠ] A Gaping
Gulf is a text that may well have influenced Shakespeare in King John. [âŠ] In a
soliloquy that is, in terms of language if not in sentiment, strikingly similar
to Faulconbridgeâs âwe are all bastards to the timeâ (King John 1.1.207),
Posthumus tells the audience : ...We are bastards all, And that venerable man which I Did call my father was I know not where When I was stamped. Some coiner with his tools Made me a counterfeit... The âweâ aligns an audience with the
illegitimate speaker, much as Faulconbridge manages to do in King John, and the image of the
âcounterfeitâ was a popular one associated with illegitimacy: a bastard is a
âfalse coinâ with âno nameâ (The Devilâs Law Case, 4.2.129-130). Posthumus further elaborates the
image with the âcoinerâ (father) who âstampedâ him. Illegitimacy is again figured
as being of female origin, which, despite the paternal emphasis of illegitimate
inheritance in Shakespeare, continues a theme throughout the British plays (Katie
Pritchard, Legitimacy, Illegitimacy and Sovereignty in Shakespeareâs British
Plays, 2011 - www.escholar.manchester.ac.uk). Typologie Le report de 2219 sur la date pivot 1572 donne 925. Comme pour le quatrain X, 42 - John Dee et saint Dunstan
- 2208, on retrouve Dunstan. Dunstan
is said to have âsprung to lightâ in the reign Date of Athelstan. We may
question whether the word birth. âoriturâ? refers to his birth or to his coming before the eye of
history, in what year of Athelstan's reign the event took place, and in what
year Athelstan began to reign. All our authorities agree in referring the word
to Dunstan's birth. The Anglo-Saxon Chronicles, which Osbern follows, fix the
first year of Athelstan as the date, and for that first year we have to choose
between 924 and 925, the former date being given in four MSS. of the Chronicle,
and by Florence of Worcester, the latter by two MSS. of the Chronicle.
Unfortunately the exact date of the death of Edward the Elder is unknown, but,
as Athelstan in his charters speaks of 929 as his sixth year, his first must at
all events have begun in 924. Alford [jĂ©suite, 1587 â 1652] places Dunstan's
birth in the spring of 925, arguing that if his mother were pregnant in
February, as must be supposed to have been the case if Adelard's miracle of the
candles has any semblance of truth, and if Athelstan's accession took place
about the middle of the year 924, the child must have been born in 925. And
this computation is borne out by an entry in an ancient Anglo-Saxon Paschal
Table, preserved in the Cotton MS., Caligula A. 15, under the year 925, âon
thison geare was sce Dunstan geboren.â The matter is not in itself of great
importance, but it is complicated with questions touching the date of archbishop
(William
Stubbs, Memorials of Saint Dunstan Archbishop of Canterbury. Ed. from Varions
Manuscripts, 1874 - books.google.fr). Au commencement du XIe siĂšcle, nous trouvons encore la
plus ancienne Vie de saint Dunstan, ami d'Aethelwold : elle fut composée
par un de ses contemporains qui, dans un prologue que le manque de simplicité
rend presque inintelligible, la dĂ©dia Ă Aelfric, archevĂȘque de CantorbĂ©ry
(996-1006). Il y dit que son récit se base sur ce qu'il a vu et sur ce qu'il a
entendu de la bouche de Dunstan lui-mĂȘme, ou bien encore de la bouche de ses
élÚves, que ce prélat instruisit et éleva depuis leur jeunesse jusqu'à l'ùge
mûr. AprÚs un prélude sur la christianisation de l'Angleterre, l'auteur passe
au gouvernement glorieux d'Aethelstan, sous lequel naquit Dunstan (925), dans
la Saxe de l'ouest (Wessex) : son pĂšre s'appelait Heorstan et sa mĂšre Cynedryth.
Il reçut les premiers éléments de l'enseignement dans le monastÚre de
Glastonbury, oĂč se trouvait une Ă©glise trĂšs ancienne, au sujet de laquelle
circulaient un grand nombre de légendes. Destiné à l'état ecclésiastique, il y
étudia avec ardeur des ouvrages de théologie, notamment ceux des Irlandais ;
le monastÚre était, en effet, fréquemment visité par des pÚlerins irlandais, vu
que Patrice le jeune, le neveu de leur apĂŽtre, y Ă©tait enseveli. Dunstan se
distingua tellement par son talent et son application, que l'influence de son
oncle, l'archevĂȘque de CantorbĂ©ry, s'ajoutant Ă cette premiĂšre recommandation,
il fut appelé à la cour royale. Toutefois, il n'y resta pas trop longtemps ; la
jalousie de ses jeunes compagnons, élevés au palais comme lui (Palatini) le
força à se retirer. Ils l'accusaient, entre autres choses, d'avoir appris les
poĂšmes pleins de vanitĂ© des ancĂȘtres paĂŻens et de faire son Ă©dification de
contes frivoles de magie. Cette accusation n'Ă©tait peut ĂȘtre pas sans
fondement. A cette Ă©poque, il s'Ă©tait Ă©pris d'une jeune personne qu'il voulait
Ă©pouser : voilĂ pourquoi il refusait d'embrasser la vie religieuse, ainsi que
le lui conseillait son parent Elfegus, Ă©vĂȘque de Winchester. Il fallut une
maladie dangereuse pour l'y dĂ©terminer. Il revint donc Ă Glastonbury, oĂč il
s'adonna à la vie ascétique ; mais il s'occupa aussi, en dehors de ses études
théologiques, d'écrire, de jouer de la harpe et de peindre, arts dans lesquels
il acquit une grande habileté. Là , il entretenait de pieuses relations avec une
veuve alliée à la famille royale et retirée à Glastonbury. A sa mort, elle le
fit héritier de toute sa fortune, laquelle était considérable, et Dunstan en
disposa dans l'intĂ©rĂȘt de l'Ăglise. Lorsque, aprĂšs la mort d'Aethelstan (941),
Eadmund eut pris les rĂȘnes du gouvernement, Dunstan fut appelĂ© Ă la cour pour y
ĂȘtre le conseiller du roi : cette faveur lui vint de «sa vie vertueuse et de
son éloquente érudition». Mais, cette fois encore, il trouva à la cour des
ennemis qui le noircirent aux yeux du roi, en sorte qu'il tomba dans la plus
grande disgrùce. Toutefois, à l'occasion d'un grave danger qui menaçait ses
jours, le roi réfléchit et reconnut le tort qu'on avait fait à Dunstan. Comme
dĂ©dommagement, il lui donna le monastĂšre de Glastonbury, oĂč il l'introduisit
lui-mĂȘme avec le titre d'abbĂ©. C'est lĂ que Dunstan put dĂ©ployer, pour la
premiÚre fois, une grande activité en y introduisant la rÚgle sévÚre de saint
BenoĂźt. Comme, Ă cette Ă©poque, on ne regardait pas les anciens monastĂšres comme
de vrais couvents, on le désigna sous le nom de « premier abbé du peuple
anglais. » Il se dévoua, par le fait, avec un zÚle extraordinaire, aux devoirs
de sa vocation. Il fit entourer le monastĂšre de murailles et le fortifia, pour
protéger ainsi son troupeau contre le monde extérieur; il instruisit ses moines
qui affluaient de toutes parts, et ce fut de ce monastĂšre que sortirent les
Ă©vĂȘques et abbĂ©s cĂ©lĂšbres de l'Angleterre. Quant Ă lui, il eut Ă vaincre plus
d'une attaque de sa vive imagination. L'auteur, qui nous a déjà relaté des
visions et des rĂȘves de Dunstan, nous raconte ici (8 16) qu'il se croyait
poursuivi par le démon, qui lui apparut sous la forme de divers animaux, d'un
chien, d'un renard, d'un ours. A ce sujet, une foule de légendes eurent cours
parmi le peuple (1). Dunstan fut particuliÚrement favorisé par Eadred,
successeur d'Eadmund : ce monarque confia Ă son monastĂšre la garde du
trĂ©sor royal et des archives ; il voulait mĂȘme Ă©lever Dunstan Ă la dignitĂ©
Ă©piscopale, mais le cĂ©lĂšbre abbĂ© refusa le petit Ă©vĂȘchĂ© de Kirlon. AprĂšs la
mort prématurée d'Eadred et avec la prise de possession du gouvernement par
Eadwig (955) eut lieu un revirement subit dans la vie de Dunstan : sa chute ne
se fit pas attendre; mais elle fut suivie d'un relĂšvement encore plus grand.
Pendant le festin du couronnement, le roi se retira auprĂšs de son Ă©pouse : ce
procédé blessa les grands du royaume ; les ecclésiastiques avaient aussi d'autant
plus lieu de s'en trouver froissés, que son mariage n'était point légitime
d'aprĂšs le droit canon. Odon, archevĂȘque de CantorbĂ©ry, exigea le retour du
roi, et Dunstan, chargé de le lui annoncer, eut le courage d'accomplir son
message avec une énergie exempte de tout ménagement. Par là , il s'attira la
haine d'Eadwig, et encore plus celle de la reine. Notre auteur nous dépeint,
avec des couleurs dramatiques, cette scÚne si pleine de conséquences pour son
hĂ©ros : Dunstan entra dans l'appartement des femmes oĂč le roi, ayant posĂ© le
diadÚme sur le parquet, était occupé à passer son temps avec son épouse et sa
fille ; l'abbĂ© saisit la couronne, la mit sur la tĂȘte du monarque et le força Ă
quitter l'appartement. Le biographe exhale toute sa colĂšre contre cette
nouvelle JĂ©sabel. Son rĂ©cit, toutefois, semble n'en ĂȘtre que moins impartial en
cet endroit. L'autorité de la couronne était si grande, chez les Anglo-Saxons,
que Dunstan trouva des adversaires, mĂȘme parmi ses Ă©lĂšves. Il se vit donc forcĂ©
de quitter son monastĂšre et mĂȘme sa patrie. La Flandre lui offrit un asile.
Cependant, Eadwig se rendit si odieux, notamment par son avarice, qu'il
cherchait à satisfaire en s'emparant des nouveaux monastÚres des Bénédictins,
que, deux ans aprÚs, tout le pays au nord de la Tamise se détacha de son
autorité et élut pour roi Eadgar, son frÚre. Celui-ci rappela Dunstan. Dans un
synode, tenu Ă Bradford, l'abbĂ© fut nommĂ© Ă©vĂȘque, afin d'ĂȘtre toujours Ă mĂȘme
de soutenir le jeune roi de ses bons conseils. Il reçut le diocÚse de
Worcester, et, peu de temps aprĂšs, celui de Londres; mais, aprĂšs la mort
d'Eadwig et Ă la vacance de l'archevĂȘchĂ© de CantorbĂ©ry, ce siĂšge, le premier de
l'Angleterre, fut donnĂ© Ă Dunstan (959). Il se rendit ensuite lui-mĂȘme Ă Rome
pour y recevoir le pallium. L'auteur nous donne fort peu de renseignements sur
l'activité de Dunstan, pendant les trente années qu'il resta en possession de
la haute puissance ecclésiastique ; il se contente de nous raconter, d'une
maniÚre toute générale, ses occupations journaliÚres, telles que les exigeaient
en gĂ©nĂ©ral ses fonction d'archevĂȘque. Par contre, il
nous relate tout au long plusieurs visions du saint, dont l'une nous témoigne
bien du grand sentiment de sa dignité. La biographie s'arrÚte tout à coup, dans
la relation que l'auteur nous fait de sa fin. Dunstan mourut en 988, en
célébrant le saint sacrifice de la messe. Dans la derniÚre partie de cette vie,
on voit bien que l'auteur n'avait point le talent qu'il fallait pour comprendre
la vraie signification de son célÚbre contemporain : c'est plutÎt le
visionnaire et le saint que le prince de l'Ăglise, que le biographe admira dans
son héros. Et malgré cela, son livre nous offre, en grande quantité, des
nouvelles importantes et dignes de foi. De plus, il est Ă©crit avec une
intention Ă©vidente d'arriver Ă une diction artistique ; malheureusement
l'auteur la trouve dans un style fleuri, et, en deux endroits mĂȘme, il quitte
la prose pour recourir au vers hexamÚtre. Cette biographie a été, sans motif
suffisant, attribuée d'abord par Mabillon et ensuite par d'autres, à un moine
lettré de Ramsey, BRIDFERTH qui se fait connaßtre, comme un excellent
mathématicien pour cette époque, par ses gloses latines des ouvrages de BÚde :
De natura rerum et De temporum ratione (Adolf
Ebert, Histoire générale de la littérature du Moyen Age en Occident, Tome 3,
1889 - books.google.fr). Le plus ancien
document Ă©crit qui fasse mention des moneiarii est un passage des lois
d'Aethelstan (925-940), oĂč il est ordonnĂ© que le monnoyer coupable d'avoir
falsifié la monnaie doit avoir la main coupée et que la main sera placée sur
l'enclume. D'oĂč l'on serait en droit de conclure que le monnoyer forgeait
lui-mĂȘme la monnaie; car si on lui coupait la main, c'est parce que celle-ci
avait commis le crime. Conclusion que corroboreraient certaines légendes
monétaires telle» que Elda me fec(it) Adelbert me
fec{it). D'autre part, si le monetarius gravait le coin et frappait la monnaie,
comment rendre compte et des différences de style entre les diverses piÚces
d'un mĂȘme monĂ©taire, et des variĂ©tĂ©s nombreuses dans la graphie de son nom.
L'amputation de la main n'Ă©tait peut-ĂȘtre qu'une fiction juridique. Et quant au
mot fecit il convient sans doute de ne lui attribuer qu'un sens général; il est
vraisemblable qu'il indique la responsabilité du monetarius, qui garantissait
les espĂšces forgĂ©es par lui ou ses ouvriers, tout comme s'il les avait lui-mĂȘme
toutes fabriquées. Un passage de la vie de saint Dunstan nous montre qu'au
Xe siÚcle certains monétaires, sinon tous, étaient des gens d'une condition
plus ou moins servile; car il y est question de trois monetarii qui Ă©taient
dans la dépendance du saint «qui in potestate viri erant». Les monétaires, pour
ne pas ĂȘtre des hommes libres, n'en Ă©taient pas moins des gens possĂ©dant
quelque fortune. M. Keary ajoute que vers la fin de la période anglo-saxonne
l'exploitation des ateliers était affermée aux monnoyers; ce qui ressort
d'aprÚs lui du Domesday Book. On y lit, à propos de Worcester : «In civitate
Wirecestre habebat rex Edwardus hanc consuetudinem. Quando moneta vertebatur, quisque monetarius
dabat XX solidos ad Lundoniam pro cuneis monetae accipiendis.»
(M.
Prou, A catalogue of english coins in the Brilish
Muséum. Anglo-Saxon séries, vol. II (Wessex and England to the norman conquest) by Herbert A. Ghueber and Ch. Francis
Keary. Londres, 1893, Revue numismatique, 1894 -
books.google.fr). Dunstan, patron des orfĂšvres et des forgerons (Louis
Du Broc de Segange, Les saints patrons des corporations et protecteurs, 1887 -
books.google.fr). |